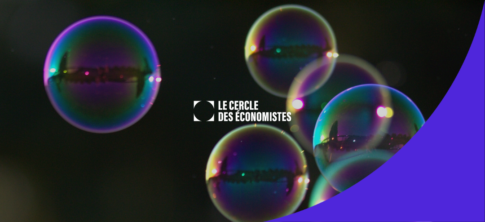Avec la déroute de Vivarte et son impact dans l’opinion, le capitalisme français vit un nouvel épisode ravageur, notamment en termes d’emplois. Faut-il condamner le système de « LBO » sur lequel est bâti le groupe de prêt-à-porter ? Jean-Paul Betbeze revient sur les caractéristiques de ce principe de financement et de management.
Ce qui se passe avec Vivarte montre les risques d’un LBO qui « tourne mal ». Ce sont des licenciements, des pertes, des drames. Mais tous les LBO ne finissent pas ainsi, heureusement. Pensons par exemple à CEVA Santé Animale. D’abord, un LBO leveraged buy-out, ou « achat à effet de levier », se produit quand un groupe de personnes et/ou d’investisseurs achètent une entreprise en s’endettant. C’est le cas d’une succession familiale, d’un groupe qui veut se défaire d’une activité, de cadres qui veulent racheter leur entreprise, ou encore d’un fonds qui veut investir, mais avec des crédits bancaires ou non bancaires, selon des structures plus ou moins complexes et risquées, donc avec des ressources assez coûteuses.
L’opération n’est réussie que si la rentabilité de l’entreprise est suffisante pour rembourser les dettes. Mais ce n’est jamais simple, d’où les critiques de cette procédure. D’abord, une entreprise sous LBO va réduire autant que possible ses dépenses inutiles. Elle va aller à l’essentiel, mettant la priorité sur les marchés, la recherche, les investissements… au détriment des dépenses « de confort ». Ceci se comprend, même si c’est souvent spartiate. Les cadres ou la famille qui font le LBO, cas les plus fréquent pour les PME, sont ainsi très endettés. Il s’agit là de la partie majeure de leur patrimoine, avec le souhait de réussir, bien sûr.
Cette réussite se verra quand la dette se réduira. Mais il est alors fréquent que l’entreprise poursuive sur sa lancée et mène sa croissance externe sous un deuxième, puis un troisième LBO. Le risque augmente alors. L’histoire s’arrête bien quand les premiers acteurs du LBO se retirent, vendent une part de leurs avoirs, fortune faite. On entend alors souvent que « c’est l’entreprise qui a payé le LBO », mais ce n’est vrai que parce qu’elle a été bien gérée et dirigée. Autrement, elle aurait disparu ou ne se serait pas autant développée.
Le cas grave, comme Vivarte, est celui d’une entreprise qui fait face à une conjoncture et/ou à un secteur difficile. Alors, la rentabilité de l’activité n’est pas suffisante pour faire face aux intérêts. Il faut rallonger la dette, l’entreprise cède des actifs, ferme des sites, licencie. Souvent, elle entre alors dans une spirale baissière dans laquelle partent ses meilleurs éléments et ses meilleurs actifs. Cette attrition peut se poursuivre jusqu’à la « vente par appartements », sauf à ce qu’un repreneur… la reprenne. Mais le prix de l’entreprise aura beaucoup baissé et le repreneur posera ses conditions, souvent en termes d’emploi et de stabilisation des rémunérations sur un temps donné. Le problème sera alors de retrouver la confiance des clients.
Financièrement, pour qu’un LBO marche, il faut que la rentabilité de l’activité dépasse le coût des capitaux mobilisés. Dans cette période de taux très bas, on comprend que ceci ait été tentant et ait conduit à une forte montée des LBO. Mais ces taux bas sont le reflet d’une croissance faible, et cette rentabilité supérieure qui permet de payer la dette ne vient de l’entreprise que si elle fonctionne bien ! Le LBO est plus une affaire de secteur et de management que de finance. Au fond, il y a deux LBO. Le premier permet l’innovation, la protection et la reprise d’entreprises. Le deuxième, dans la phase de concurrence par les prix de produits importés et d’achats en direct, qui déstabilise les chaînes – on le voit aux Etats-Unis – est un outil, risqué, de concentration.