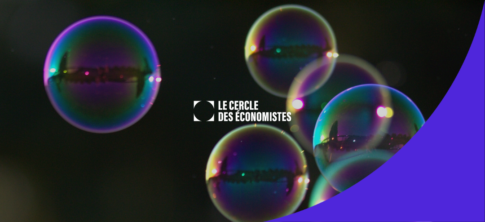L’examen parlementaire sur le projet de loi de finances 2018 relance le débat sur la notion de classes. Budget de rupture, certes, mais avant tout budget des riches et de relance de lutte des classes sociales ? Si le gouvernement refuse l’argument brandi par l’opposition, le sujet revient bel et bien sur le devant de la scène. Il remet aussi en lumière la notion du « bien commun », notamment pour éviter la destructuration de la cohésion sociale en essayant de retrouver les notions d’intérêt général, de valeurs communes et partagées. Retrouver, par le biais de la réduction des inégalités et de politiques éducatives, ce qui ressemblerait à une vraie cohésion sociale. L’idée remonte à Aristote, en passant par Saint Thomas d’Aquin, mais elle est aujourd’hui partagée, aussi, par des républicains.
Enfin, cette notion de bien commun renvoie également à celle de vulnérabilité. Vulnérabilités économiques et sociales ? Selon Jean-Paul Pollin, Professeur à l’Université d’Orléans et membre du Cercle des économistes, la question de la vulnérabilité « ne trouve pas sa place dans la boîte à outils de la théorie économique dominante », alors qu’elle occupe une place de plus en plus importante dans notre société.
Le Cercle des économistes vous propose de découvrir ici, en exclusivité, l’analyse de Jean-Paul Pollin.
Cette explication des « vulnérabilités » a naturellement sa pertinence, mais elle laisse de côté les fragilités sociales qui accompagnent et sont en interaction avec les dysfonctionnements économiques. Or, l’analyse des interdépendances entre l’économique et le social est essentielle à la compréhension des vulnérabilités observées et à la formulation des politiques économiques qui entendent les traiter.
L’objectif de cette contribution est précisément de suggérer une réflexion sur la prise en compte des rapports sociaux dans la compréhension et la résolution de vulnérabilités que l’on qualifie d’économiques. Pour cela nous opposerons dans un premier temps deux conceptions différentes de la coordination des choix économiques individuels. Celle de la théorie économique dominante (que l’on peut appeler aussi standard orthodoxe ou néoclassique) qui est centrée sur le rôle des marchés ; et celle plus hétérogène (qui regroupe notamment la nouvelle économie institutionnelle et la théorie des conventions) qui élargit la coordination à des formes non marchandes. Nous montrerons ensuite que ces deux conceptions débouchent sur des propositions bien différentes de politiques économiques, qui peuvent même s’avérer totalement contradictoires. Nous en donnerons des illustrations à partir de trois exemples classiques de politique économique : la recherche d’une croissance plus inclusive, la maîtrise de la globalisation, la réponse au défi écologique.
Notre démarche vise à montrer que la négligence du contenu et de la place du lien social dans la résolution de problèmes usuels de politique économique peut conduire à des impasses.
I. Deux conceptions des coordinations économiques et du lien social
Pour éviter toute interprétation erronée ou partiale de l’opposition entre ces deux visions de la coordination des choix économiques individuels, il faut comprendre que celles-ci répondent à des problématiques et procèdent de démarches bien différentes. La théorie économique dominante s’est constituée en s’extrayant de la philosophie sociale dont elle était issue, et en prenant progressivement ses distances avec les autres sciences sociales. La construction d’un objet scientifique propre l’a conduite à développer une méthodologie riche et rigoureuse qui lui a permis d’obtenir des résultats importants, tant du point de vue de la connaissance que de la pratique. Mais cela s’est fait au prix d’hypothèses restrictives (notamment sur les comportements individuels) ; et plus encore, au prix d’une approche étroite du contenu et de la place du lien social.
C’est sur la critique de ces hypothèses et de cette approche que s’est constituée l’autre conception de la coordination. Ce qui la conduit à considérer un ensemble plus vaste de modes de communication et d’interactions individuelles ; notamment ceux qui transitent par la médiation des institutions. Au passage, l’analyse des comportements microéconomiques s’en trouve elle-même transformée, c’est-à-dire enrichie par rapport à la fiction de « l’homo oeconomicus ». De sorte que l’on en vient à repenser la relation de l’économie aux autres sciences sociales. Au prix, cette fois, d’une plus grande difficulté à formaliser les raisonnements et à en tester la pertinence.
I – 1 : La coordination par les marchés : le paradigme de l’équilibre général
Pour la théorie économique standard ce sont donc les mécanismes de prix qui sont censés assurer la coordination des choix économiques individuels. Depuis l’origine, et avant même qu’elle se définisse comme champ scientifique propre, le projet central de l’économie a été de démontrer que ces mécanismes avaient le pouvoir de rendre compatibles la multitude des décisions économiques prises de façon décentralisée. L’ambition peut sembler modeste et elle est pourtant loin d’être triviale. De Smith à Arrow et Debreu, en passant par Walras et Pareto, il a fallu mobiliser une somme considérable de réflexions pour déterminer les conditions d’existence de cet « équilibre général ». C’est-à-dire d’un ensemble de prix capable d’équilibrer tous les marchés de biens et de services ; cet équilibre constituant de surcroît un optimum, c’est-à-dire une situation dans laquelle il n’est pas possible d’améliorer le bien-être d’un individu sans dégrader celui d’un ou de plusieurs autres.
Encore faut-il préciser qu’en dépit du travail consenti, il nous manque toujours une démonstration de la stabilité de l’équilibre général : on connait ses conditions d’existence, mais on ne sait pas s’il constitue un point de convergence. Mais même en laissant de côté cette difficulté, la formulation du modèle d’équilibre général a suscité et suscite toujours des recherches complémentaires importantes à propos du rôle des prix dans la coordination. Car il reste de nombreuses questions à résoudre concernant diverses imperfections ou défaillances des marchés, qui sont autant de remises en cause des hypothèses nécessaires à la démonstration des théorèmes d’existence et d’optimalité. En particulier bon nombre d’échanges se font en situation d’information asymétrique, c’est-à-dire que l’un des cocontractants, généralement le vendeur (ou le demandeur de capitaux), dispose d’une meilleure information sur le bien, le service ou l’utilisation des capitaux sollicités. Les mécanismes de prix se trouvent alors pris en défaut. C’est aussi le cas lorsqu’existent des monopoles naturels (c’est-à-dire lorsque certains types de productions bénéficient de rendements d’échelle croissants) se traduisant par la présence d’une seule firme sur son marché, capable d’imposer le prix qu’elle souhaite. C’est encore le cas lorsque des décisions individuelles impactent directement les situations ou les préférences des autres agents (ce que l’on appelle des externalités), sans que ces « échanges » puissent être régulés par des prix.
Toutes ces configurations correspondent à des défaillances de la coordination par les marchés qui nécessitent des interventions extérieures (d’une autorité publique, d’une agence habilitée…) qui peut prendre la forme d’une régulation des prix ou des marges, de production d’information, de prise en charge de certaines activités, de taxation ou de subventionnement de certaines autres… La coordination change alors de nature puisqu’elle fait appel à une procédure centralisée. Mais en l’occurrence ces interventions ne visent qu’à assister ou à compléter les mécanismes de marchés dans des situations particulières. Les prix, fixés librement ou corrigés centralement, restent l’instrument de conciliation des choix résultant de la maximisation des utilités individuelles.
Bien sûr les tenants de cette conception, qui relève d’un pur individualisme méthodologique, ne peuvent ignorer que le fonctionnement des marchés suppose des règles, un cadre juridique, un environnement institutionnel… qui conditionnent le fonctionnement des marchés. Mais dans un sens cet environnement peut être considéré comme une donnée du problème de maximisation sous contrainte des utilités individuelles. Et dans l’autre sens (l’action des agents sur l’environnement) la question peut se résumer à définir les formes institutionnelles qui assurent l’optimisation des mécanismes de marchés : l’exemple des travaux sur « l’efficacité économique du droit » en fournit une bonne illustration.
Ajoutons que ce cadre analytique peut, d’une certaine façon, intégrer certaines préoccupations éthiques, concernant notamment les inégalités résultant de l’équilibre général des échanges. C’est d’autant plus important que rien ne garantit que les solutions d’équilibre assurent à chaque individu un revenu décent. Dès lors, ces inégalités peuvent être vécues comme choquantes, c’est-à-dire affecter défavorablement l’utilité des agents ou de certaines d’entre eux. On se trouve alors confronté à un problème d’externalité : la situation des uns influence directement l’utilité des autres. Ce qui justifie une intervention extérieure visant à opérer une redistribution qui améliore la somme agrégée des utilités individuelles. Mais il faut souligner que cette intervention ne se fait pas au nom d’un principe d’intérêt général ou de cohésion sociale ; elle ne se justifie qu’en fonction d’une combinaison d’intérêts individuels.
En définitive le lien social est ici, pour l’essentiel, le résultat de l’échange marchand. Les relations sociales ne sont que l’ensemble des contrats passés entre les membres de la collectivité, directement ou par le biais d’institutions transparentes. Quant à l’ordre social il est structuré et discipliné (pacifié) par la poursuite d’intérêts privés que les mécanismes de marchés rendent compatibles.
I – 2 : Au-delà des coordinations de marchés, l’importance du lien social
L’aspect le plus discutable de la théorie économique dominante est qu’elle fait l’impasse sur toutes les autres formes de coordination, au-delà des mécanismes de marchés, qui ne peuvent pourtant échapper à l’observation, c’est-à-dire les règles de comportements, les conventions, les routines…. Elles ignorent donc une grande partie (peut-être l’essentiel) des modes de communication explicite ou non qui permettent aux agents de se coordonner, notamment dans leurs activités productives. Au point qu’il devient par exemple impossible de rendre compte de l’entreprise, en tant qu’organisation, dans la théorie de l’équilibre général. Et c’est bien ce qui amenait Ronald Coase à s’interroger sur la « nature de la firme » dans un article resté célèbre [1]. Cette « nature », comme celle d’ailleurs de toute institution, ne peut se comprendre dans un système qui représente le fonctionnement de l’économie comme la rencontre d’offreurs et de demandeurs échangeant des biens, des services et des capitaux sur des marchés qui s’équilibrent par le jeu des prix.
Cette impossibilité à penser l’existence et le rôle des institutions constitue un problème majeur, car elle ampute l’analyse de la coordination d’une bonne part de sa substance. En effet, sur les marchés se nouent, de façon décentralisée, des opérations ponctuelles et anonymes, tandis qu’entre les membres d’une institution (une entreprise, une association, une collectivité…) s’établissent des relations durables, multilatérales et hiérarchisées. Il y a donc une opposition radicale entre la façon dont s’opèrent les échanges sur les marchés d’une part, et par l’intermédiaire des institutions d’autre part. Or, les caractéristiques des liens au sein des institutions permettent d’étendre les possibilités de coordination et rendent possible la résolution de problèmes imparfaitement solubles (voire insolubles) par les mécanismes de prix. C’est le cas des asymétries d’information qui peuvent être plus facilement levées parce qu’à la différence des marchés, les institutions gardent mieux la mémoire des échanges passés et qu’elles peuvent internaliser la rentabilité de l’information produite. C’est aussi le cas en ce qui concerne les situations dites d’incomplétude des contrats, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas possible de spécifier complètement l’engagement des cocontractants dans des conditions parfois difficiles à connaître et à décrire. L’existence d’une hiérarchie (d’un décideur habilité) offre alors généralement une solution plus simple et/ou plus rapide.
Plus encore, la médiation des institutions est essentielle pour rendre possible des coopérations productives entre agents. Car la coordination par les marchés est bien loin de répondre aux conditions nécessaires en l’occurrence. On comprend bien que ce n’est pas en mettant des individus en position de concurrence qu’on les incite à collaborer ; et il ne suffit pas qu’ils réalisent qu’une telle collaboration peut leur être avantageuse pour qu’ils l’acceptent. En réalité, pour qu’une coopération s’instaure, il faut que s’établisse une confiance entre les agents concernés, ce qui implique qu’ils aient les uns sur les autres des connaissances suffisantes (donc qu’ils ne soient pas trop nombreux, ni anonymes). Mais il faut aussi que leurs échanges (leurs engagements) soient durables et répétés pour éviter des comportements opportunistes (certains profitant des contributions des autres sans apporter la leur).
On doit insister sur l’importance des possibilités de coopération offertes par les diverses formes de coordination, car c’est probablement sur ce point que se situe la différence essentielle entre les deux types de conceptions que nous opposons. De façon générale les solutions coopératives sont en effet plus efficientes que celles qui ressortent de comportements d’agents poursuivant isolément leur intérêt propre : c’est un résultat classique de la théorie des jeux. Cette coopération peut notamment prendre la forme d’investissements spécifiques réalisés par des agents dans le cadre d’un projet commun, créateur de gains de productivité : par exemple l’introduction d’équipements et l’acquisition de qualifications propres à ce projet. L’interdépendance des uns et des autres suppose une collaboration et conditionne sa productivité. Mais ceci n’est envisageable que si les parties prenantes peuvent nouer entre elles des engagements durables qui leur donnent l’assurance de rentabiliser leurs investissements respectifs. Ce qui est d’ordinaire difficile à contractualiser et à faire respecter.
Or, les propriétés des institutions que l’on a évoquées offrent précisément les conditions nécessaires à l’existence de ces comportements coopératifs. Cela vient de ce que les institutions (mais on pourrait en dire autant des conventions) procèdent de constructions collectives qui créent et ordonnent des liens entre leurs membres. Ce qui dépasse de loin les rapports marchands, car ces liens sont fondés sur un cadre commun d’interprétation et de prescription des actions individuelles qui forge leur compatibilité. On peut ajouter que cette cohésion se fonde sur un projet collectif, une culture et des valeurs partagées, au moins pour partie. C’est dire qu’elle suppose une éthique des relations sociales qui garantisse aux agents économiques des droits, une protection contre les risques, un respect de ce qu’ils sont, constitutifs de leur confiance envers l’institution.
Cela dit, on ne peut évidemment laisser croire que toutes les organisations agissent dans le sens de la cohésion sociale, alors que les marchés seraient le lieu de sa dissolution. On sait bien que certains codes sociaux aliènent et/ou divisent ; que certaines conventions empêchent le renouvellement ; que certaines institutions sont oppressives, que d’autres vivent sur des rentes de situation, qu’elles participent à des phénomènes d’exclusion… Toutes les entreprises, par exemple, n’ont pas pour objectif de prendre en considération les intérêts des différentes parties prenantes ; leurs modèles de gouvernance diffèrent très sensiblement. Mais quelles que soient la réalité et la force du lien social, constitué d’institutions, de règles, de conventions…, il importe de reconnaître que cette construction collective se situe en surplomb des intérêts particuliers et qu’elle possède sa logique propre de fonctionnement. Elle permet de penser les notions d’intérêt général ou de bien commun de façon distincte de la simple agrégation d’utilités individuelles (y compris quand elles intègrent des préoccupations altruistes). Par ses modalités, sa cohérence, l’adhésion ou la confiance qu’elle suscite, ce « collectif » conditionne à la fois l’efficience de la coordination et la qualité des relations sociales.
[1] Ronald Coase (1937) « The nature of the firm », Economica.
II. Deux problématiques incompatibles du traitement des vulnérabilités ?
Les deux conceptions que l’on vient d’opposer conduisent naturellement à deux visions contradictoires de la nature des vulnérabilités économiques et de la façon de les traiter. L’enjeu principal de l’opposition que nous avons présentée se situe en effet dans la réponse à des questions vives de politique économique. Exprimées de façon générale, ces questions reviennent à se demander sur quels leviers et par quelles méthodes il convient d’agir pour améliorer le fonctionnement du système économique, c’est-à-dire son efficience et sa stabilité. Mais surtout comment faire pour qu’il s’adapte le mieux possible aux transformations de l’environnement (technologique, sociétal, international…) auxquelles il est soumis.
II – 1 : Corriger les imperfections de marchés ou œuvrer pour la cohésion sociale ?
Pour les libéraux et plus largement pour les tenants du paradigme de l’équilibre général, la réponse aux questions posées se situe dans la correction des imperfections de marché. Ils proposent donc de renforcer la concurrence, de dérèglementer certaines activités, d’étendre l’espace des marchés, d’éliminer les rentes de situations… Ils préconisent aussi d’optimiser l’allocation des ressources en rendant plus flexibles les marchés du travail et des capitaux pour faciliter les créations destructrices, c’est-à-dire le remplacement de certaines activités par d’autres plus productives. Tout ceci dans le but d’accroître l’efficience, de stimuler la croissance et l’emploi, ce qui est aussi censé favoriser l’intégration sociale par le développement des liens que constituent les échanges. C’est donc l’émergence d’une économie de marché plus flexible, plus réactive, moins administrative et moins protectrice qui serait le garant de la cohérence sociale. Certains libéraux appellent d’ailleurs de leurs vœux l’avènement d’un auto-entrepreneuriat, se substituant au salariat considéré comme un obstacle aux transformations souhaitables de l’économie. On rêve ainsi de concrétiser la fiction de l’équilibre général, en limitant autant que possible la place des organisations pour laisser les individus dans le face à face des échanges de marchés.
L’autre vision des choses procède d’une problématique toute différente : le renforcement du lien social constitue une étape préalable et non la conséquence d’une dynamique économique supposée vertueuse. En d’autres termes, on considère ici que c’est, pour une bonne part, au niveau de la qualité et de la cohérence des relations sociales que se situent et doivent se traiter les vulnérabilités d’un système économique. La démarche consiste alors à bâtir des solidarités pour établir la confiance et l’adhésion à des projets qui conditionnent l’implication dans l’action collective. Cela passe notamment par la consolidation ou la reformulation de systèmes de protection, par la limitation des inégalités, le maintien d’une mobilité sociale. Ce qui renvoie à des politiques de redistribution, d’éducation, d’habitat… Mais le point le plus délicat, en l’occurrence, est de trouver le moyen de faire évoluer ces différentes composantes du lien social face aux diverses transformations de l’environnement. Pour faire en sorte que celles-ci ne soient pas systématiquement considérées comme des régressions indésirables.
Car, la contrepartie des avantages des formes de coordination intermédiées (tout particulièrement la stabilité qu’elles procurent), réside dans leur inertie face à des chocs de grande ampleur ou des transformations radicales du contexte dans lequel elles s’inscrivent. Or, le maintien de la cohésion sociale ne peut évidemment se faire au prix de l’immobilisme. Ce qui veut dire que les formes qu’elle revêt doivent évoluer dans le temps. C’est là le véritable défi auquel cette démarche se trouve confrontée. Mais cela n’est évidemment pas de nature à la disqualifier.
Ajoutons qu’il existe entre les institutions d’un système économique et social donné des complémentarités qui lui donne sa cohérence [1]. En d’autres termes, l’association de différentes formes institutionnelles procède d’une certaine logique : par exemple un certain type de système financier (dominé par les marchés ou au contraire par des intermédiaires financiers) ne s’accorde pas avec n’importe quel système de protection sociale ou de fonctionnement du marché du travail. De sorte que le changement institutionnel doit s’opérer globalement ou du moins en respectant globalement la cohérence entre ses composantes. Ce qui rend la conduite des évolutions encore plus complexe.
II – 2 : Aux fondements de l’incompatibilité
On peut objecter que les deux visions ou stratégies de politique économique que l’on oppose ne sont pas pour autant exclusives l’un de l’autre. Remédier à certains dysfonctionnements des marchés, les libérer de contraintes inutiles, en éliminant au passage des rentes de situation, n’exclut pas que l’on agisse pour une meilleure équité ou que l’on prône le respect d’une certaine éthique dans les relations marchandes. Cela n’exclut pas non plus, que l’on procède à une certaine redistribution des revenus et des richesses. D’abord parce que la confiance entre les membres d’une communauté, la qualité de leurs relations s’accorde mal avec le caractère impersonnel, voire la brutalité des jeux de marchés. Il est difficile de croire que le fait de dérèglementer ou de « flexibiliser » (les emplois, les salaires, les relations de production…) va favoriser l’adhésion à des projets communs, ou plus simplement la cohésion sociale.
Ensuite parce que l’extension de l’espace des marchés et/ou le perfectionnement de leur fonctionnement (par l’intensification de la concurrence notamment) entrent potentiellement en conflit avec la fonction d’intermédiation des organisations : c’est-à-dire le fait qu’elles s’interposent entre les coéchangistes, ou encore qu’elles internalisent certaines transactions. Auquel cas on peut montrer que les deux formes de coordination et de politiques économiques qu’elles inspirent, se contredisent. Par exemple :
– Dans certains secteurs (celui des services de réseaux notamment) les entreprises réalisent des péréquations tarifaires qui consistent à subventionner certains clients ou usagers aux dépens de certains autres, afin d’offrir à tous un service égal en qualité et en prix (ce que l’on nomme le service universel). Ces subventions croisées permettent de maintenir une équité entre différentes catégories de consommateurs et/ou entre les territoires.
– De même des entreprises peuvent être amenées à réaliser des péréquations inter-temporelles, c’est-à-dire à moduler leurs prix dans le temps, pour favoriser la diffusion de certaines innovations, ou protéger temporairement une clientèle. Ainsi les institutions financières lissent parfois leurs conditions de crédit, pour maintenir ou amorcer une relation durable avec leur clientèle, et pour la soutenir dans des périodes de basse conjoncture ou de difficulté passagère.
Dans ces différents cas le service rendu (à la solidarité entre territoires, à la protection de certaines clientèles, à la stabilité économique) par l’intermédiation des organisations nécessite un certain pouvoir de marché. Le pouvoir de s’écarter de la solution de concurrence pure et parfaite qui ne correspond pas, en l’occurrence, à une situation optimale. De même que le pouvoir de marché peut résoudre certains problèmes d’externalités, tel que celui de la protection d’investissements en recherche-développement, plus généralement d’informations coûteuses à produire.
Il est vrai qu’il existe des solutions alternatives aux questions évoquées. Elles supposent que des interventions publiques corrigent les défaillances de marchés qui sont au cœur de ces questions. Mais les interventions publiques ont aussi un coût, dont rien ne dit qu’il ne soit pas plus élevé que celui résultant d’une situation de concurrence imparfaite [2].
[1] L’idée de complémentarités institutionnelles est une des notions fondamentales de la littérature sur la variété des capitalismes. On la trouvera exposée notamment dans l’ouvrage édité par Peter Hall et David Soskice « Varieties of Capitalism : The Institutional Foundations of Comparative Advantage », Oxford University Press, 2001.
[2] C’est à l’aune de ces réflexions qu’il faut juger du mouvement de désintermédiation, que l’on désigne sous le terme d’« ubérisation » de la société : c’est-à-dire une mise en relation directe de producteurs et de consommateurs court-circuitant le rôle des organisations. Une fois passé l’engouement ou la curiosité suscité par le phénomène, on commence à en mesurer les effets destructurants sur les relations économiques et sociales (précarité des emplois, concurrence déloyale, dégradation de certains cadres de vie…). De sorte que ces effets devront être, à tout le moins encadrés et/ou compensés, ce qui rendra moins attractive la « révolution » annoncée.
III. Trois illustrations des contradictions entre visions et traitements des vulnérabilités
Pour étayer notre propos et lui donner une forme plus concrète, nous allons prendre trois exemples de politiques économiques de natures différentes mais qui illustrent les oppositions auxquelles conduisent les deux visions des vulnérabilités que nous avons exposées. Ces exemples concernent la recherche d’une croissance moins génératrice d’inégalités, les limites à l’ouverture internationale des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux, l’organisation des réponses aux désordres écologiques.
III – 1 : Rendre la croissance plus inclusive
Deux faits majeurs ont marqué le bilan économique des pays avancés au cours des deux dernières décennies : une croissance de long terme qui a surpris par sa faiblesse et un très fort creusement des inégalités de revenus et de richesses. Soit des évolutions inverses par rapport à celles des « Trente Glorieuses » caractérisées par des taux de croissance deux à trois fois plus élevés, ainsi qu’une réduction des inégalités associée à une réelle mobilité sociale.
Pour ce qui est de la croissance, il est vrai que les 20 dernières années ont été affectées par deux crises financières dont la seconde (de 2008 à aujourd’hui) a largement pesé sur la conjoncture. Mais plusieurs études ont montré que le ralentissement des gains de productivité a précédé cette « Grande Récession », ce qui est d’autant plus étonnant que l’on avait proclamé, à la fin des années 90, l’avènement d’une troisième révolution industrielle capable de ranimer la croissance. Quant aux inégalités, les statistiques montrent qu’elles ont atteint, dans nombre de pays avancés, des niveaux historiques jamais connus depuis la fin de la décennie 1920-30.
Ces deux phénomènes ont donné lieu à de multiples explications dont certaines ont suggéré l’existence d’une interdépendance entre une faible croissance et le niveau élevé des inégalités. Mais ce qui nous intéresse ici est plutôt d’analyser la façon dont ces problèmes ont été considérés et traités, ainsi que d’apprécier les résultats des politiques menées. Bien entendu les solutions retenues ont été différentes dans leurs modalités, selon les pays ; parfois même les questions posées ont été éludées. Mais dans l’ensemble, leur principe a consisté à privilégier les ajustements de prix pour accompagner les « destructions créatrices » (d’emplois, de capacités de production, d’activités…) induites par l’introduction de nouvelles technologies, l’ouverture de nouveaux marchés, les pertes de compétitivité….. Bref, pour permettre d’adaptation des structures productrices et des qualifications aux transformations de l’environnement économique. On a donc considéré que c’est en donnant plus de poids et de liberté aux mécanismes de marchés que l’on pourrait à la fois stimuler la croissance des économies et freiner la montée des inégalités. Cela s’est traduit par une promotion de l’entrepreneuriat (les fameuses « start up », mais aussi les petites entreprises refuges de la précarité et du sous-emploi), le renforcement de la concurrence, la flexibilisation du marché du travail (allègement des contrats de travail, réduction de certaines protections…). Même s’il faut ajouter que dans de nombreux cas des interventions publiques (aides à l’emploi, baisses de charges, programmes de formation) sont venues compléter les dispositifs de libéralisation pour en réduire le coût social.
Or, force est de constater, à ce stade, que les politiques mises en œuvre n’ont pas permis de stimuler la croissance potentielle : l’hypothèse de « stagnation séculaire » gagne progressivement en crédibilité, ce qui est paradoxal en phase de « révolution industrielle ». Mais surtout, ces politiques n’ont pu empêcher (sans doute ont elles même amplifié) la segmentation du marché du travail entre emplois qualifiés d’une part et emplois à faible qualification, instables et mal rémunérés d’autre part. A l’évidence, les mesures de flexibilisation ont accru les écarts et le cloisonnement entre ces deux types d’emploi, et en conséquence les déchirures entre les populations concernées. Cela n’est d’ailleurs pas étonnant car il est difficile d’acquérir une qualification lorsque l’on se trouve dans un statut précaire et affecté à des tâches routinières. Il est également difficile d’investir dans une formation (et la formation de ses enfants), ou de faire l’apprentissage des codes sociaux nécessaires lorsque l’on est maintenu dans une « trappe à pauvreté ». En d’autres termes, le dualisme du marché du travail a tendance à se reproduire, probablement en s’aggravant. Et il est douteux que l’affaiblissement des droits des titulaires d’emplois stables parvienne à inverser ou même à bloquer le mécanisme. Simplement parce que, à un moment donné, il n’existe guère de substitution possible entre les agents qui interviennent sur les deux types de marchés : ce n’est pas en réduisant la protection des uns que l’on permettra aux autres d’intégrer des emplois de « meilleure qualité ».
Qui plus est, ces inégalités sont un frein à la croissance. Parce qu’elles génèrent une perte de confiance (ou de « capital social ») qui limitent les incitations individuelles à investir, à coopérer [1]. Parce qu’elles bloquent, comme on vient de le dire, la capacité d’améliorer la qualification d’une partie de la population, donc son employabilité. Ce qui réduit également la diffusion des innovations dans l’ensemble de l’économie. Enfin, parce que les inégalités nécessitent, pour des raisons éthiques ou politiques des redistributions qui peuvent entraîner des distorsions ou des dés-incitations. De sorte qu’il existe une spirale déstabilisante entre la montée des inégalités et l’affaiblissement de la croissance : plus d’inégalités implique moins de croissance, donc moins d’emplois et moins de ressources disponibles pour compenser ou mieux combattre les inégalités.
Or, il ne semble pas que la libération des mécanismes de marchés soit le meilleur moyen de briser cette spirale. Ou du moins ce ne peut être le seul, ni même celui qui doit être privilégié. On est plutôt tenté de penser que c’est en stabilisant, autant que faire se peut, les relations de travail que l’on offrira aux agents la possibilité et la motivation d’acquérir les qualifications nécessaires à une bonne insertion [2]. C’est en investissant dans l’éducation et en favorisant, par une politique de l’habitat appropriée, la mixité sociale que l’on permettra le développement du capital humain et social. Contrairement à ce qui est trop souvent affirmé sans preuve, ce n’est pas aux plus vulnérables que profite des politiques de libéralisation. En bref, la restauration de la cohésion sociale est une condition essentielle et préalable pour faire accepter les « destructions créatrices » et amener les agents économiques à s’y adapter.
III – 2 Maîtriser la globalisation
Depuis bien longtemps, plus précisément depuis l’exposé par Ricardo de la théorie de l’avantage comparatif, les économistes sont généralement convaincus des bienfaits des échanges internationaux. L’opportunité offerte ainsi à chaque pays dans les productions pour lesquelles il dispose d’une compétitivité relativement plus élevée, accroît la richesse de l’économie mondiale. De même, on a fait valoir que les échanges financiers internationaux permettaient d’assurer une meilleure allocation des capitaux. En leur donnant la possibilité de financer les investissements les plus rentables, on améliore la situation des pays qui les exportent ainsi que celle des pays qui en sont destinataires.
Théoriquement, la libéralisation des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux serait donc favorable au développement économique mondial. Et cette proposition semble avoir été bien vérifiée au cours la seconde moitié du 20ème siècle, durant laquelle la forte augmentation du commerce international a coïncidé avec une croissance soutenue dans les pays avancés et un décollage économique spectaculaire dans certains pays émergents. Pourtant l’appréciation concrète des avantages de la libéralisation des échanges est devenue progressivement moins perceptible. Il est apparu que, dans les pays avancés, la mondialisation faisait aussi des perdants, c’est-à-dire des citoyens et des territoires qu’elle a déclassés et parfois paupérisés [3]. Car s’il est vrai que la mondialisation est bonne et souhaitable pour l’économie mondiale prise globalement, il est non moins vrai qu’elle entraîne des pertes pour certaines régions, certaines industries, certains agents économiques. Sur longue période les inégalités entre les pays ont fortement reculé, tandis qu’elles ont augmenté, au sein de certains d’entre eux. Le commerce international n’en est pas la seule cause, mais il y a contribué. Cela s’est traduit par des réticences grandissantes vis-à-vis de l’ouverture internationale et la montée de populismes inquiétants dans certains pays avancés. La carte des populations touchées par ces mouvements d’opinions recouvre d’ailleurs celle des perdants de la mondialisation.
Pour contenir ces dérives, il faut logiquement que les gagnants de la mondialisation compensent d’une façon ou d’une autre (par des transferts, des aides à la reconversion …) les perdants. Toutefois, on démontre qu’au fur et à mesure que progresse la libéralisation des échanges, le coût des compensations qu’elle suppose s’accroît plus vite que les gains qu’elle procure [4]. De sorte qu’il est un moment où il est préférable de renoncer à accroître l’ouverture internationale, puisque les gains que l’on en retire deviennent inférieurs aux coûts qu’elle implique. Sauf à négliger ou à éliminer (ce qui présente quelques dangers) toute considération de cohésion sociale, il existe donc une limite à la globalisation commerciale. Or, on imagine bien que la détermination de cette limite est un exercice compliqué ; de plus elle se présente de façon différente d’un pays à l’autre. Ce qui rend délicate la conclusion d’accords internationaux de libre-échange.
La globalisation financière en est venue à susciter des réserves plus sévères encore. En premier lieu parce que le très fort développement des mouvements de capitaux, l’explosion des transactions financières internationales n’ont pas eu d’influence visible sur la croissance. Par exemple, il n’apparaît pas de relation significative entre les entrées de capitaux et les taux de croissance des pays qui en ont bénéficié. Une grande partie de ces mouvements est d’ailleurs volatile et n’a pas pour objectif de s’investir durablement dans des projets porteurs de croissance. Les gains, s’ils existent, de la globalisation financière ne sont donc pas faciles à percevoir. Ils ne proviennent sans doute que de la partie stable des mouvements de capitaux (les Investissements Directs à l’Etranger) qui n’en constitue qu’une faible proportion.
Les effets négatifs de la globalisation financière sont, en revanche, plus faciles à identifier. D’abord parce que de nombreuses observations et divers travaux empiriques ont montré qu’elle a accru la fréquence et la gravité des crises financières. Les entrées de capitaux ont tendance à provoquer des bulles de crédit et des expositions au risque de change qui déstabilisent les systèmes bancaires, comme on a pu le constater aussi bien pour des pays avancés que pour des émergents. Ensuite parce que la plus grande mobilité du capital, sa capacité à se déplacer d’une économie à l’autre, en fonction des opportunités, affaiblit la position des salariés ; ce qui se traduit par une réduction des revenus du travail (une baisse des salaires dans le revenu national) et une plus grande instabilité des emplois. Enfin parce que cet accroissement de la mobilité des capitaux induit une baisse de leur taxation (par la mise en concurrence des fiscalités nationales) ; ce qui oblige à reporter le financement public sur les prélèvements obligatoires pesant sur les salaires et la consommation. Au total, ces différents mécanismes conduisent à une économie plus instable et à une distribution des revenus moins favorable aux salaires et en particulier à ceux des moins qualifiés.
Ce problème de politique économique illustre bien l’antagonisme et le nécessaire compromis entre la place des marchés et celle des organisations. Si l’on veut tirer avantage de la globalisation il faut éviter une libéralisation excessive des échanges internationaux de biens et services comme des mouvements de capitaux. Parce que les uns et les autres engendrent des inégalités et, au-delà, des déchirures de la cohésion sociale, capables d’engendrer des réactions de rejet et de repli allant à l’exact inverse de ce que l’on recherche. Or, ces inégalités et déchirures appellent des compensations que la collectivité doit être en mesure de financer ; et c’est pourquoi l’extension des marchés serait inconséquente. Le libre-échange à tout prix et sans limite ne peut être qu’une impasse.
III – 3 Répondre au défi climatique
Parmi les désordres écologiques observés au cours de ces dernières décennies, c’est le changement climatique qui a principalement retenu l’attention de la communauté internationale. Il existe désormais un quasi consensus pour admettre que ce changement, probablement dû à l’action humaine, pourrait causer, dans un avenir proche, des catastrophes naturelles de grande ampleur (inondations, températures extrêmes, montée des eaux…). En bref, ces évolutions sont susceptibles d’affecter gravement les conditions de vie des générations futures ; les scientifiques (notamment le GIEC) expliquent qu’elles deviendraient même insoutenables si l’augmentation de la température moyenne de la planète augmentait de plus de 2 degrés d’ici la fin du siècle. Il est donc impératif de limiter, et même de faire décroître, les émissions de gaz à effet de serre (le CO2), tenus pour responsables du réchauffement, dans les 20 années à venir. Plus précisément, il s’agit de trouver la ou les méthodes pour amener les agents économiques (producteurs et consommateurs) à adapter leur comportement à l’objectif poursuivi.
Pour les économistes il s’agit là d’un problème classique de traitement d’une externalité négative. Il s’agit de réguler la consommation d’un « bien commun » (ici la qualité de l’environnement) pour lequel il n’existe pas, par définition, de droit de propriété ni de possibilité de marché organisé. C’est-à-dire d’éviter que ce bien soit dilapidé, alors que chaque agent a conscience qu’il n’aura pas à supporter le coût de sa surconsommation. La solution, tout aussi classique, est de faire appel au principe dit du « pollueur-payeur » : l’Etat doit intervenir pour faire payer le coût de cette externalité (la consommation du bien commun) à ceux qui en sont responsables.
Dans le cas qui nous intéresse, et dans la mesure où l’on est capable de mesurer les émissions de CO2 par pays et même par entité de production, la solution des économistes consiste à déterminer un prix du carbone (de la tonne de CO2 émise) à partir duquel est calculée la taxe dont chaque émetteur doit s’acquitter [5]. Ce prix étant censé conduire les agents à limiter leurs émissions pour atteindre l’objectif fixé (le respect du seuil de 2 degrés). Une solution alternative consiste à fixer des quotas d’émissions par entité et de mettre en place un marché de droits d’émissions qui permette aux entités qui souhaitent dépasser leur quota d’acheter des droits auprès de ceux qui n’utilisent pas la totalité du leur. Le prix qui se fixe sur ce marché sert alors d’instrument de régulation des décisions. On montre que cette solution est plus efficiente que celle qui consiste à contraindre de façon rigide les émissions de chaque agent.
Il faut cependant souligner que dans l’un et l’autre cas, le prix du CO2 doit être uniforme (ou du moins très proche) d’un pays à l’autre. Si tel n’était pas le cas, on assisterait à des réallocations internationales des lieux de production : les entreprises les plus émettrices se relocalisant dans les pays dans lesquels le prix du CO2 est le plus faible (probablement les pays les plus pauvres). Ce qui conduirait à réduire au plan mondial, le seul pertinent en l’occurrence, l’effort de limitation des émissions. Mais, s’il est vrai que du point de vue de l’efficience l’unicité du prix est nécessaire, il n’en est pas ainsi du point de vue de l’équité. Parce que pour les pays en développement, la charge de la taxe et/ou des transformations à engager peut être insupportable. Mais aussi parce que le changement climatique est dû principalement à l’accumulation des gaz à effet de serre émis dans le passé par les économies avancées. Par conséquent, ce sont ces économies qui sont responsables de la correction qu’il faut aujourd’hui opérer, et donc du prix du CO2. Dès lors, pour que la solution soit viable, il faut concevoir l’existence de compensations, sous forme de transferts ou de constitution d’un fonds de financement d’investissements, à destination des pays en développement. Ce qui complique naturellement la résolution du problème ainsi que les négociations censées la faire aboutir.
Quoiqu’il en soit, la réponse privilégiée par la plupart des économistes n’a connu qu’un succès très limité dans les discussions et accords sur le traitement du changement climatique, depuis le sommet de Rio en 1992. En 1997, le protocole de Kyoto a pourtant contribué à la mise en place en Europe d’un marché de droits d’émissions, mais le prix sur ce marché n’a jamais atteint un niveau suffisant pour jouer son rôle incitatif. En 2009, la conférence de Copenhague (COP15) a fixé le fameux seuil des 2 degrés, mais elle s’est contentée d’enregistrer les engagements non contraignants des pays signataires. Enfin en 2015 à Paris, la COP21 a pratiquement abandonné, ou passé sous silence, l’idée d’une fixation du prix du carbone.
Vingt ans après, le résultat de toutes ces conférences et négociations apparaît dérisoire et paradoxal. L’ampleur du problème a bien été identifiée et la solution pour le traiter a été clairement définie. Mais celle-ci semble finalement avoir été écartée ; c’est donc que le blocage ne se situe pas où on le pense. Ce qui fait défaut, ce n’est pas la capacité de résoudre ce problème presque banal d’externalité inter temporelle. C’est plutôt la volonté de le faire.
Or, ce biais de comportement tient en partie à l’horizon de décision trop court des systèmes politiques. En l’occurrence, ils ont intérêt à minorer ou ignorer leurs responsabilités vis-à-vis des générations futures afin d’obtenir dans l’immédiat des performances plus valorisantes. Simplement parce que les bénéficiaires des politiques de réduction du CO2 ne sont pas les votants d’aujourd’hui. Il s’ensuit cette faiblesse de la solidarité intergénérationnelle qui est à l’origine du refus de traiter sérieusement un problème dont on souligne pourtant chaque jour l’importance.
Une façon de résoudre cette incohérence pourrait être de transférer à une institution internationale indépendante le soin de fixer le prix du carbone ou de distribuer les droits d’émission, en fonction d’objectifs qui lui seraient donnés. Cela reviendrait pour les Etats à déléguer leur souveraineté en ce domaine. Le politique n’aurait alors plus la tentation d’arbitrer aux dépens des générations futures, et on ne pourrait le lui reprocher puisque la décision ne lui appartiendrait plus. Mais la mise en place d’un tel arrangement est aujourd’hui tout à fait irréaliste.
L’autre solution reviendrait à renvoyer la correction de l’incohérence aux citoyens eux-mêmes. Car les biais comportementaux des politiques n’est qu’un reflet du leur, sans doute amplifié. De sorte que leur « conversion » à une autre représentation du monde changerait sans doute la façon dont la sphère politique prend en considération le futur. Mais c’est bien alors d’une conversion dont on parle, puisqu’il s’agit de renoncer à une conception anthropocentrique qui place l’environnement, les ressources naturelles au service de l’homme, sans véritable réciprocité[6]. Il s’agit aussi de dépasser le dialogue technocratique entre les sciences et le politique pour y joindre des considérations éthiques et culturelles ; ce qui contribuerait à retisser le lien intergénérationnel. Le défi est d’envergure. D’autant que pour atteindre son but, cette conversion doit être commune à l’ensemble disparate des sociétés concernées.
[1] De nombreux travaux ont été réalisés sur ce point. On se bornera à citer l’étude du FMI de Eric Gould et Alexander Hijzen « Growing Aport, Losing Trust ? The Impact of Inequality on Social Capital », Working Paper, n° 16/176, août 2016. On y trouvera en plus d’une étude empirique intéressante, une bibliographie complète sur la question.
[2] Ceci suppose que les entreprises disposent d’un horizon de gestion suffisamment long pour assumer cette plus grande stabilité des emplois. Or, une gouvernance orientée en fonction de la maximisation de la valeur actionnariale ne saurait répondre à cette question.
[3] On fait ici abstraction des possibles distorsions de concurrence (dumping fiscal ou social, manipulation des taux de change) qui rendent l’échange international inéquitable.
[4] On trouvera cette démonstration dans l’article de Dani Rodrik « Populism and the économics of globalization », Working Paper, NBER n° 23559, juin 2017.
[5] Cette question est exposée en particulier dans le chapitre 8 de l’ouvrage de Jean Tirole « Economie du bien commun », PUF, 2016.
Il est également abordé dans celui de Pierre-André Chalendar « Notre combat pour le climat », Le Passeur, 2015.
[6] C’est à une telle conversion qu’appelle l’encyclique Landato Si’. Cf. notamment l’article de Dominique Grenier « Nous sommes tous de la terre : une lecture de l’encyclique Landato Si’ », Transversalités, n° 139, octobre-décembre 2016, pp. 25-37.
IV. Pour conclure
Cette contribution se proposait de montrer qu’à l’origine des vulnérabilités économiques se trouvaient souvent des fragilités ou des déchirures du lien social. De sorte que le traitement de ces vulnérabilités suppose que l’on dépasse les frontières tracées par la science économique orthodoxe.
Bien sûr il ne s’agit pas de dire qu’il y a derrière chaque dysfonctionnement économique un problème de cohésion sociale. Mais c’est certainement vrai pour les plus graves et les plus persistants d’entre eux. Dans ces cas-là les analyses et propositions des économistes doivent s’élargir à des considérations qui vont au-delà de ce que suggère leur paradigme dominant. Les trois questions de politique économique que nous avons discutées en donnent, nous semble-t-il, de bonnes illustrations. Réduire la fragmentation sociale, et notamment le dualisme des marchés du travail, est essentiel pour retrouver une croissance à la fois plus robuste et plus inclusive. Savoir réguler la globalisation et redistribuer les gains qu’elle procure est nécessaire pour éviter qu’elle ne génère, à l’inverse de ce que l’on cherche, la tentation du repli et la montée des populismes. Consolider le lien entre générations et reconsidérer le lien de l’Homme à son environnement est crucial pour commencer à répondre sérieusement aux désordres écologiques. Dans ces trois défis de politique économique, qui sont parmi les plus importants que l’on ait aujourd’hui à affronter, les solutions économiques sont au moins insuffisantes, parfois trompeuses et même contreproductives lorsqu’elles sont appliquées avec dogmatisme.
Nous voudrions pour conclure évoquer deux questions qui tiennent aux conditions dans lesquelles se créent et se transforment ces liens qui structurent la vie sociale :
– La première a trait aux lieux dans lesquels s’opère cette construction. On s’accordera aisément pour dire qu’elle résulte des contributions combinées d’une multitude d’instances d’origines et de natures diverses : entreprises, administrations syndicats, religions…Les uns et les autres produisent et diffusent, comme il a déjà été dit, les règles, les codes, les représentations qui fondent la coexistence de la collectivité. Les uns et les autres ont des fonctions différentes, c’est-à-dire qu’ils n’interviennent pas, en principe, sur les mêmes aspects et aux mêmes stades de la formation du lien social. Mais en réalité, leur place étant imparfaitement définie, leurs effets sont susceptibles de se recouvrir, d’entrer en concurrence ou de se contredire. Ce qui pose un problème de mise en cohérence de l’ensemble. Par exemple, comment concilier le fait qu’un nombre croissant de questions d’intérêt général (en particulier celles qui concernent l’environnement), se posent au niveau supranational, alors que simultanément on transfère des responsabilités au plan local pour promouvoir une démocratie de proximité ? Ou encore, pour prendre un autre exemple, est-il raisonnable de vouloir une union politique en Europe alors que les pays membres se refusent à la construction d’un modèle social uniforme et qu’ils ont retenu le principe d’une mise en concurrence des modèles nationaux en ce domaine ? La qualité de la cohésion sociale peut aussi se jouer dans les réponses à ce type de problèmes
– La seconde question concerne les conditions de transformation de la structuration sociale. Prises séparément ou dans leur ensemble, les organisations qui composent cette construction n’ont évidemment pas vocation à l’immobilisme. Bien des arguments peuvent le justifier. Mais il reste que pour remplir leur fonction d’intermédiation il faut qu’elles disposent d’une certaine stabilité. Une trop grande plasticité des structures sociales est génératrice d’insécurité et donc de défiance entre les individus qu’elles mettent en relation. Ce qui invite à la prudence dans la conduite des évolutions qu’on leur imprime. Ce qui suggère aussi de ne pas laisser certains principes ou repères culturels dériver au gré de mouvements d’opinion éphémères ; de ne pas invoquer à tout propos l’idée de flexibilité ; de ne pas soumettre les politiques d’entreprise au court termisme et aux jeux spéculatifs des marchés financiers… Un système économique associé à des liens fragiles et/ou trop mouvants est à la fois inefficace et vulnérable.