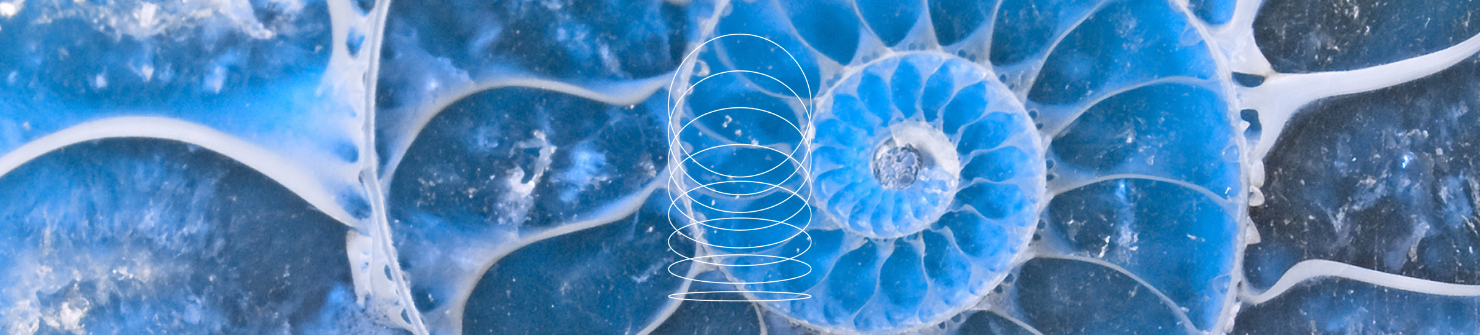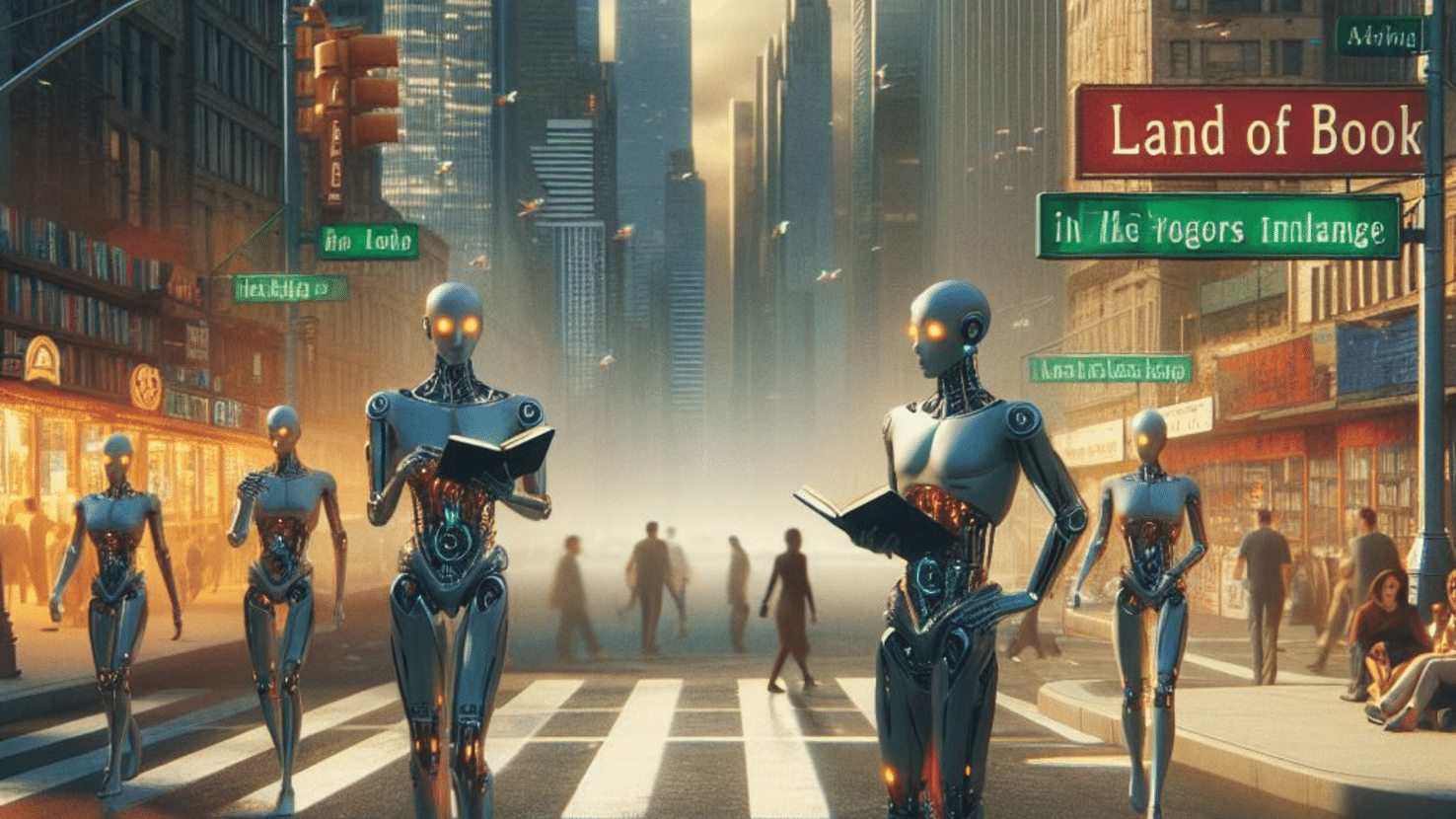Nous sommes aux prémices d’une évolution pleine et entière de nos sociétés. Elles sont désormais contraintes, ou le seront très prochainement, de s’adapter aux transformations technologiques et environnementales. Comment comprendre et appréhender intelligemment tous ces changements qui impacteront nos modèles économiques et sociaux ? C’est à cette question que Pascal Picq s’attaque à travers cette contribution.
En rappelant les différentes étapes des évolutions tant économiques que sociétales, l’auteur estime que le XXIe siècle sera caractérisé par la fin d’une certitude : un avenir maîtrisé par les humains. L’économie serait désormais marquée par l’innovation, dans un monde qui change très vite, dans lequel la survie serait déterminée en partie par nos capacités à favoriser les diversités émergentes et leurs interactions.
Si plusieurs changements de paradigmes sont à l’œuvre (un monde horizontal où l’innovation émerge aux quatre coins du monde, une prise de conscience d’un monde écosystémique, la production constante de nouvelles inégalités, l’émergence d’une révolution numérique et des intelligences artificielles…), Pascal Picq dresse de nombreuses propositions pour réussir les différentes adaptations auxquelles les humains devront faire face.
« Plutôt que de chercher une cause, mieux vaut considérer les variations dans un éventail de contraintes multiples. »
Michel Serres in Pascal Picq, Michel Serres et Jean-Didier Vincent – Qu’est-ce que l’Humain ? Editions du Pommier 2003 ; p. 90.
Nos sociétés du XXIe siècle à peine commencé s’interrogent sur deux facteurs affectant ses transformations, la technologie et l’environnement. Si les technologies et les moyens de production s’inscrivent dans les travaux fondateurs d’Adam Smith, de Karl Marx ou de Joseph Schumpeter, ce n’est que très récemment pour l’écologie. Dans les deux cas, les réflexions économiques et sociétales et, finalement, idéelles et politiques, concentrent des divergences d’interprétations. Les débats autour des intelligences artificielles comme des dérèglements climatiques et des biodiversités confrontent des conceptions diverses et souvent opposées issues de traditions anthropologiques plus profondes sur la place des humains dans l’ordre de la création, de la nature ou de l’évolution comme de leurs moyens d’actions. Le champ très diversifié des théories économiques n’y échappe pas.
D’un point de vue strictement évolutionnaire, les sociétés humaines ont inventé la coévolution bio-culturelle, des capacités d’adaptation reposant à la fois sur les plasticités morphologique, physiologique et cognitive léguées par l’évolution et, aussi, en transformant leurs environnements grâce aux techniques et leurs usages (Phénotype étendu). Les humains se distinguent des animaux comme des transformateurs de monde ; à la fois par leurs actions et aussi leurs représentations du monde (idéels). Les choix politiques, sociétaux et économiques se situent à l’articulation de ces représentations du monde et du rôle des techniques. Depuis deux millions d’années, les technologies généralisées – general purpose technologies – comme le feu hier ou le numérique de nos jours, transforment les sociétés humaines avec des conséquences économiques, sociétales, démographiques, idéelles et écologiques.
L’actualité récente résonne de ces problématiques avec l’accélération de la révolution numérique, stimulée par les intelligences artificielles, comme Chat-GPT et les métavers. Reste à savoir si elles seront ou pas au service de l’humanité de demain. Les avis divergent considérablement entre le solutionnisme des progressistes technophiles, voire exacerbé des transhumanistes libertariens, et les techno-sceptiques répondant à diverses traditions philosophiques technophobes allergiques à tout changement. Le vote récent de la loi sur l’environnement liée au Green Deal au Parlement européen offre une illustration aussi tranchée que récente.
Est-ce qu’un regard venant de l’anthropologie évolutionniste peut contribuer à éclaircir ces questions des plus urgentes sur fond d’urbanisation massive des populations humaines, de dérèglement climatique et de fragilisation des écosystèmes et de leurs biodiversités ? Indéniablement, une question d’évolution humaine.
De quoi parlons-nous ?
La pensée économique dominante reste marquée par des concepts fossilisés bien que de plus en plus remis en question, comme l’agent économique rationnel, les équilibres des marchés, l’indifférence aux facteurs sociétaux ou environnementaux et l’idée que ne prévaut qu’un seul modèle mu par la croissance, les crises n’étant que des ajustements. Pour mémoire, citons « la fin de l’histoire » de Francis Fukuyama sur le triomphe ultime des sociétés libérales et démocratiques ou encore la « fin du travail » de Jeremy Rifkin dans les années 1990 ; ce qui n’a pas manqué du surprendre les anthropologues évolutionnistes.
On retrouve peu ou prou cet ensemble de concepts dans les représentations de l’évolution et plus particulièrement de l’évolution humaine : Sapiens comme aboutissement ultime de l’évolution des espèces et, si on désire encore évoluer, dépasser les contraintes de sa nature humaine, s’en remettre aux technologies. L’hominisation triomphante se prolonge par le transhumanisme.
L’idée dominante est celle d’un ancêtre audacieux – toujours un mâle – qui se redresse pour marcher, dominateur dans les savanes, le regard fixé sur son devenir, obligé de se défendre d’une nature hostile et contraint d’inventer des outils et des armes pour assurer sa survie. Du mythe de Prométhée à celui de l’hominisation, une conception qui glisse vers le sexisme et les questions sociétales, l’environnement et les biodiversités et la question des techniques. Le succès irrationnel des transhumanistes en représente la version la plus exacerbée.
Ce récit est un parfait exemple de discours évolutionniste, mais pas au sens des théories biologiques de l’évolution. Cet évolutionnisme émerge au XVIIIᵉ siècle dans le cadre des Lumières, animé de l’idée d’améliorer la condition humaine. La pensée économique émerge dans ce contexte. Depuis, tous les grands systèmes idéologiques du progrès, de droite comme de gauche, s’inscrivent dans cet évolutionnisme social et culturel (hormis les épisodes récurrents et utopiques de retours aux sources ; sans connaissances de ces « sources » en anthropologie). Il se forge avant que ne se construisent les théories biologiques de l’évolution, non sans les influencer. Plus précisément, ça fait à peine un demi-siècle que les théories de l’évolution se dégagent du carcan évolutionniste, ce qui n’est pas sans incidences, plus récentes, sur l’économie et les stratégies adaptatives des entreprises. Comme les espèces, les entreprises entrent dans le registre des systèmes adaptatifs complexes.
Cependant, ce qu’on appelle l’économie évolutionniste s’inscrit plus résolument du côté de l’évolutionnisme culturel que de l’évolutionnisme biologique avec, en toile de fond, les approches lamarckiennes et darwiniennes ; en référence respectivement à Jean-Baptiste de Lamarck et à Charles Darwin.
Thorstein Vleben et Joseph Schumpeter comptent parmi les premiers économistes intéressés par ce rapprochement ; en fait, des pensées plus évolutionnistes que darwiniennes. On loue leur prudence épistémologique, d’autant que si la pensée économique découle d’une riche histoire et nombre d’écoles, il en va de même pour les théories biologiques de l’évolution. Terrain interdisciplinaire miné de chausse-trappes épistémologiques.
L’économie évolutionniste jouit d’un renouveau un siècle plus tard au cours des années 1990 (Richard Winter et Sidney Nelson) avec quelques protagonistes en France. Elle fait l’objet d’une revue dédiée depuis une trentaine d’années Evolutionary Economics. Comment passer de la simple métaphore à l’analogie – au mieux heuristique – à une véritable ontologie ?
Décroissance, économie en équilibre, chasse et cueillette
Il revient à chaque fois que les sociétés humaines entrent dans une période de changement. On remarque que cela se répète à chaque fin de siècle, soupçonnant plus un trait de la psychologique collective de nos sociétés qu’une loi cyclique immanente, des cavaliers de l’apocalypse de l’An mil au bug de l’an 2000. Changer le calendrier n’y fera rien. Ces angoisses procèdent de représentations du monde qui n’ont rien à voir avec des phénomènes naturels, comme les catastrophes naturelles. Elles sont purement anthropiques.
D’abord, de profonds changements conceptuels à la fois dans le champ des théories de l’évolution comme dans celui des théories économiques. Les tentatives de rapprochement se fondent sur la perception de problématiques communes, mais qui pour l’heure n’ont pas vraiment convaincu. Un point commun cependant, la nécessité de comprendre les mécanismes agissants, de passer respectivement des approches macroévolutionnistes et macroéconomiques à des approches microévolutionnistes et microéconomiques.
Le passage d’une économie évolutionniste/transformiste classique avec ses concepts d’équilibre des marchés et d’agent économique rationnel à une véritable économie évolutionnaire s’articule sur ce déplacement épistémologique, comme les travaux de Daniel Kahneman et de l’économie expérimentale. Le fait que, par exemple, nos décisions reposent sur les mêmes traits psychologiques que les singes capucins ou autres, comme les chimpanzés, interpelle notre évolution et, plus largement, l’évolution. Le XXIᵉ siècle se caractérise par la fin des certitudes en un avenir maîtrisé par les humains. On se demande donc comment ont fait nos ancêtres et, plus largement, les autres espèces ont fait pour s’adapter.
L’acronyme VUCA (Vulnerability, Uncertaincy, Complex, Ambiguous) fait son retour pour décrire un monde Vulnérable, Incertain, Complexe et Ambiguë (VICA en français). D’un point de vue évolutionnaire, il en est toujours ainsi pour toutes les espèces. Cependant, seules les sociétés humaines s’efforcent de penser le monde selon des schémas idéels, que ce soit pour un monde fixe ou progressiste, très rarement en regard d’un monde évolutionnaire et contingent. Le changement, d’accord, mais à condition que ce soit dans la continuité.
Comment font les espèces pour s’adapter au monde VUCA qu’elles contribuent elles-mêmes à changer ? Le génie de Darwin est d’avoir compris cette idée aussi géniale que fondamentale : les diversités et leurs interactions. Les théories de l’évolution sont des théories des variations : les chances de s’adapter à un monde incertain reposent sur ces variations qui sont autant de potentialités probables pour l’adaptation.
Pourquoi la question des diversités au sein des entreprises prend une telle importance depuis quelques années ? Tout simplement parce qu’on est passé dans une économie de l’innovation, dans un monde qui change très vite, un monde VUCA dont nous sommes les principaux agents. Nous sommes entrés brutalement dans des mondes darwiniens et pour survivre dans de tels mondes, il faut être darwinien ; donc favoriser les diversités émergeantes et leurs interactions. Notre vieille Europe lamarkienne a du souci à se faire. (Ce n’est pas l’anthropologue évolutionniste qui le dit, mais les rapports de la Commission européenne.) Notre arrogance nourrie de l’évolutionnisme culturel occidental a fait qu’on n’a pas vu arriver les Japonais avec l’électronique dans les années 1980 ; les Indiens dans la sidérurgie au tournant des années 2000 ; aujourd’hui les Chinois avec les intelligences artificielles. Les diversités à la tête des grandes entreprises de la tech américaine donnent pale figure aux dirigeants et dirigeantes des grandes entreprises européennes. Discriminer dans une économie de l’innovation mondialisée, c’est perdre en adaptabilité, ce qu’on appelle « the costly business of discrimination ». La perte potentielle de la seule discrimination envers les femmes s’évalue à des milliers de milliards d’Euros à l’échelle mondiale.
Premier changement de paradigme, nous sommes passés d’un monde lamarkien à un monde darwinien ; et pas du fait de la nature.
Deuxième changement de paradigme : la Terre est redevenue plate. À la conception de la verticalisation de l’histoire humaine selon les canons de l’évolutionnisme occidental jusqu’à la déclaration de Francis Fukuyama, s’impose un monde horizontal dans lequel les innovations émergent dans différentes parties du monde (comme les agricultures il y a dix mille ans).
Troisième changement de paradigme, la prise de conscience d’un monde écosystémique. Le concept d’écosystème des entreprises et des affaires n’est pas nouveau. Il revient à la suite des défaillances de nos économies pendant la crise de la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Il commence à en être de même avec les environnements affectés par les dérèglements climatiques et les disparitions des biodiversités. Cependant, on reste encore loin d’une véritable approche écosystémique. Un écosystème se compose d’une biocénose – l’ensemble des espèces d’une communauté écologique – et d’un biotope – les caractéristiques physiques ou non biologiques des habitats. On commence à peine à intégrer les conséquences négatives des dérèglements climatiques, évalués à des centaines de milliards de dollars à la suite des rapports Nicholas Stern (2 à 20 % du PIB mondial). Il en est de même pour les biodiversités avec le rapport Parth Dasgupta ; qui reste peu cité. (Pour mémoire, le GIEC est créé en 1989 et l’IPBES en 2012). Les changements climatiques comme les pertes de biodiversités sont évalués en références à nos systèmes économiques actuels, ce que cela leur coûte en pertes potentielles ou en services rendus. Plus explicitement, on campe sur le postulat d’un écosystème humain affecté par des externalités négatives qu’il produit
lui-même sans penser de nouvelles économies intégrant ces changements, comme l’économie circulaire.
Il y a aussi les questions sociétales, qui n’ont pas fait l’objet de rapports comme pour le climat et les biodiversités. Les changements d’économies et de sociétés produisent toujours de nouvelles inégalités. La bipolarisation socio-économique qui affecte nos sociétés depuis deux décennies résultent de ces évolutions.
Un tel état n’est pas propice pour s’engager sur un chemin d’avenir pour tous. Et là, on se heurte à notre psychologie issue de notre évolution face au changement et son aversion pour les pertes. C’est bien pour cette raison que nos politiques ne parlent plus de destruction créatrice ; notre cerveau simiesque se focalisant sur les pertes. Rien à faire, même si depuis deux millions d’années toutes les révolutions technologiques généralisées ont produit plus d’activités qu’elles n’en ont détruites, n’en déplaise aux gourous de l’avenir du travail qui campent sur les craintes du remplacement par les machines avec le partage comme seule solution, saupoudré de tâches à distances. Il n’y a jamais eu autant de travail sur la Terre depuis l’émergence de l’humanité. Une fois de plus, des analyses basées sur un monde perdu plutôt que sur un monde qui advient ; rien de plus erroné d’un point de vue évolutionnaire.
Ces affirmations sur le remplacement ou la seule solution du partage du travail ignorent une réalité de la dynamique des écosystèmes : plus il y a d’acteurs ou d’agents économiques, plus l’écosystème se diversifie, se consolide et résiste à des entrants perturbateurs. Autrement dit, les économies où il y a plus de séniors qui travaillent, plus de juniors que travaillent, plus de femmes qui travaillent, plus de diversités qui travaillent et plus de machines qui travaillent – comme les robots et les cobots – plus les différentes populations d’agents économiques tendent à s’accroitre ; renforçant l’écosystème et son économie.
Quatrième changement de paradigme, la révolution numérique et les intelligences artificielles. Depuis presque deux décennies, nos économies baignent dans l’espace digital darwinien. Les appareils connectés, le cloud, les réseaux, les données croissant de façon exponentielle, les services en ligne stimulent une fièvre entrepreneuriale à l’échelle mondiale, perturbant « l’équilibre » de la fin du XXe siècle avec l’ubérisation, terme déjà oublié depuis la pandémie.
L’écosystème numérique a, de façon virale, déjà profondément changé nos vies individuelles, sociales, culturelles, économiques et politiques. Ce que l’on sait moins, c’est que la « nouvelle intelligence artificielle » est bio-inspirée et, plus précisément, inspirée de la biologie évolutionnaire (neurones artificiels, algorithmes évolutionnaires, darwinisme artificiel, écosystèmes numériques, espace digital darwinien …). L’écosystème numérique évolue déjà en partie par lui-même, à l’instar de l’IOT (Internet of Things).
En fait, les sociétés humaines n’ont jamais échappé aux mondes darwiniens. Ce qu’on appelle le darwinisme universel ou exodarwinisme ne s’apparente en rien à une tentative de réductionnisme biologique. La biologie évolutionnaire n’en compose qu’une partie. Dès qu’il y a émergence de diversités (innovations, startups, TPE …) ; dès qu’interviennent des mécanismes de sélection (nouveaux marchés, devenir des licornes, serial entrepreneurship…) ; dès qu’il y a transmission et développement (ETI, grandes entreprises, entreprises centenaires …) on est dans un monde darwinien.
Nos systèmes économiques modernes depuis la fin du XVIIIᵉ siècle et les idéologies du progrès afférentes, de droite comme de gauche, se sont construites contre un des fondateurs de l’économie moderne, Thomas Malthus ; ce même Malthus qui inspire la pensée de Charles Darwin quelques décennies plus tard. Malthus revient frapper à la porte des temples de la pensée économique. La parenthèse anti-malthusienne vient de se refermer avec la fin du Premier âge des machines et la prise de conscience de la limite des ressources terrestres.
Petit point d’histoire à propos de Darwin et de l’économie. Charles rechigne à voir sa théorie appliquée aux affaires humaines. De son vivant, deux dérives émergent, une qui donnera le « darwinisme social » avec Herbert Spencer du côté néolibéral, l’autre anti-darwinienne avec Karl Marx du côté communiste ; deux fléaux idéologiques avec leurs conséquences économiques, sociétales et environnementales depuis plus d’un siècle. Un autre Darwin s’avère plus intéressant, Erasmus, le grand-père de Charles. Ami, entre autres, d’Adam Smith, il fonde avec d’autres coreligionnaires la Lunar Society (Société lunaire) de Birmingham en 1765 (un an avant la naissance de Malthus). Ce groupe d’amis invente tout simplement la Révolution industrielle, animé par l’esprit des Lumières (idéel). Erasmus est le premier médecin moderne, poète, écologiste avant la lettre, déjà évolutionniste, passionné par les nouvelles technologies mues par l’électricité (il est ami avec Benjamin Franklin) ou la vapeur (James Watt est de la partie), manageur de la première manufacture mécanisée – celle de ses amis Matthew Bolton, premier entrepreneur moderne, et Josiah Wedgwood, l’inventeur du marketing) – et militant farouche contre les inégalités envers les femmes et aussi contre l’esclavagisme sans oublier une sensibilité sociale. Rien de moins. Tout y est. On oublie trop souvent de revenir aux fondamentaux ; en l’occurrence ceux du vrai libéralisme économique.
Précision importante, de tels changements s’accompagnent toujours de l’émergence d’une ou de nouvelles classes sociales comme l’érosion ou la disparition d’autres. Le prolétariat émerge avec la Révolution industrielle et finit par décliner avec la fin du Premier âge des machines, celui des machines main d’oeuvre. Le Deuxième âge des machines avec les machines cerveau-œuvre s’accompagne de l’essor de la classe des entrepreneuses et des entrepreneurs.
Et c’est un évènement aussi brutal qu’exogène qui nous ramène vers des fondamentaux évolutionnaires. La pandémie a agi comme la sélection naturelle sur les personnes, les entreprises et les sociétés. Ce qui nous amène au rebond.
Sélection naturelle et rebond
Le terme apparaît fréquemment dans la sphère économique, et tout particulièrement dans le secteur de la finance pour décrire les fluctuations des marchés boursiers. L’évolution des indices aligne des rebonds – des hauts et des bas – qui dessinent une courbe ascendante en dents de scie. Les petits rebonds systémiques sont dans la normalité, des ajustements. Les grosses chutes correspondent à des crises majeures. Que ce soit dans la phase systémique ou les crises, les rebonds sont de même nature, mais avec des conséquences socio-économiques différentes.
Il en va de même pour l’évolution des communautés écologiques. L’évolution procède selon le modèle dit des équilibres ponctués : longues périodes de relative stabilité – les équilibres – entrecoupées par des phases de changements rapides – les ponctuations. Rappelons que ces équilibres ne sont pas statiques.
Comme la sélection naturelle, la pandémie n’a rien créé, elle a sélectionné, et quelque peu éliminé. Avant la pandémie, les entreprises engagées dans de vraies transformations numériques et RSE restent minoritaires ; voire critiquées quant à leurs missions premières. Elles ont mieux supporté la crise et se sont retrouvées renforcées. Il y a eu sélection sur leur adaptabilité qui repose sur une culture de transformation interne tout en étant sensible aux facteurs de changements externes, sociétaux et/ou environnementaux. C’est le socle du rebond.
Avec des approches différentes liées à leurs sensibilités culturelles respectives, les problématiques RSE s’affirmaient dans le monde anglo-saxon comme sur le continent européen. Le débat shareholders/stakeholders opposait les tenants d’un néolibéralisme centré que sur les affaires et indifférent aux facteurs sociétaux et environnementaux – doctrine Milton Friedman – et un libéralisme responsable dans la lignée de la Lunar Society. En Europe et en France, ça passe par des réglementations qui viennent des institutions (loi PACTE). Cette « philosophie entrepreneuriale » favorise ces entreprises et leurs communautés entrepreneuriales par leur idéel (le sens), le socle du rebond.
Quelques propositions
Il est grand temps de se dégager d’une conception universelle, linéaire et améliorative de l’histoire de l’humanité, celle qui a conduit à l’idée de fin de l’histoire. La « mondialisation heureuse » a viré à un état du monde insoupçonné en deux décennies. Aucun anthropologue évolutionnaire aurait prétendu savoir quelle serait cette évolution, mais néanmoins certain que l’état de l’humanité n’arriverait pas à un équilibre, toujours en référence à deux raisons principales. L’une, endogène, est liée aux diversités existantes et émergeantes au sein des sociétés humaines ; l’autre, exogène, est associée aux changements climatiques et environnementaux. Très darwinien pour les facteurs endogènes tout en s’inscrivant dans la logique lamarkienne de la nécessité de s’adapter aux changements d’environnements.
Éviter les gourous très médiatiques de la philosophie et des sciences humaines qui distillent l’inquiétude du remplacement par les machines – n’ayant déjà rien compris aux intelligences animales et encore moins à l’évolution humaine, comment imaginer qu’ils/elles le pourraient avec celles des machines. Un critère pour les reconnaître : ils/elles parlent de l’animal, de l’Homme ou de l’intelligence artificielle au singulier sans jamais les définir, sans compréhension de leurs diversités.
Éviter les gourous du travail qui ne jurent que par le partage, la fin du travail ou son remplacement par les machines en contradiction de ce qu’est l’évolution des sociétés humaines depuis deux millions d’années ; ce qui inclut notre histoire moderne.
Éviter les gourous techno-hallucinés qui prétendent que les machines vont se charger de toutes les tâches laborieuses pour libérer notre créativité. Toute adaptation est un nouveau compromis avec ses avantages et ses désavantages. Il faut évaluer et prendre en compte ces derniers ; ne pas les occulter.
Passer d’un modèle lamarkien par filières à un modèle darwinien écosystémique au niveau local, régional, national et européen. En notant qu’une approche écosystémique s’appuie forcément sur l’économie circulaire.
Favoriser les diversités humaines, artificielles et hybrides humains/machines dans les entreprises et les institutions. Donc, agir contre toutes les formes de discriminations, ce qui interpelle les ressources humaines et les modes de management des équipes.
Soutenir la culture entrepreneuriale, ce qui revient à renforcer le Small Business Act européen dans les pays de la Communauté européenne. Ce qui requiert une culture de l’essai/erreur et non plus de la faute ou de la sanction personnelle.
Stimuler et soutenir la création et le développement d’entreprises dans l’économie sociale et solidaire et aussi dans les économies verte, bleue et grise.
Mettre en avant et soutenir les entreprises de taille importante déjà engagées dans de vraies problématiques RSE et faire en sorte qu’elles instaurent une culture de valeurs partagées (Share Value System) et diffusées auprès des clients et des clientes, des citoyens et des citoyennes et de toutes les parties prenantes internes et externes, ce qui vaut pour le secteur public et les collectivités locales.
Si des parties prenantes rencontrent des difficultés, organiser des systèmes de partage d’expérience et d’entre-aide. Car, dans un écosystème, quand les agents, tout en assurant leurs intérêts, rendent des services gratuits à d’autres agents, sa diversité augmente, il se montre plus résilient, plus innovant et résiste mieux à l’intrusion d’agents indésirables. Dans cette logique, si tous les agents n’y gagnent pas, aucun n’y perd.