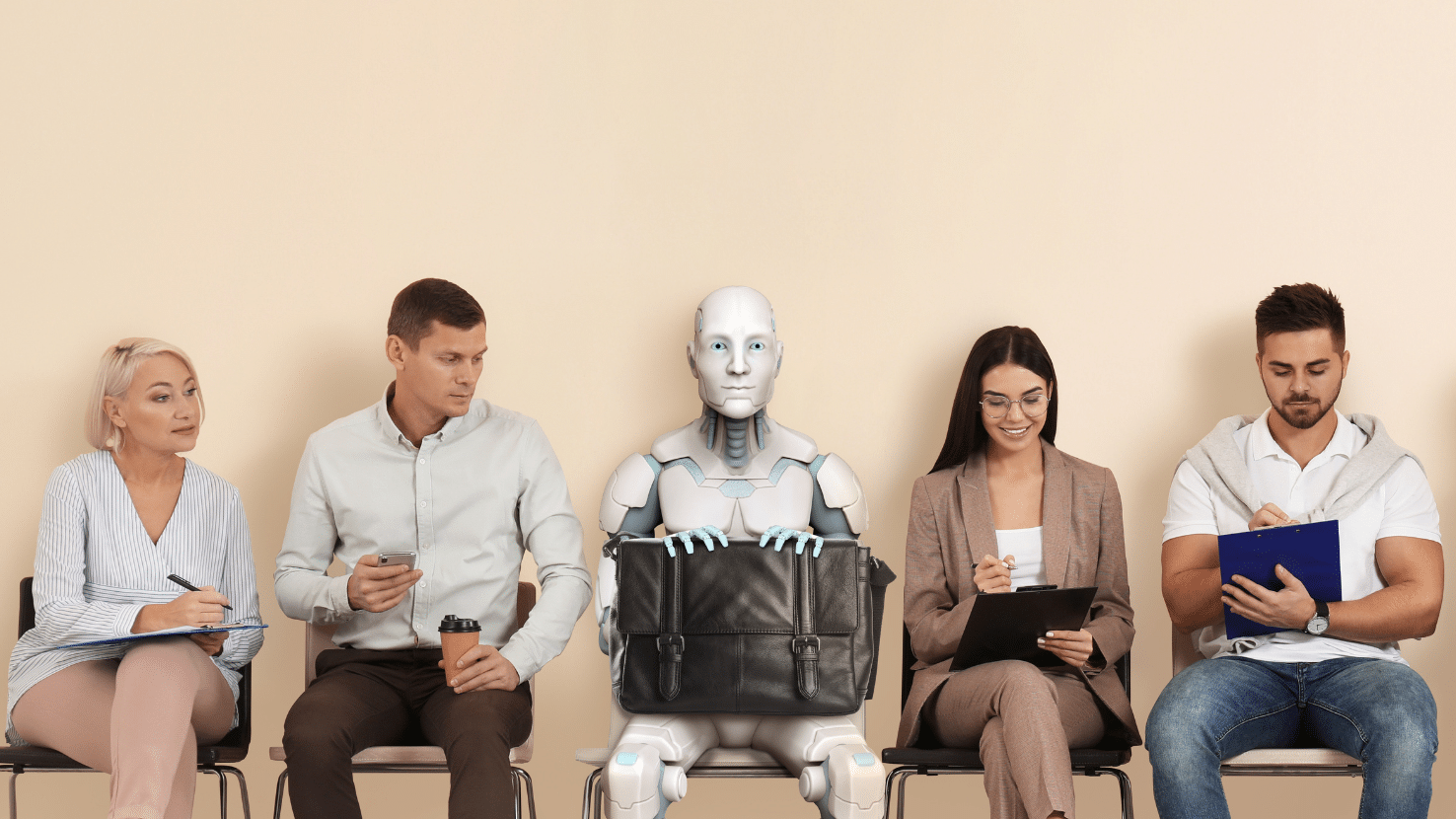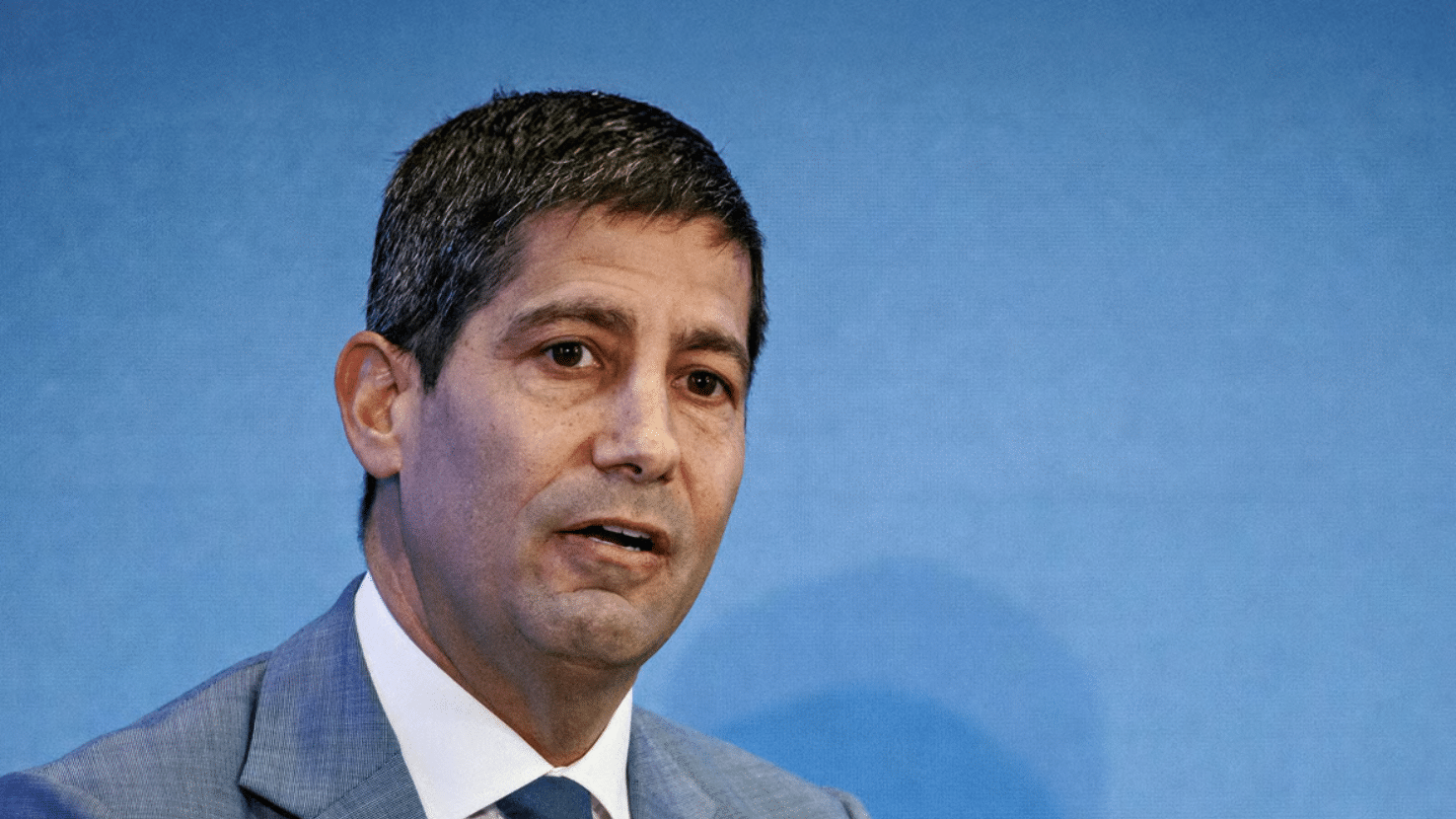Réchauffement climatique, crise du Covid-19, guerre en Ukraine : les récentes crises mettent l’adoption d’un « capitalisme européen » sur le haut de la pile des dossiers du futur président de la République. Mais ce capitalisme alternatif ne pourra réussir que s’il s’accompagne de la reconstruction d’une classe moyenne, seul rempart au délitement des sociétés contemporaines.
Face aux périls qui menacent, nous avons en main tous les outils pour riposter. Saurons-nous accepter les efforts nécessaires et les changements que cela implique ? Quel contrat social rebâtir pour redonner un horizon et un espoir à chacun ?
Après un indispensable retour sur les causes du dévoiement du capitalisme, qui a permis la reconstruction de nos sociétés après- guerre, Eric Le Boucher propose dans cette note des propositions ambitieuses pour rebâtir un « vrai libéralisme » à partir d’une « modération radicale » : réforme en profondeur de l’école, nouvelle manière d’exercer le pouvoir et, surtout, réforme du capitalisme actionnarial…
La question de l’adoption d’un « capitalisme européen » sera première dans le quinquennat qui va s’ouvrir. Le réchauffement puis la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont poussé l’Union européenne à lancer beaucoup de programmes de « souveraineté » : sanitaire, technologique, écologique, alimentaire, militaire, etc. Tant mieux, chaque pays-membre est trop petit, l’Europe seule est à l’échelle des défis planétaires du temps.
Mais il en est un tout aussi fondamental sinon bien plus : la reconstruction d’une classe moyenne pour mettre fin au délitement des sociétés, à la montée de la violence, à la perte de confiance dans les institutions, à l’irraison, au doute sur l’avenir, à la montée des populismes. L’époque perd la prudence, la justice, la tempérance et le courage, les quatre vertus cardinales de la Raison grecque selon Cicéron, piliers profonds de la civilisation occidentale depuis deux millénaires. La démocratie que l’on doit défendre sur le plan géostratégique contre les dictatures, doit l’être aussi à l’intérieur, contre ses propres maux au sein des pays développés.
La cause première de ces maux intérieurs est le capitalisme financiarisé qui a accouché d’une anémie de la croissance et d’une atrophie de la classe moyenne. Il faut le réformer en profondeur.
C’est urgent et c’est possible grâce à un alignement des planètes gouvernementales. Joe Biden aux États-Unis, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi, Pedro Sanchez, et d’autres en Europe, tous les dirigeants ont exactement le même but : relégitimer la démocratie par le retour d’une bonne croissance et par la reconstruction de la classe moyenne. Tous savent aussi que si médecine il y a, elle doit se plier aux cultures des différentes nations mais il faudra surtout qu’elle soit appliquée à l’échelle internationale pour trouver sa pleine efficacité.
Les États-Unis sont dans une situation particulière : Joe Biden a fait de la classe moyenne son objectif primordial, toute sa politique est orientée dans ce sens. Mais il dispose que d’une majorité faible au Capitole. Le pays est très profondément déchiré idéologiquement et politiquement, ce qui entrave le président. En outre, la force des lobbys de la finance et de la Tech sont des freins puissants au changement. Autrement dit, l’Europe doit travailler avec les États- Unis qui demeurent la première puissance mais elle doit avancer par elle-même si l’Amérique bloque. Il faudra alors trouver les moyens d’une « indépendance » du modèle économique, financier et social européen, en clair apprendre à se distinguer, sinon à se défendre, d’un capitalisme américain qui resterait immobile.
La particularité des périls d’aujourd’hui est que nous avons en main tous les outils nécessaires. Les économistes disent que pour assurer la prospérité, il faut du travail, du capital et des technologies. Tout est là en abondance. Les bras et les têtes ne manquent pas et si le niveau mondial d’éducation doit être évidemment encore amélioré, il est sans précédent dans l’histoire de l’Humanité. L’argent est abondant, il y en aurait même plutôt trop que pas assez. Quant aux sciences et techniques, les publications ont été multipliées par vingt dans ce dernier demi-siècle et on invente aujourd’hui, en quelques semaines, plus que dans toute l’Histoire passée.
Il faut enfin une volonté pour sortir des temps sombres, rappellent les historiens. Mais ce facteur lui aussi est présent : les peuples veulent profondément retrouver une « bonne vie », celle d’Aristote, celle du « contrat social » des démocraties libérales après 1945 : une vie dans la paix et la sécurité, une profession digne et honorablement rémunérée, un espoir d’amélioration pour les enfants et une perspective pour le repos des vieux jours. C’est ce contrat qui est cassé et qu’il faut renouer.
Les transformations nécessaires pour répondre à ces défis cumulés, climatiques, internationaux, économiques et sociétaux, pour redonner un sens positif à l’avenir, sont importantes et elles sont difficiles. Chacun devra accepter des efforts et des changements. Mais le pessimisme n’est pas de mise, les solutions existent. L’Humanité a tout en main pour y parvenir.
Nous voulons affirmer une conviction optimiste (voir notre livre « Échec à la barbarie », paru chez Grasset).
Le début de siècle a connu des bouleversements déchirants, il y en aura d’autres. Les tensions ne se relâcheront pas de sitôt. Le monde restera dangereux. Mais la chute dans l’irraison n’est pas irrémédiable. Les désarrois et les rages ont des causes. Les irraisons ont des raisons. Il s’agit de les nommer et de les traiter à leurs racines, ce qui n’a pas été fait jusqu’ici. Le peuple n’est pas devenu fou, il est malheureux et, faute d’avoir été entendu, il est tombé dans la colère. C’est la société qui est devenue « folle » de rendre insatisfaits une majorité de ses membres.
Il faut s’opposer au discours des extrêmes qui proposent le renfermement, le nationalisme et le protectionnisme. Ces « solutions » n’ont jamais marché nulle part. Il faut s’opposer aussi aux discours défaitistes qui se répandent dans l’élite en France : le pays serait irréformable, les Français affolés et butés s’opposeraient à tout, l’Europe, qui aurait pu nous sauver, ne le fera pas. Le retrait des États-Unis d’Afghanistan montrerait que la démocratie libérale n’a plus de force. La Russie ose attaquer l’Ukraine sans qu’on lui fasse la guerre, la Chine autoritaire trace son chemin vers la suprématie.
Si l’élite occidentale ne croit plus en l’avenir, qui y croira ? Le 21e siècle peut être au contraire celui de la transformation réussie du capitalisme et de la démocratie, en tout cas en Europe. Puis, le modèle européen rebâti sera envié par les Russes, les Chinois comme par les Africains.
Le faux libéralisme
Comment le capitalisme, qui tournait si bien après-guerre lors des Trente Glorieuses, s’est-il vicié ? L’explication est limpide.
Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont cru que l’inflation et le chômage (au début de sa montée dans les années 1980) venaient de l’excès de la taille de l’État. Il fallait le réduire et redonner toute sa place « au marché » qui est « plus efficace ». Conséquence : les gouvernements ont baissé certains impôts, allégé des lois sur le travail, supprimé les droits de douanes. Le bilan, quarante ans plus tard, est blanc et noir.
Blanc : les succès dans les pays en développement, en particulier en Chine et dans le Sud asiatique, sont incontestables. Le capitalisme n’assure plus « une bonne vie » pour les classes moyennes des pays développés mais, dans le même temps, le libéralisme, la mondialisation et la technologie combinés ont sorti des milliards de gens de la misère et leur ont offert les premiers éléments d’une dignité. La richesse n’est plus concentrée au Nord, du coup les inégalités mondiales ont globalement baissé depuis 1980. Selon le World Inequality Lab, en matière d’éducation, le niveau de l’Amérique du Sud était à 15% de celui de l’Amérique du Nord en 1960, il est maintenant à 70%. L’espérance de vie des pays en développement étaient de 39 ans en 1960 (contre 70 ans aux États- Unis), elle est montée à 63 ans quand celle des États-Unis est de 78,5 ans. La convergence est réussie.
Noir : dans les pays développés, les salaires ont été « contenus », c’était le but, et les profits ont cru : ils sont passés de 11% du PIB à 15%. Les impôts payés sur les bénéfices ont été ramenés de 42% à 25%. Et pourtant, la croissance économique dans l’OCDE est tombée de 4% dans les années 1980 à 1,5% en moyenne annuelle. La recette libérale n’a pas rempli ses promesses.
Contrairement aux annonces de mise au régime sec des États, les dépenses publiques n’ont cessé d’augmenter partout. En Europe, on le sait, mais aussi aux États-Unis, qui le sait ? Le poids du système de sécurité sociale est passé outre-Atlantique de 10% du PIB en 1980 à 17% en 2020. La pandémie de la Covid a montré des Américains bénéficiant de soins gratuits à grande échelle et d’aides salariales supérieures aux européennes. Tous les propos tenus contre « l’austérité » et le saccage de l’État providence en Amérique comme en Europe sont des facilités idéologiques.
Que s’est-il passé en réalité ? Les baisses d’impôts et les dépenses publiques accrues ont été payées par une expansion continue des dettes publiques. C’est le paradoxe qu’il faut bien saisir : les gouvernements ont cherché à couper dans les dépenses, ils les ont limées par-ci par-là et les services publics se sont de facto abîmés, ce que ressentent durement les gens. Mais globalement, ces gouvernements (de tous bords politiques) ont échoué : les États providence n’ont pas minci, au contraire. Les dépenses publiques ont cru de 32% du PIB aux États-Unis en 1980 à 40% en 2019 (avant les hausses dues à la Covid-19). En France, elles n’ont jamais cessé leur progression pour atteindre 57% du PIB avant la pandémie. Exceptions avec la Suède, recul de 65% à 50% en vingt ans, et l’Allemagne, recul de 55% à 45%.
En parallèle, on a assisté au même réflexe de recours au crédit chez les ménages. Mal payés, ils auraient dû réduire leur consommation mais ils ne l’ont pas fait, ils ont maintenu leurs achats grâce, également, à des dettes. L’économie « libérale de marché » promise s’est transformée tout simplement en une économie de crédits a volo. Les dettes privées et publiques dans les pays développés ont doublé depuis 1999 pour atteindre 440% du PIB. La Chine est à 350%, les pays en développement à 250%. Et elles continuent de grossir.
Ce faux libéralisme se paie cher. D’une part, une économie de crédits enrichit naturellement les possédants et creuse les inégalités. D’autre part, les ennuis ne s’arrêtent pas là : les dettes que chacun sait immenses posent la question sans réponse de leur remboursement. Un doute s’est installé sur le financement à long terme. Ce doute fait disparaître la condition sine qua non du bon fonctionnement du capitalisme : la confiance. Il pèse négativement sur la croissance. Le faux libéralisme n’a ni les avantages du libéralisme ni ceux de l’étatisme, il récolte les critiques légitimes de deux côtés, comme le souligne Patrick Artus.
Vice supplémentaire de ce faux libéralisme : les dettes ont poussé logiquement à une financiarisation de l’économie, donnant à la banque et la finance une place prépondérante par rapport à la production réelle. Devenue gargantuesque, la finance a avalé une part extravagante du gâteau, puis, prise d’Hubris et de certitudes, elle s’est lancée dans des aventureuses inventions mathématiques pour couvrir tous ses risques (les marchés dit dérivés). Comme personne ne la contrôle plus vraiment, la finance est tombée dans des crises récurrentes et, plus grave encore, ses exigences de rendement ont obligé les entreprises « réelles » à se rabattre sur l’impératif de court terme.
Est née la finance de l’irraison. L’argent doit normalement aider au développement des entreprises, certains fonds spécialisés spéculent aujourd’hui sur la chute de certaines d’entre elles (par les ventes à découvert), une sorte de suicide capitaliste. Les banquiers persuadent les grosses entreprises que la meilleure façon de gagner de l’argent est de racheter leurs propres actions : le capitalisme cannibale se nourrit de lui-même.
De ce faux libéralisme est sorti un déficit mondial d’investissements de long terme dans la transition énergétique, dans la santé ou la construction des infrastructures, justement ceux qui manquent à la croissance. Le court-terme et les résultats trimestriels sont la boussole, le monde s’est enfermé dans « une tragédie des horizons », comme le décrit très bien Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre.
Ajoutons, puis on en aura fini avec le dossier d’accusation, que « l’économie de marché » est en carton-pâte. Le marché est capté par des monopoles comme jamais depuis un siècle. En 1990, les 100 plus grandes entreprises avaient une capitalisation boursière 30 fois supérieure à celle des 2000 immédiatement en dessous. Ce ratio est passé à 7 000 fois en 2015. On connaît les GAFA, mais tout le capitalisme d’aujourd’hui leur ressemble : la concurrence est trahie, les monopoles règnent, les inégalités entre les multinationales d’en haut et les PME d’en bas sont historiques. Comme le souligne Thomas Philippon, le faux libéralisme a fait renaitre les rentiers.
Vrai libéralisme
Si la révolution macro-économique libérale n’a jamais été faite comme on vient de le voir puisque l’État ne maigrit pas, dans les entreprises la révolution micro-économique libérale a été accomplie. Le pouvoir de l’actionnaire est total, étayé par les contreforts de la finance de court terme. Cette place-forte libérale, l’entreprise, est solidement occupée par les soldats de Milton Friedman. Une norme implicite d’un rendement de 12% s’impose aux chefs d’entreprises comme la loi divine. Elle le corsète et la Bourse vient sévèrement punir ceux qui osent faire un pas de côté.
Ce basculement actionnarial n’a pas été pour rien dans la fuite de l’industrie à l’étranger et son atrophie dans les pays qui ont adopté aveuglément la share-holder-value : États-Unis, Grande-Bretagne et France. Les usines ont mieux résisté en Allemagne, pays où demeure une cogestion avec les salariés.
Une racine de la crise sociale vient de là : de la disparition des usines industrielles, dont dépendait les « bons » salaires des classes moyennes. La société de services qui l’a remplacée laisse sur le carreau cette classe ouvrière sans diplôme, la condamne au chômage et aux petits boulots précaires, elle vide ses communautés, ruine ses banlieues et ses petits commerces… Les milles briques qui composaient leur « bien commun », les camaraderies au travail, les solidarités de classes sociales, les espoirs de l’école et de l’ascenseur social, les institutions locales, partisanes comme religieuses, et in fine la bienséance et la civilité, ont été démontées. Le libéralisme micro a plongé les ouvriers et leur famille dans la société anxieuse de l’individualisme de masse. Il a désossé l’American Way of Live des années 1930.
A cela se sont ajoutés d’autres facteurs qui ont détruit la démocratie. La civilisation de l’individu, comme le décrit Marcel Gauchet : la société (celle de Rousseau) qui « assignait à chacun sa place et son destin (…), où chacun avait une conscience aigüe de ses obligations envers le groupe », est devenue la société où « l’individu est premier en droit ». L’ère de l’émotion : elles prévalent sur les faits, le « ressenti » vaut plus que les chiffres, les symboles ont repris la corde (Pierre Bourdieu), la colère est passée devant. L’auteur italien Alessandro Baricco en tire la conséquence : « nous avons échangé la sécurité pour l’intensité », dit-il, « le désir de piquer une crise est beaucoup plus fort que les arguments pour le faire ». La post-vérité : la science serait « achetée par les Labos » c’est-à- dire l’élite. La vérité est « alternative », place est libre pour celle des complotistes, mais beaucoup plus largement aux « croyances » de tout un chacun. Le règne de la peur : les mouvements sociaux les plus durs ne viennent pas des salariés qui ont perdu leur emploi ou leur statut mais de ceux qui ont peur de le perdre. La peur du déclassement, ont montré Yann Algan et Pierre Cahuc, assaillit les consciences et l’État voulant nous protéger nous plonge dans une « sécurocratie » (Peter Sloterdijk). Les réseaux sociaux et les médias bouclent la boucle pour nous enfermer dans la violence, l’insulte et la polémique.
Échec à la barbarie
Se sortir de la barbarie impose de réformer le capitalisme, ce qui passe en préalable par l’élite. Les gens « pour qui ça va bien » – définition employée ici de l’élite- nient leur responsabilité dans le sort des gens « pour qui ça va mal ». Ils usent de mille arguments pour ne jamais reconnaitre qu’« il y a un grave problème » lorsque deux tiers des populations disent, à tort ou à raison, ressenti ou réalité, être malheureux. L’élite continue de penser que le peuple est devenu fou mais que ce n’est pas de sa faute. Lors des élections, les candidats « hors système » ou « populistes » gagnent des voix puis emportent les majorités mais tout cela reste « pas sérieux ».
S’ajoute une erreur d’analyse : les « politiques de l’offre » favorables aux entreprises fonctionnent, le chômage baisse, dit l’élite. Il suffit d’être patient. Les emplois créés sont loin, les salaires sont chiches mais « ça va s’améliorer ». En réalité, le système capitaliste est devenu plus rude, il bipolarise le marché du travail entre le diplômé et le non-diplômé ou le mal diplômé qui tombe ou a peur de tomber. Le peuple ne voit pas l’amélioration venir, il perd patience, vote pour le Brexit et pour Trump. Le propos de l’élite devient alors moral : le tiers monde se développe, il sort de la misère, construit des écoles, voit sa vie transformée. Cette belle consolation morale n’a pour effet évidemment que d’énerver ceux qui ont perdu leur emploi dans les vallées rouillées de Lorraine ou de l’Illinois. Ils connaissent le chômage, la stagnation des salaires, la perte de l’espoir, et voilà qu’on leur lance cet appel moral qui sonne comme un ordre de se taire.
L’élite se cache enfin derrière un dernier rempart : l’incompétence des leaders populistes. Ce qu’ils proposent ne marche pas. Donald Trump, le héros, n’a finalement réussi qu’à enrichir les riches et à consolider la Chine. L’élite se voit sauvée : le populisme échoue et ne dure pas. Il suffit donc de rentrer la tête dans les épaules, de laisser passer l’orage et même, certains y songent en France, de porter le populisme au pouvoir pour « crever l’abcès ».
Il y aurait encore plus grave : que l’élite soit elle-même touchée par le déclinisme. Cernée, vilipendée, découragée, qu’elle se résigne, se mette à croire elle-même au crépuscule. Le peuple fou n’entend plus rien, c’est foutu.
L’Histoire passe son chemin de l’Occident à l’Orient, de la démocratie aux régimes illibéraux, de l’îlot blanc à la multitude de couleurs. Fin ! Rideau sur la civilisation grecque, sur la mesure, le droit, la science et la raison universelle. Entrée irrémédiable dans le 21ème siècle des tensions, des convulsions, de la violence revenue, de l’irraison. De la guerre et la barbarie.
La menace la plus grave est celle-là : que nous entrions dans l’hiver du découragement des élites occidentales.
La modération radicale
Que faire ? Quelle politique mener ? Quand la tempête souffle les écarts sont inévitables, mieux vaut avoir de la marge à gauche et à droite, de quoi éviter les ravins de l’extrémisme stérile. La Raison est au milieu. La prudence n’est pas la « sotte vertu » moquée par les petits esprits. Mais si la modération est la ligne de la Renaissance, elle doit être radicale. Pour emprunter un vocabulaire automobile : conduire la voiture au milieu de la route, mais à fond. A fond, parce c’est le caractère du nouveau monde : il faut aller vite, transformer, surprendre et faire vibrer. Accélération et intensité, le monde neuf est à la fois technologique et émotionnel. La modération radicale est le contraire du ventre mou.
Pour aller où ? Le convoi mené par la modération radicale prend quelle direction ? Celle de John Rawls. Le philosophe américain a eu son heure de gloire éphémère dans les années 1970 et 1980, quand son livre Théorie de la justice (1971) a servi de point d’appui à « la Troisième Voie » de la gauche du trio Clinton-Blair-Schröder. Il y vantait « l’égalité des chances » et « l’équité ». Mais comme les inégalités ont explosé, Rawls a été jeté aux oubliettes. Emmanuel Macron, qui avait adopté sa ligne au début, s’est fracassé sur les « gilets jaunes ».
Il faut revenir aujourd’hui à lui. La Théorie de la Justice est une œuvre maitresse, la réflexion la plus élaborée sur ce que doit être la justice sociale dans une société complètement individualisée comme la nôtre. Michel Aglietta juge John Rawls « incontournable ».
Première conséquence : l’école est le pivot central de toutes les politiques publiques. L’individualisme, philosophie de la liberté, ne peut tenir la distance que si chacun est véritablement équipé d’un « bagage » qui lui offre toutes ses chances, non pas seulement au seul départ dans la vie mais à tous les âges, autrement-dit une deuxième, une troisième chance, etc. Les réformes pour y parvenir sont hautes : individualiser l’éducation et la formation permanente et réviser beaucoup de politiques publiques pour les aligner sur l’« empowerment » (par exemple donner un logement gratuit aux étudiants, aider à la mobilité des licenciés, etc).
Deuxième conséquence : se défier de l’État qui « protège » du berceau au tombeau. Peter Sloterdijk a raison, l’État-nounou s’enferme dans l’impasse de l’infantilisation. Le « toujours plus de protections » est une arme à se tirer dans le pied : à vouloir protéger, l’État n’en fera jamais assez. L’insatisfaction première du peuple relève de la dignité, l’aide publique n’est pas la solution, quelle que soit la somme qu’on y consacre. La seule bonne réponse relève de la responsabilisation. L’État-social doit apprendre à responsabiliser c’est-à-dire à parler à des citoyens et non à des administrés ou à des blessés.
Troisième conséquence : rétablir le « collectif ». La perte de confiance des populations et la chute dans l’égoïsme proviennent de la disparition du bien commun. La racine du mal n’est pas tant le capitalisme qui aurait individualisé à outrance et atomisé les classes sociales que la perte d’efficacité, réelle ou supposée, des collectifs d’hier, locaux, nationaux et internationaux. La situation diffère selon les pays. Aux États-Unis, il s’agit d’abord de donner à tous des droits sociaux élémentaires (éducation, santé gratuites). En Europe, la situation est différente, ces droits y sont en principe assurés. En France, la perte de crédibilité des institutions collectives est particulièrement forte à cause des failles de l’État, de son coût mais surtout de la multiplicité des strates de décision. Le pouvoir a deux défauts, il paraît impuissant devant les défis du siècle et il est lointain.
Il est l’heure d’imaginer de nouvelles façons d’exercer le pouvoir et de susciter des adhésions « collectives ». Un local très participatif, un national plus recentré et un international complètement redynamisé. Il s’agit d’un gros travail conceptuel, à chaque niveau, afin de marier l’efficacité et l’adhésion et de reconstruire une confiance. Le sentiment d’impuissance de la politique ne sera combattu, pièce par pièce, que par une action sur les trois niveaux.
La réforme du capitalisme actionnarial
Le Grand malheur et le cœur de la crise du capitalisme depuis trente ans a été l’épuisement constaté des gains de productivité. Ils grimpaient d’environ 4% par an jusqu’en 1975 (chiffre américain mais qui vaut pour tous les pays) pour tomber à un lamentable 1%. La vraie cause de la faiblarde croissance, de la crise sociale et du désarroi de la démocratie est là.
Les dernières statistiques montrent une légère amélioration. Tout se passe comme si le coronavirus avait « débloqué » des transformations productives comme les vidéoconférences et le télétravail. Comme si les entreprises, ayant été forcées de réviser toutes leurs procédures à cause des confinements, avaient enfin trouvé à exploiter toutes les potentialités des technologies informatiques. Nous serions qu’au début de ce regain de la productivité puisque la majorité des entreprises ont multiplié les plans pour se digitaliser rapidement et entièrement. Surtout, si comme le demandent Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur, les gouvernements adoptent des politiques qui stimulent « les investissements d’expansion » et limitent « les investissements de rationalisations ». La technologie, qui a été depuis trente la source des suppressions d’emplois et de la déqualification d’une partie de la classe moyenne sans diplôme, une technologie robotisante, deviendrait tout l’inverse, une technologie vivifiante, source de gain salarial, de retour à une « carrière » possible, bref du droit à l’espoir.
Investir : digitaliser, lutter contre le réchauffement climatique, combler le manque d’infrastructures (comme aux États-Unis et en Allemagne), répondre aux dangers géostratégiques : la nécessité est claire de faire basculer le rapport macroéconomique investissement/consommation en faveur du premier terme. Le pouvoir d’achat risque forcément de s’en ressentir. Mais, en parallèle, le rapport capital/travail au sein des entreprises doit basculer dans le sens inverse, en faveur des salariés. Autrement-dit, la politique économique du mandat qui s’ouvre devient délicate mais claire : l’État doit revoir ses dépenses pour les déplacer du « social » vers « la préparation de l’avenir » et par ailleurs commencer à revenir sur la dette. Mais il pourra le faire sans trop de douleur si et seulement si, au niveau microéconomique, les entreprises embauchent à plus haut niveau pour de meilleurs salaires. Si on veut le dire en langage de politique élémentaire : l’État doit aller vers « la droite » et il ne pourra le faire que si les entreprises vont « vers la gauche ».
D’où l’urgence des réformes du capitalisme actionnarial qui, depuis trente ans, fait glisser dans le mauvais sens.
L’élection de Joe Biden, dans le pays capitaliste encore largement dominant, est un marqueur de la nouvelle direction. La politique macro-économique a changé de « consensus » : l’État n’est plus « le problème », il est devenu le « bien commun » qu’il faut reconstruire. Le nouveau président est fermement attaché à ce que « le travail dur soit récompensé ». Son ambition déclarée est de « changer le système » en faveur des classes moyennes. La crise financière de 2008 avait montré le danger de la finance, la crise sanitaire de 2019 a remis la solidarité au premier plan : le contexte idéologique est transformé.
Le président américain veut augmenter le smic, relever les impôts sur les sociétés, redynamiser les syndicats, casser les monopoles et tourner la page « du capitalisme libéral ». Sa décision d’imposer un impôt minimal de 15% sur les sociétés et l’accord qui a suivi au sein de l’OCDE à ce sujet, constitue un début. Le socle de 15% est encore faible mais il s’élèvera. Et la décision conjointe de taxer les GAFA en fonction de leur chiffre d’affaires par pays complète cette reprise en main.
Mais l’essentiel est la micro. Voilà quelques années que les entreprises abandonnent peu à peu l’idée que « la politique ce n’est pas leur business ». La consigne de Milton Friedman en 1970 a pris ces derniers temps beaucoup de petit plomb dans l’aile. Le travail des enfants en Asie, les déchets envoyés dans le Tiers monde ou le réchauffement climatique, ont progressivement appelé les dirigeants à intégrer les « externalités négatives », à être comptables de leur « responsabilités » et à tenir compte de l’effet « réputation ». Elles ont été amenées à se comporter « bien et proprement » dans la RSE (Responsabilité sociale et environnementale des entreprises).
En Ukraine, cette thèse de la séparation des genres politique et économique, vient de se prendre un missile Stinger. Plus de 500 grandes entreprises américaines et européennes ont annoncé « quitter » la Russie, selon le comptage du professeur de Yale, Jeffrey Sonnenfeld. Le choc unanime créé dans les opinions publiques occidentales par les bombardements brutaux en Ukraine, l’horreur de voir une maternité mise en ruines, balayent d’un coup le prudent rapport coût/bénéfice que pèsent les états-majors lors des catastrophes. Cette fois-ci, l’émotion soulève une telle vague dans le public, parmi les clients, chez les employés et aussi, bien entendu, au sein des dirigeants eux-mêmes pour que chacun s’interroge à son niveau sur ce qu’il peut faire pour arrêter le cauchemar et en tout cas ne pas le soutenir. C’est-à-dire faire de la politique.
Les opinions publiques qu’on le veuille ou non, qu’on se plaigne ou pas de leur versatilité et de leur naïveté manipulable, sont devenues exigeantes. Les jeunes en particulier veulent du sens et de « l’éthique ». Les entreprises sont sommées de dépasser leurs réticences issues du siècle dernier pour en faire une force dans celui-ci. La RSE s’est inscrite au premier plan dans les comités de direction.
Mais c’est évidemment insuffisant. Trop lent et trop petit. Trop lent parce que les habitudes ont la vie dure, parce que les pouvoirs établis, les conservateurs, les actionnaires, la finance, sont encore largement dominants. Trop petit parce que le capitalisme n’affronte pas encore ses vrais maux.
Première axe : organiser une commission internationale pour aboutir à une nouvelle règle de la finance, une sorte de nouveau Glass- Steagall Act international. Yves Perrier et Jean-Dominique Senard ont donné à l’Institut Montaigne leurs recommandations pour bâtir la nouvelle architecture financière du « Capitalisme responsable ». Il faut les reprendre et en faire une législation européenne. Si les États-Unis se dispensent de participer, ce comité doit se limiter à l’Union européenne mais sachant que les nouvelles lois édictées s’appliqueront en Europe aux banques américaines. La première réflexion du comité doit justement porter sur l’asymétrie juridique actuelle qui donne une suprématie aux Américains grâce au dollar.
Pour le reste, la réflexion sur la finance, engagée cent fois notamment après la crise de 2008 mais toujours remisée, doit être sans tabou : quelles règles pour les banques, pour les fonds du Shadow banking, pour la comptabilité des entreprises ? Quels produits autoriser et comment ? Ce que l’Union a décidé sur les données Internet (RGPD) ou ce qui se prépare sur les cryptoactifs avec le règlement Market in Crypto Assets ( MiCA) qui va considérablement limiter l’usage de ces outils de spéculation, indique le bon sens. Celui de redonner une utilité sociale à la finance « pour l’industrie, pour le commerce ou pour l’agriculture », comme le voulaient Carter Glass et Henry Steagall en 1933.
Deuxième axe : le retour à la « stakeholder value », l’actionnariat participatif. Tout se joue là. C’est au côté du premier pilier, le retour l’État et des « biens premiers », le second pilier du bon capitalisme à reconstruire. L’idée de la RSE, aussi imparfaite qu’elle soit et malgré la facilité avec laquelle elle s’offre aux manipulateurs, est la meilleure idée qu’on ait en magasin. Il faut la généraliser et l’intensifier.
L’obstacle dirimant est connu : le rendement de 12% qu’exigent « les actionnaires », à commencer par les fonds financiers. Cette norme s’est diffusée, elle s’impose aux états-majors. Il faut s’employer à la faire sauter de toutes les façons possibles : promouvoir les fonds « alternatifs », qui sont nombreux à se monter actuellement, pousser les fonds souverains (publics) dans ce sens et mettre des taxes sur les gains « non RSE ». Une autre idée serait de transformer des milliards d’aides-Covid en fonds propres détenus par l’État en échange, non pas d’une quelconque ingérence dans la gestion des entreprises, mais dans leur mise en conformité avec des règles RSE simples, par exemple énergétiques. Un gros travail est demandé ici aux jeunes des Fin Tech, s’ils veulent devenir des bons citoyens, à eux d’inventer une « bonne » finance aussi rentable que la « mauvaise ».
John Rawls aboutissait à la fin de ses réflexions à « la démocratie de propriétaires » celle qui ouvre le capital des entreprises aux travailleurs. Le général de Gaulle était parvenu aux mêmes conclusions avec la « participation ». Cette idée a été combattue comme inadéquate (les travailleurs, ces jouisseurs, ne votent pas pour le long terme), comme démagogique (cela n’apporte que peu de rémunération), comme irréaliste (il faut des syndicats « réformistes », sinon c’est ingérable). Toutes ces remarques s’entendent. Mais il y a-t-il une meilleure manière opérationnelle que la participation pour impliquer les salariés dans la gestion ? Et, ce faisant, pour rendre les syndicats réformistes et pour infléchir le management de sorte qu’il sorte du modèle américaine et qu’il s’approche du modèle germanique ?
Joe Biden pourra-t-il corseter sa propre finance ? Réponse très incertaine. Mais en Europe, la ligne doit être ferme. On parle de souveraineté technologique ou industrielle, il doit en être de même pour la souveraineté financière et bancaire. L’Europe a tous les atouts nécessaires : une monnaie et une épargne très positive (qu’elle place en dollars américains). Elle devrait viser de moins dépendre des folies de Wall Street et de montrer l’exemple d’un replacement de la finance sur les chemins de la raison, étape première pour retrouver une prospérité vive et partagée.