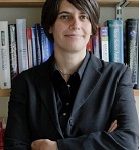Au coeur du système financier, ordonné autour du dollar, nous avons maintenant une administration américaine aux actions dystopiques… et aux motivations qui interrogent, s’inquiète l’économiste Hélène Rey.
Dans le domaine du système financier international comme dans celui de la défense, les actions de l’administration américaine frisent la dystopie. Comme le reconnaissait lui-même Stephen Miran, le nouveau président du conseil d’analyse économique de Trump, le dollar est la monnaie internationale car l’Amérique offre de la stabilité, a des institutions fortes et parce que les marchés en dollar sont les plus liquides. Ces caractéristiques sont liées aux éléments qui rendent l’Amérique suffisamment puissante pour projeter sa force à l’échelle mondiale.
Dans mon travail de recherche, j’ai estimé le « privilège exorbitant » des Etats-Unis, le rendement que les Etats-Unis obtiennent sur leurs actifs nets internationaux grâce à leur position de banquier mondial : ils achètent principalement des actions et des entreprises et le reste du monde leur prête plutôt sous forme de bons du Trésor américain. Ainsi, comme pour un banquier, leur coût de financement est bas alors que le rendement sur leurs actifs est en moyenne plus élevé, ce qui leur permet de dégager un rendement net positif.
« Meme coin »
Ce « privilège exorbitant » est d’environ 1,5 % par an en terme réel. Mais ce privilège a également d’autres composantes : en cas de crise mondiale, les investisseurs tendent à acheter des bons du Trésor, ce qui permet aux Etats-Unis de ne pas craindre de voir leur refinancement se tarir pendant les coups durs. Pour les marchés émergents en revanche, les capitaux étrangers fuient durant les crises, ce qui les met sous pression.
« L’Europe doit préparer sa riposte numérique face à une augmentation possible des ‘stable coins’ en dollar dans les échanges internationaux.«
HELEN RAY
Au coeur de ce système financier ordonné autour du dollar, nous avons maintenant une administration américaine aux actions dystopiques. Quelques minutes avant son investiture, le Président des Etats-Unis a émis une « Trump coin », une « meme coin », c’est-à-dire une cryptomonnaie qui n’a aucune valeur intrinsèque. Cette « Trump coin » est passée de 0,18 à 75 dollars en quelques heures. Un acheteur anonyme a acheté pour 6 millions de dollars de « Trump coins » dans les premières 3 minutes, lançant la dynamique de bulle financière, et les a ensuite revendues deux jours plus tard avec un profit massif. Trump détient encore 80 % de ces « Trump coins ».
Réfléchissons : peut-il y avoir un autre motif à l’acquisition massive de ces coins que l’achat de faveurs politiques ? Connaissons-nous l’identité des acquéreurs ? Non. Ils peuvent se cacher via des plateformes d’échanges non régulées. Qui récolte les frais de transaction (100 millions pour l’instant) et bénéficie de l’appréciation de ce « meme coin » ? Donald Trump. Milliardaires en mal de faveurs pour leurs entreprises et puissances étrangères en mal de concessions ont donc un moyen rêvé pour corrompre la puissance américaine.
Corruption
Cet exemple est particulièrement saisissant ; mais la corruption a commencé à gangrener les institutions fédérales américaines de façon plus large avec des remplacements massifs de fonctionnaires compétents par des « loyalistes ». Quant à la stabilité des politiques économiques, les attaques tarifaires répétées de Trump envers ses partenaires et le reste du monde ont rendu le concept obsolète.
Les indices d’incertitudes atteignent des sommets historiques et les effets sur la confiance et l’investissement commencent à se voir. Les baisses d’impôts pour les plus riches vont devoir être compensées par des tailles dans les systèmes d’assurance comme le Medicaid ou conduire à des sentiers d’endettement non soutenable.
Dans quelle mesure est-ce que le reste du monde va continuer à acheter des bons du Trésor américain dans ces conditions, en étant de plus antagonisé par l’administration Trump ? Que dire de la création d’une réserve « stratégique » de bitcoins, une autre cryptomonnaie qui n’a de valeur que spéculative ou parce qu’elle permet de contourner les régulations ?
Que dire de l’idée, émise dans un article de Stephen Miran, de potentiellement taxer les banques centrales qui accumulent des bons du Trésor car cette accumulation serait à l’origine d’un dollar « trop fort » ? On notera les contradictions de politique économique car le dollar s’apprécierait en cas d’application de droits de douane importants par les Etats-Unis.
L’alternative de l’euro
L’euro apparaît de plus en plus comme une alternative potentielle au dollar si l’Europe peut consolider et coordonner sa défense et son indépendance énergétique. La gouvernance européenne est en effet plus solide, moins erratique et moins corrompue à ce stade. L’Europe doit préparer sa riposte numérique face à une augmentation possible des « stable coins » en dollar dans les échanges internationaux.
L’investissement dans la défense et la transition énergétique s’accompagne généralement de R&D et du développement de technologies duales qui augmentent la productivité à moyen terme : le projet Manhattan et l’énergie nucléaire ; dans les années 1950, la création d’Internet ; le projet Apollo dans les années 1960, tout droit inspiré de la guerre froide, pour l’industrie satellitaire et le GPS.
Pour ce type de dépenses, l’effet multiplicatif sur l’activité croît au cours du temps ; dans le court terme, un euro dépensé par le gouvernement accroît le PIB également d’un. Mais, dans le long terme, l’effet multiplicateur devient bien plus élevé et la productivité, l’innovation et l’investissement privé croissent de façon persistante avec des effets forts à horizon de dix ans. L’Europe a donc une feuille de route compatible avec sa survie et le développement de sa puissance ; elle doit jouer ses cartes.