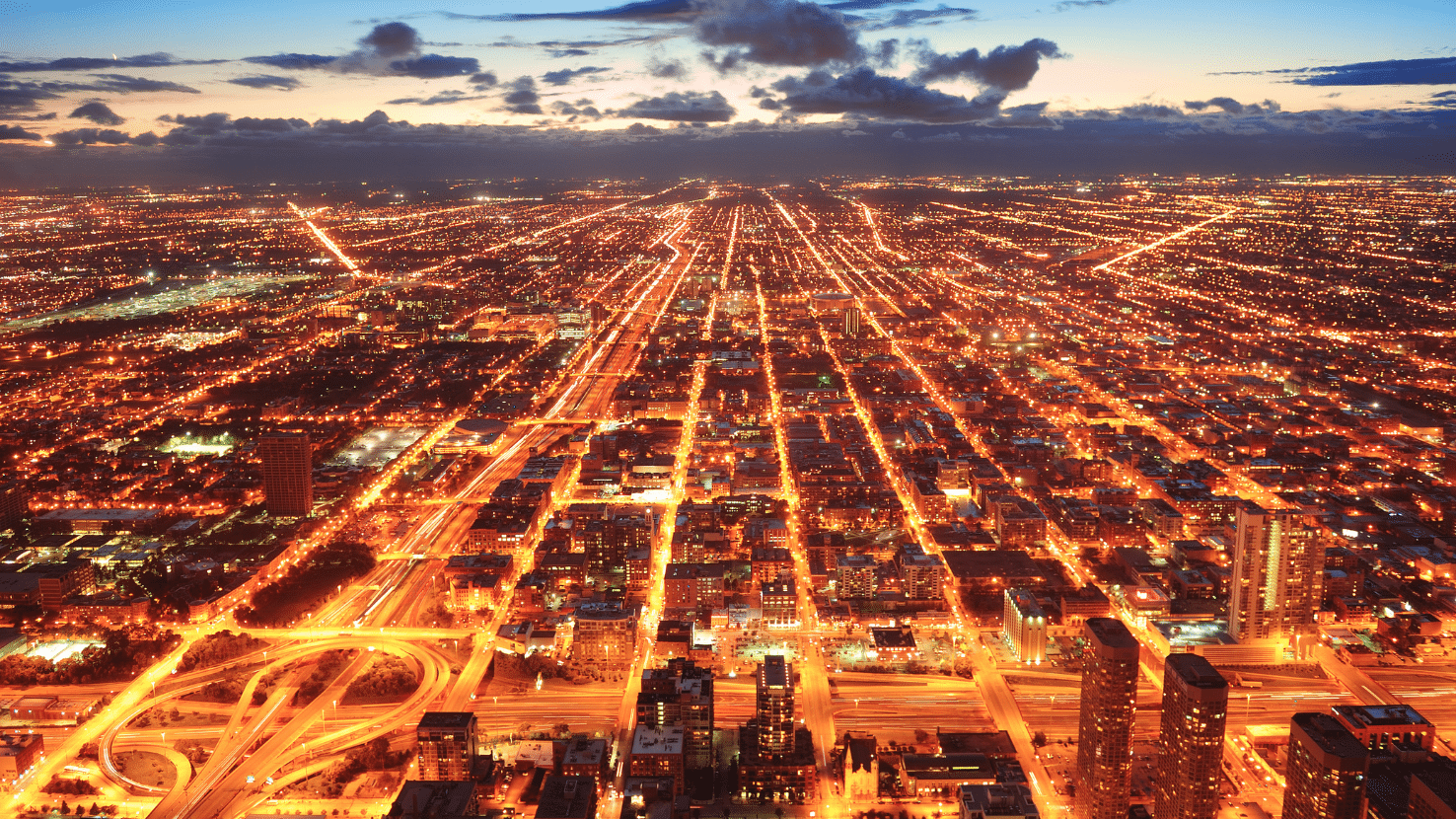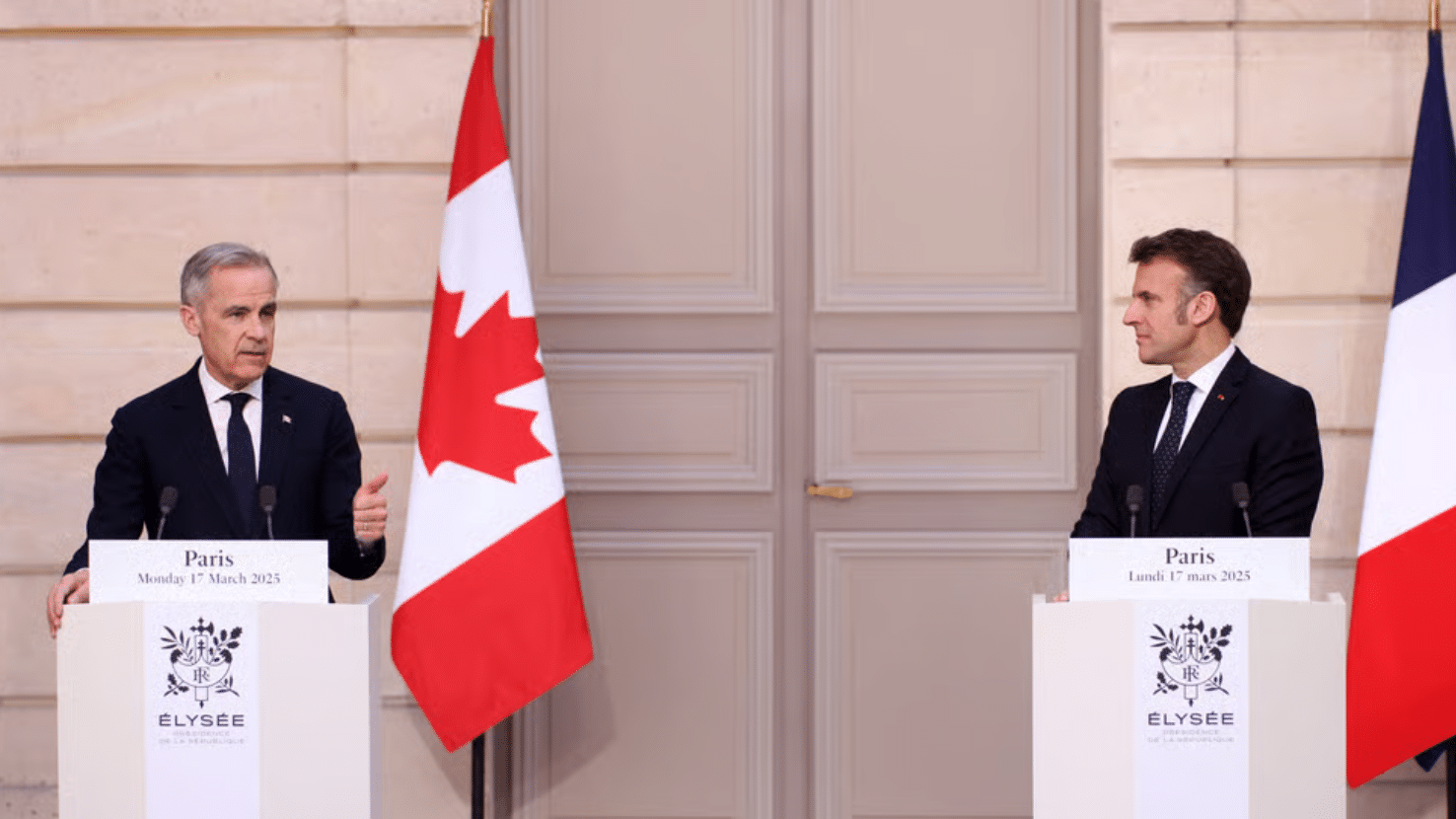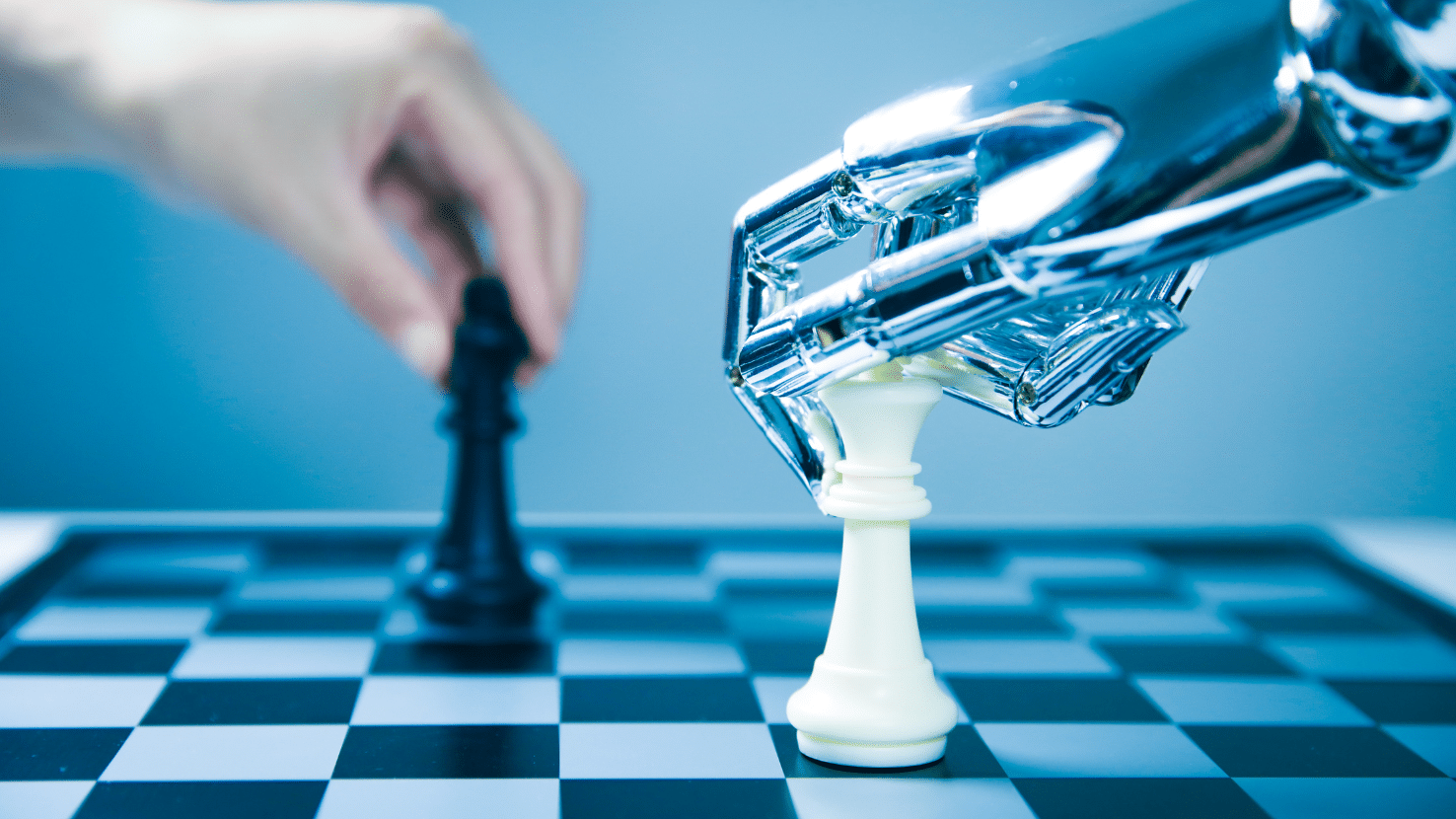Le modèle agricole français, autrefois consensuel, est aujourd’hui remis en question. À l’occasion de la parution de la revue Mermoz, qui lui consacre son dossier, le cercle des économistes a organisé, à Paris, une conférence sur les défis des transitions à venir et des résistances qu’elles suscitent.
Plus, peut-être, que dans tout autre pays, l’agriculture et l’alimentation occupent une place singulière en France, bien au-delà de leur poids économique direct. Si le secteur représente environ 3,5 % du PIB et 5 % des emplois, son influence s’étend à l’ensemble du tissu social, culturel, identitaire et politique du pays. Le système alimentaire français est le fruit d’une longue histoire, dont les racines plongent jusqu’en Mésopotamie. Mais c’est surtout la transformation radicale de l’après-guerre, marquée par la modernisation agricole et l’exode rural, qui a fondé la production de masse et bouleversé la consommation. Aujourd’hui, ce modèle, longtemps consensuel, se heurte à des limites de plus en plus visibles, remises en question par des facteurs exogènes comme le changement climatique, mais aussi par ses propres contradictions internes. À l’occasion de la parution du 6e numéro de la revue Mermoz, qui consacre son dossier principal à ce sujet, le Cercle des économistes a invité des experts de premier plan lors d’une conférence à Paris, le 30 avril. Les débats ont révélé l’ampleur des transitions à venir et les résistances qu’elles suscitent.
Les grands défis de l’agriculture française
Pour Philippe Mauguin, président de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), l’agriculture fait face à quatre grands défis. Le premier concerne la croissance démographique mondiale, qui devrait atteindre plus de 9 milliards d’habitants en 2050. Nourrir cette population croissante devient d’autant plus complexe que le dérèglement climatique s’accélère, avec des phénomènes extrêmes plus fréquents (sécheresses, inondations) et des fléaux sanitaires qui se propagent, comme la grippe aviaire. Philippe Mauguin insiste sur le fait que le progrès génétique des plantes, qui avait permis d’augmenter les rendements au cours des décennies précédentes, est aujourd’hui neutralisé par ces effets climatiques.
La deuxième défi touche à notre dépendance aux intrants issus de la pétrochimie, notamment les engrais azotés et phosphatés, dont la disponibilité est vulnérable aux crises géopolitiques et à la flambée des prix, exacerbée par la guerre en Ukraine. « L’Europe est une puissance agricole encore respectable au niveau mondial, mais avec des supers talons d’Achille », note-t-il. La nécessité de décarboner l’agriculture impose de trouver des alternatives pour maintenir la productivité tout en réduisant l’usage de ces intrants.

Le renouvellement des générations est un autre souci majeur : près de la moitié des chefs d’exploitation partiront à la retraite dans les dix à quinze prochaines années. L’attractivité des métiers agricoles devient donc un enjeu clé, alors que le secteur souffre de rentabilités faibles, voire négatives, et d’une forte dépendance aux aides publiques. En France, 120 à 130 % du revenu d’un agriculteur céréalier peut provenir des aides de la PAC, soulignant la fragilité économique du secteur.
Pour relever ces défis, Philippe Mauguin insiste sur l’importance d’une transition coordonnée des systèmes agricoles et alimentaires. Cette transition ne peut se limiter à la seule production : elle doit aussi concerner l’ensemble de la filière, jusqu’au consommateur. Les changements de pratiques à la ferme impliquent une réorganisation des filières et une évolution des systèmes alimentaires, alors même que la demande sociétale évolue vers plus de qualité et de durabilité. Le défi est à la fois quantitatif (nourrir tous) et qualitatif (bien nourrir).
Face à l’ampleur de ces défis, les résistances sont nombreuses. Le secteur agricole, déjà fragilisé économiquement, voit d’un œil inquiet la perspective de transformations profondes et rapides, sans garantie de rentabilité. Cette anxiété s’est traduite ces dernières années par des mouvements de protestation, non seulement en France mais aussi en Allemagne ou en Pologne. Les agriculteurs hésitent à prendre le risque d’être les premiers à s’engager dans la transition, surtout si la concurrence ne suit pas ou si les dispositifs d’accompagnement sont jugés insuffisants.
Pourtant, des solutions existent : innovations agronomiques, biotechnologies, intelligence artificielle, biocontrôle… Des expérimentations montrent qu’il est possible de réduire l’usage des intrants tout en maintenant les rendements et en améliorant la rentabilité. Pour Philippe Mauguin, enfin, le véritable défi réside dans la massification et le transfert de ces solutions, ainsi que dans l’accompagnement du risque, notamment via des politiques publiques qui privilégient incitation, assurance et accompagnement, plutôt que la seule réglementation.
La répartition de la valeur au cœur des tensions
Au cœur de cette transformation, il y a la question de la juste répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire française. Or, s’il y a consensus sur la nécessité d’une transformation profonde et pérenne du modèle agricole français, c’est loin d’être le cas sur ce sujet, qui a mis en lumière la complexité des relations entre producteurs, industriels et distributeurs.
En amont de la filière, Etienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe et youtubeur, ne mâche pas ses mots : « La valeur est très mal répartie tout au long de la filière. En tant qu’agriculteur, je peux vous dire que je sais de quoi je parle ! ». Tous les acteurs sont concernés, selon lui : « On tape souvent sur les agro-industriels, sur la grande distribution, mais nous, agriculteurs, avons aussi notre part de responsabilité. Nous n’avons jamais su nous organiser correctement pour vendre nos productions« . Il pointe un déficit de formation à la vente et une dépendance historique à des intermédiaires, qui a éloigné les agriculteurs de la réalité du marché. Résultat : « On a perdu la possession de la vente, et on se retrouve aujourd’hui à négocier à prix bas ».

Pour Jean-François Loiseau, président de l’Association nationale des industriels alimentaires (ANIA), la situation actuelle est le fruit d’une longue histoire. Il rappelle que la Politique agricole commune (PAC) a longtemps permis à la France de s’imposer sur les marchés mondiaux, mais en masquant un manque de compétitivité structurel. « On a fait croire aux agriculteurs qu’ils étaient hyper compétitifs, ce qui n’était pas forcément le cas ». Aujourd’hui, la PAC est moins protectrice, et la filière doit s’adapter à une nouvelle donne : « Il faut être organisé économiquement. On ne va pas imaginer que les agriculteurs vont vendre tout seuls, au bout de leur champ, leurs carottes ou leur lait ». Loiseau insiste sur la concentration de la distribution : « On a encore 500 000 agriculteurs, 20 000 entreprises, mais seulement trois ou quatre centrales qui globalisent 70 % de la distribution alimentaire. Le phénomène de concentration de l’acheteur leur donne un pouvoir majeur ». Selon lui, la clé réside dans le « prix juste », qui doit permettre de répercuter les hausses de coûts (salaires, énergie, innovation) et de garantir la souveraineté industrielle et alimentaire du pays.
Michel Biero, ancien président de Lidl France, abonde dans le sens d’Etienne Fourmont : « La juste répartition de la valeur n’est pas possible tant qu’il n’y a pas de transparence entre les différents maillons de la chaîne ». Il dénonce l’« opacité » des négociations commerciales, dominées par une poignée de multinationales : « Les lois qui régissent en France les négociations entre distributeurs et industriels sont uniques au monde. Soit on est plus intelligent que tout le monde, soit on est plus bête que tout le monde, mais il y a un problème ». Pour Michel Biero, cette opacité nourrit un « jeu de dupes permanent », où chacun se renvoie la responsabilité des difficultés. À la fin, « ce sont les deux maillons à l’extrême de la chaîne, le consommateur et le monde agricole, qui trinquent ». Il appelle notamment à mettre fin à la « descente tarifaire » systématique, qui empêche toute prise en compte réelle des coûts de production agricoles dans les négociations. « C’est toujours la faute de l’autre », confirme Etienne Fourmont, fort de son expérience syndicale à la FNSEA. Mais il rappelle que, sur le terrain, les agriculteurs doivent composer avec une multitude de facteurs : attentes des consommateurs, climat, bien-être animal, marchés mondiaux… « On ne communique pas suffisamment entre nous, surtout dès qu’il s’agit d’argent ».
« Une compétitivité qui ne repose pas sur la destruction des biens communs »
En conclusion des débats, l’ancien ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a partagé une anecdote éclairante sur les blocages du système, lorsqu’il a tenté d’arrêter le broyage des poussins mâles dans les élevages industriels, en 2022. Une tentative qui est partie, rappelle-t-il, d’une « demande sociétale ». Face aux enjeux de compétitivité, notamment vis-à-vis des pays européens moins regardants sur le bien-être animal, l’État dépense 7 millions d’euros pour trouver une solution technologique. « Figurez-vous qu’on peut aller trouver la couleur des futurs poussins dans l’œuf, parce que la couleur des plumes des futurs poussins mâles diffère de celui des futurs poussins femelles. Là, on se dit Eurêka ! Il ne reste plus qu’à les installer. On en paye 80 % et il ne reste plus qu’à payer le coût de fonctionnement : 0,5 centime d’euro par œuf, soit 0,03 € d’euro pour une boîte de six œufs. Je rends tout transparent. Réponse de la grande distribution Non, ce n’est pas nous qui l’avons demandé« .

Pour l’ancien ministre, « il faut que chaque acteur assume ses responsabilités. Est-ce que notre système de marché est compatible avec l’agriculture ? Voilà la question fondamentale. » L’agriculture et l’agroalimentaire doivent être considérés comme un marché de commodités ou un marché de valeur ? S’il s’agit d’un marché de commodités, la compétitivité devient l’unique critère. Or, selon lui, il faut éviter les rentes en s’inspirant des physiocrates : « La rente n’est rien, seul compte le renouvellement de la ressource, disait Turgot ». Or, tant qu’on est dans des systèmes de rente, où il n’y a pas de transparence, la « confiance du consommateur ne peut être là ». Selon lui, on ne peut pas améliorer la compétitivité sans que rien ne change. Celle-ci ne doit pas reposer sur la destruction des biens communs. Un sujet qui dépasse celui de l’agriculture.