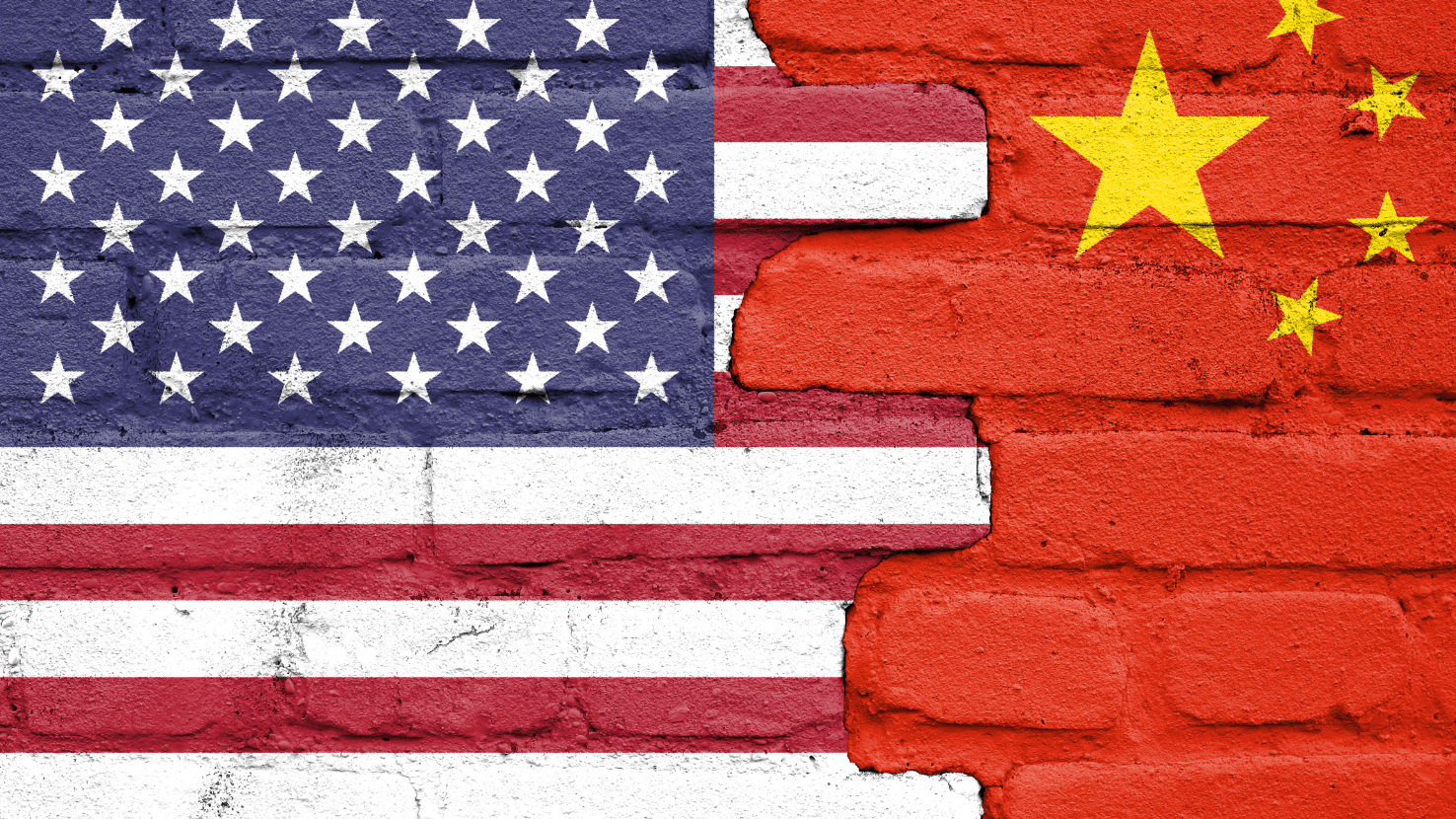La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 rebat les cartes. La dimension environnementale s’impose dans les conditions de la relance. Jean-Paul Pollin explique pourquoi, et comment, le secteur financier a vocation à prendre une part importante dans la transition écologique.
Le secteur de la finance joue un rôle important dans la mesure où il peut contribuer à mobiliser des capitaux pour les orienter vers le financement d’infrastructures, ou d’investissements productifs, assurant des usages plus respectueux de l’environnement. Il y a là, du reste, un réel enjeu pour le secteur lui-même, dans la mesure où les problèmes environnementaux sont pour lui un facteur d’instabilité. Puisqu’en affectant les performances économiques des activités à forte intensité carbone, ils dégradent la valeur de leurs actifs et fragilisent la situation des institutions qui les portent.
Dans ces conditions, on peut penser que les acteurs du système, aussi bien les apporteurs de capitaux que les intermédiaires financiers, ont un intérêt objectif à rendre leurs décisions compatibles avec les orientations pour une transition écologique soucieuse de contenir la montée des désordres environnementaux. C’est-à-dire que l’évolution souhaitable dans l’allocation du capital pourrait se faire de façon décentralisée par le libre jeu des choix individuels : les capitaux allant s’investir dans des placements construits (et certifiés) pour financer, notamment, des projets à faible intensité carbone, censés être à terme à la fois plus rentables et moins risqués. On pense en particulier aux obligations vertes, mais aussi aux fonds de placements labellisés ISR, ESG… Il semble qu’en ce domaine on assiste à un foisonnement d’initiatives qui méritent naturellement d’être saluées, mais qui gagneraient aussi à être clarifiées pour que les produits en question de la lisibilité et de la crédibilité nécessaires.
Il reste aussi à vérifier que les performances de ces nouveaux produits (leurs couples rendements/risques) supportent la comparaison avec celles des placements traditionnels. L’existence d’incitations susceptibles de réorienter les financements en faveur de la transition écologique est une bonne nouvelle. Mais il est probable qu’elle a aussi ses limites, pour au moins deux raisons :
D’abord parce que, même sans invoquer la traditionnelle critique du court-termisme de la finance, il est vraisemblable que l’horizon des décisions individuelles est plus court que celui de l’observation des dommages futurs causés par les erreurs d’aujourd’hui. Ce biais de comportement conduit à dévaloriser la « finance durable » et doit donc être corrigé.
Ensuite, parce que l’environnement est un bien commun dont l’usage est soumis à des externalités. En l’occurrence cela signifie que les gains dus aux investissements favorables à la transition ne sont qu’en partie valorisés par le marché. Il faut donc une intervention centrale pour que leur rentabilité sociale soit pleinement valorisée.
Dès lors se pose la question de l’origine et des formes de cette intervention centralisée. On peut en distinguer trois types de natures bien différentes :
Les Banques Centrales, dont les tailles de bilans (donc le poids sur les marchés) ont connu une très forte expansion, devraient s’attacher à « verdir » la gestion de leurs actifs. Concrètement, cela passerait notamment par l’achat d’obligations « vertes » ou par le refinancement à des conditions privilégiées de crédits bancaires accordés pour des investissements contribuant à la transition. Ce qui se traduirait par une augmentation de la rentabilité de ces investissements.
Mais l’utilisation des politiques monétaires en ce domaine soulève un certain nombre d’objections. Car cela revient à leur fixer un nouvel objectif qui ne s’accorde pas aisément avec leur mission principale de stabilisation de l’inflation et de l’activité. Cela remet aussi en cause le principe de neutralité de marché censé guider leurs opérations et peut s’avérer gênant quant au respect de leur indépendance. De plus il n’est pas acquis que ce type d’intervention ait un impact suffisamment significatif et incitatif.
De ce point de vue, l’intervention des régulateurs et superviseurs du secteur financier (bancaire en particulier) pourrait se révéler plus efficace. Elle est aussi plus facile à justifier dans la mesure où une politique d’allocation inchangée comporte des risques micro et macroprudentiels très élevés qui exigent que les institutions financières se donnent les moyens d’en assumer les conséquences. Selon la logique des accords de Bâle, cela signifie que les actifs « bruns » devraient supporter des charges en fonds propres plus fortes. La principale difficulté tient ici à la mesure des risques qui est un exercice complexe et qui échappe aux méthodes utilisées jusqu’ici.
Enfin, observons que l’usage des instruments classiques des politiques de l’environnement (c’est-à-dire la fixation de quotas d’émissions, de normes, de taxes carbone…) ont fatalement une incidence sur l’allocation des flux de capitaux. Ces mesures appliquées aux activités à forte intensité carbone entrainent naturellement une dépréciation de la valeur et de la rentabilité de leurs actifs. De sorte que c’est peut-être là la forme d’intervention centrale la plus efficace pour que la finance se mette au service de la transition écologique.