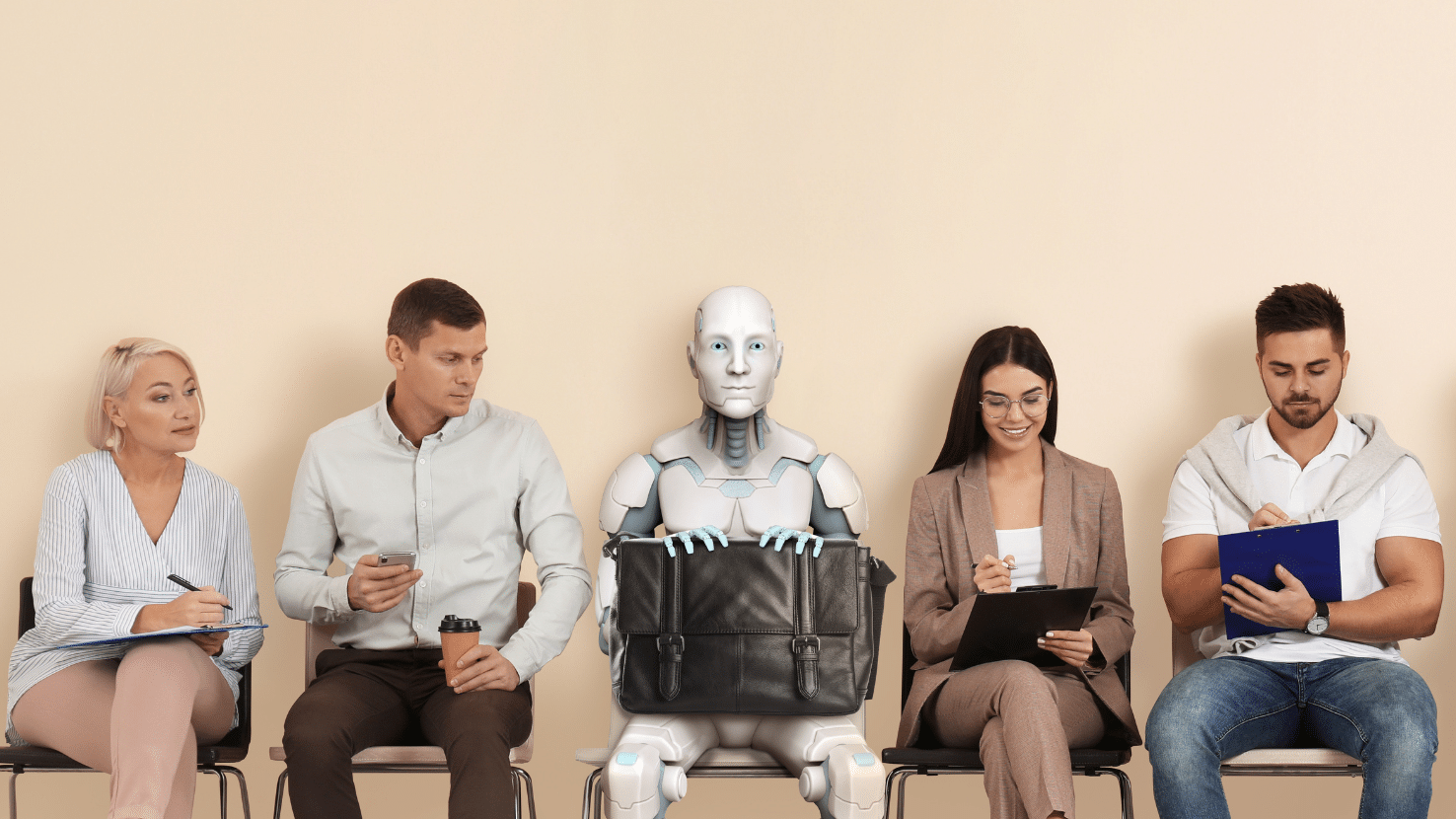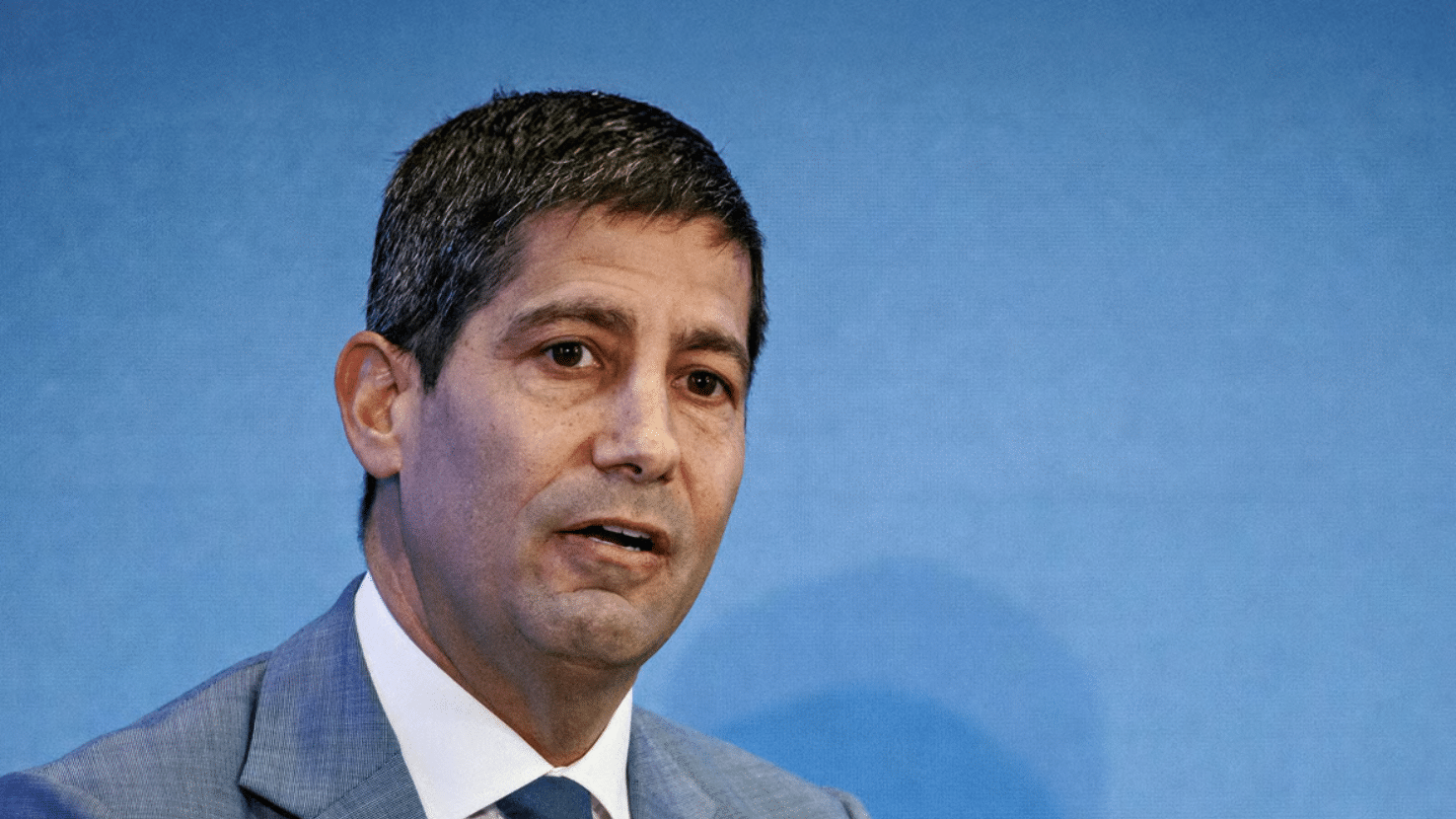Des États-Unis à l’Europe, en passant par le Royaume-Uni et d’autres régions, les Banques centrales manœuvrent avec leurs taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation. Chacune y va de ses annonces mais la communication est-elle efficace ? Jean-Paul Betbèze explique pourquoi la donne a changé en la matière.
La politique monétaire est magique : elle manie un taux d’intérêt à très court terme, le commente pendant une heure et pense que les résultats attendus vont apparaître, non seulement sur plusieurs jours, mais sur plusieurs années ! Ainsi, le 14 septembre, Christine Lagarde, présidente de la BCE, monte ses taux de 25 points de base à 4,5% et annonce qu’elle va les maintenir pendant plusieurs mois, prévoyant que la hausse des prix atteindra 1,9% fin 2025.
Quelques heures après, Jerome Powell, à la Fed, annonce qu’il maintient ses taux à 5,5%, mais s’apprête à agir si l’inflation ne passe pas à 2%, alors qu’elle s’obstine à 3,7%. Le 20 septembre, la Banque d’Angleterre maintient ses taux à 5,25%, à 5 voix contre 4 qui souhaiteraient une hausse à 5,5%, l’inflation étant à 6,7%.
Moralité : en zone euro, les taux seraient proches de leur maximum, dans l’espoir que l’inflation reflue. Aux États-Unis, ils pourraient monter, alors que l’inflation est somme toute modeste, mais têtue. Au Royaume-Uni, ils devraient augmenter. Chaque fois, pour des raisons un peu différentes, c’est la même logique qui est en place : il faut agir sur les esprits pour faire en sorte que l’inflation reflue vers « 2% à moyen terme ».
Les Banques Centrales face aux limites de leur pouvoir
Toutes les politiques monétaires ont le même objectif, les mêmes outils et le même souci : convaincre. Dans les heures qui suivent la décision de la Banque Centrale, les marchés vont réagir par la bourse et les taux longs, encore quelques semaines et on aura le sentiment des entreprises et des banques, puis des consommateurs. La crédibilité est ce qu’il faut obtenir. On la mesure par l’écart entre les prévisions des marchés et des agents économiques sur l’inflation à moyen terme par rapport à 2% : le fameux ancrage des prix. Au-dessus de 2%, pire si l’écart se creuse, il y a péril en la demeure. La Banque Centrale doit remonter ses taux et répéter qu’elle le fera tant que l’ancre n’aura pas retrouvé les 2% souhaités. La crédibilité vient de l’obstination et de la répétition, avec des succès à obtenir bien sûr.
De ce point de vue, les Banques Centrales ont vu les limites de leur pouvoir : le temps n’est plus de la « forward guidance », où il suffisait de dire aux marchés ce que ferait la Banque Centrale, les mettant dans la confidence. C’était le temps de la sortie de la « grande stagnation » où l’inflation ne menaçait pas (grâce à la Chine) et où il fallait monter ses taux doucement et constamment.
Le temps n’est plus, non plus, du Covid, cette crise qui fait synchroniser les économies dans les menaces de déflation. Pour en sortir, il a fallu ouvrir les vannes du crédit, ce qui a réveillé l’inflation. Mais il s’agit d’une inflation nouvelle qui ne vient plus de l’immobilier comme en 2007 avec les subprimes et évidemment pas de l’industrie. Elle est alimentée au début par les marges que les entrepreneurs voulaient reconstruire et aujourd’hui par l’alimentation, les hausses de salaires dans les services et le pétrole. Elle est liée à la guerre, au pétrole et aux salaires dans nos économies servicielles à 80%. Il faut donc répéter en interne que la hausse des salaires et des prix est l’ennemi en se ménageant des marges de manœuvre, si le prix du baril continue d’augmenter.
La politique monétaire doit se créer un halo d’incertitudes. Elle dira chaque fois qu’elle dépend des données du moment pour ses décisions : elle est « state dependant ». Mais, en même temps, sans trop se soucier de se contredire, elle tentera d’esquisser des futurs, vieux souvenir de la « forward guidance ». Les politiques monétaires naviguent ainsi dans un milieu plus géopolitique que jamais avec le désir de baliser l’avenir, tout en se donnant des degrés de liberté pour naviguer au plus serré.
Ce n’est que dans les cas extrêmes que l’on peut dire « whatever it takes ». Mais il faut que la crise soit majeure et le banquier central fantastiquement crédible : nous n’y sommes pas.