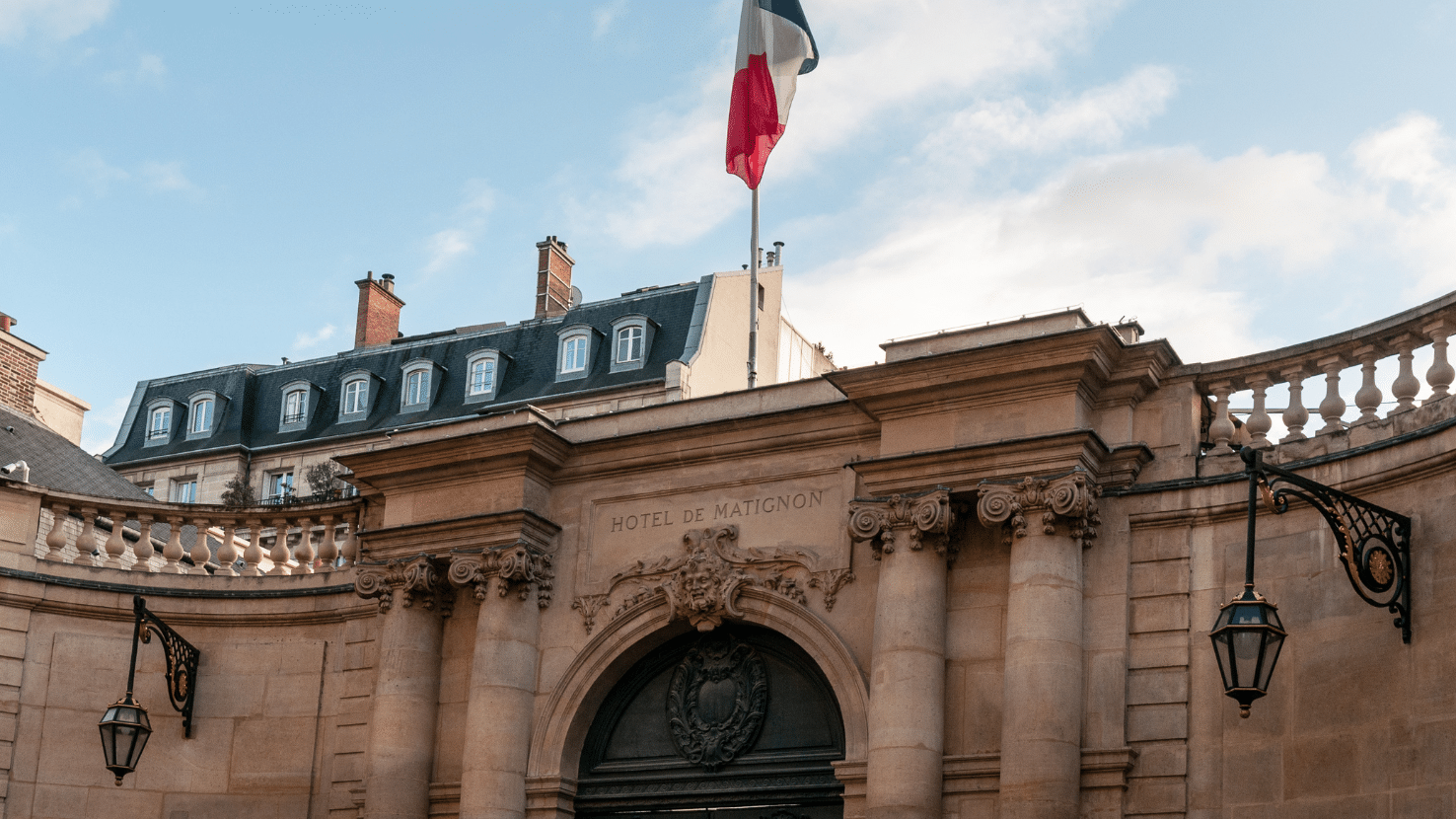Les impôts sont omniprésents dans nos sociétés, structurant les comportements économiques, organisant des transferts de richesses entre groupes sociaux, générations et territoires. Mais le sujet est loin de faire consensus, le débat se cristallisant autour d’un dilemme : comment concilier efficacité économique et justice sociale ? À travers un retour sur deux siècles d’histoire fiscale en France, Nicolas Delalande explore la façon dont les choix politiques et les compromis sociaux ont façonné le système fiscal, éprouvé depuis les années 1980 par les crises à répétition et la libéralisation de l’économie mondiale.
Cet article est extrait du quatrième numéro de la revue Mermoz, « Aux impôts, citoyens ! ».
Les impôts sont aujourd’hui présents partout dans la vie économique, les rapports sociaux et les débats politiques, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Certains trouvent qu’il y en a trop et qu’ils sont trop lourds, d’autres déplorent que les plus riches et les grandes entreprises n’en payent pas assez. La recherche du bon dosage entre efficacité économique et justice sociale est une source de conflits inépuisables. Mais tous s’accordent sur un fait : l’impôt est une donnée incontournable de la vie des sociétés modernes, une institution qui oriente les comportements économiques, façonne les conduites sociales et organise des transferts de richesses entre groupes sociaux, générations et territoires.
En France, chaque année, l’État, les collectivités locales et la Sécurité sociale prélèvent, sous forme d’impôts, de taxes ou de cotisations sociales, près de 45 % des richesses produites, pour financer les services publics, la santé, l’éducation et la protection sociale, assurer le fonctionnement de la justice, de la police et de l’armée, rembourser les intérêts de la dette publique. Est-ce trop ou pas assez ? Une chose est sûre : ce niveau élevé de mutualisation des ressources, qui est la condition d’existence d’un État fort et ambitieux, n’est pas dû au hasard ou à une malédiction venue du fond des âges. C’est plutôt le résultat de chocs historiques, de choix politiques et de compromis sociaux qui se sont déroulés au cours des deux siècles passés. Comme l’écrivait en 1918 l’économiste Joseph Schumpeter, plus connu pour sa défense du capitalisme d’innovation que pour son expérience de ministre des finances d’une Autriche en ruine à la fin de la Première Guerre mondiale, « l’esprit d’un peuple, son niveau culturel, sa structure sociale […], tout cela est écrit dans son histoire fiscale », où se donne à lire, mieux qu’ailleurs, le « tonnerre » de l’histoire mondiale.
Les grands principes politiques et juridiques qui structurent la fiscalité française remontent à la Révolution française. Peu de pays ont connu, en aussi peu de temps, de tels bouleversements. On sait que l’arbitraire et l’injustice de l’impôt comptent parmi les premiers griefs consignés dans les cahiers de doléances. La faute aux privilèges et exemptions dont jouissent la noblesse et le clergé, au poids des charges pesant sur les paysans, au rôle néfaste de la Ferme générale dans le prélèvement des taxes sur la consommation (sur le sel, les boissons, etc.). D’où la révolution fiscale de l’été 1789 : abolition des privilèges, proclamation de l’universalité de l’impôt (chacun doit prendre sa part) et légitimation du système par le consentement des représentants du peuple. S’y ajoute un objectif d’égalité, qui peut prendre plusieurs formes. Pour beaucoup de révolutionnaires, la proportionnalité de l’impôt marque déjà une avancée significative, par rapport aux injustices de l’Ancien Régime. D’autres, comme les Jacobins, plaident pour l’introduction d’impôts progressifs, afin que l’effort demandé aux contribuables varie en fonction de leur niveau de revenu. Quoi qu’il en soit, une idée fondamentale s’ancre dans l’imaginaire politique français : l’impôt est une institution centrale de la République, qui permet d’éprouver la vertu des citoyens et de renforcer leur attachement au bien public.
Contrairement à leurs espérances de départ, les révolutionnaires ne parviennent pas à faire disparaître les taxes sur la consommation, ni à établir un impôt unique – une utopie qui traverse tout le XIXe siècle. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes obligent à lever d’importantes ressources et à développer une administration fiscale centralisée et professionnalisée. C’est d’ailleurs ce qui fait la réputation financière de la France au XIXe siècle, malgré les vicissitudes de son histoire politique : peu d’États disposent à l’époque d’une telle « capacité fiscale », ce qui permet à la France de s’endetter à nouveau après la banqueroute de 1797 et d’inspirer confiance à ses créanciers, internes et externes, jusqu’à nos jours. L’impôt est parfois décrié, mais il est un gage de puissance et de stabilité, aussi bien pour l’État que pour les acteurs privés qui bénéficient ainsi de la protection de leurs droits de propriété et de leurs investissements
La question de la justice de l’impôt ne cesse toutefois de se poser. Avant 1848, seuls les plus fortunés (environ 250 000 personnes sur une population totale de 30 millions d’habitants) ont le droit de vote : le système fiscal est par conséquent très favorable à leurs intérêts. Après 1848, l’introduction du suffrage universel masculin modifie l’équation. L’extension de la citoyenneté politique appelle à davantage de justice dans le système de prélèvements. Très tôt, les républicains font de la création d’un impôt progressif sur le revenu une de leurs grandes revendications. La Troisième République, établie après la défaite contre la Prusse et la chute du Second Empire (1870), a besoin d’argent pour reconstruire le pays, généraliser le service militaire, promouvoir la scolarité obligatoire et développer des premières formes de politiques sociales. Mais les résistances politiques sont trop fortes pour qu’une taxation plus lourde des hauts revenus et des patrimoines soit encore envisageable.
Tout s’accélère au XXe siècle, à l’âge des guerres totales. La saignée de la Première Guerre mondiale n’autorise plus les atermoiements. Dès le 15 juillet 1914, le Parlement vote le principe de l’impôt déclaratif et progressif sur le revenu, qui s’applique pour la première fois en 1916, en plein cœur de la guerre, et dont les taux augmentent régulièrement à partir de cette date. Tous les revenus, qu’ils soient salariés, commerciaux, paysans, financiers, sont imposés, ainsi que les successions et les bénéfices exceptionnels réalisés par les entreprises en temps de guerre. L’État fiscal change de visage et d’ampleur. En à peine dix ans, le taux de prélèvements double, passant d’environ 10 à 20 % de la richesse nationale. Un véritable chambardement pour les contemporains, qui s’accompagne de nouvelles procédures, de nouveaux contacts avec l’administration et, inévitablement, de nouvelles formes d’inégalités et de récriminations. La crise des années 1930 puis la Seconde Guerre mondiale amplifient ce mouvement. Après 1945, l’État social et planificateur repose à la fois sur un niveau élevé de taxation des ménages et des entreprises, sur l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 1954 et sur la généralisation des cotisations destinées à financer la protection sociale.
C’est cette construction historique qui, depuis les années 1970-1980, est soumise à rude épreuve. Avec l’entrée dans la crise et le chômage de masse, les dépenses de protection sociale augmentent de façon régulière, tandis que la libéralisation des mouvements de capitaux diminue la capacité de l’État à taxer les revenus les plus mobiles et les bénéfices des multinationales. La fiscalité progressive, essentielle tout au long du XXe siècle, se trouve contestée et délégitimée, ce qui accentue en retour les tendances inégalitaires du capitalisme contemporain. Mais jamais l’État fiscal et social n’a été aussi nécessaire, comme l’ont prouvé ses interventions lors de la crise financière de 2008 puis face à la pandémie du Covid-19. Peu de voix se firent entendre à l’époque pour interroger les modalités de financement des politiques de relance et de soutien à l’activité, dans un contexte monétaire et financier très favorable à l’endettement sur les marchés financiers. Le retour du débat fiscal en cet automne 2024 n’est qu’un juste retour des choses. Le tonnerre de l’histoire, décidément, n’a pas fini de gronder.