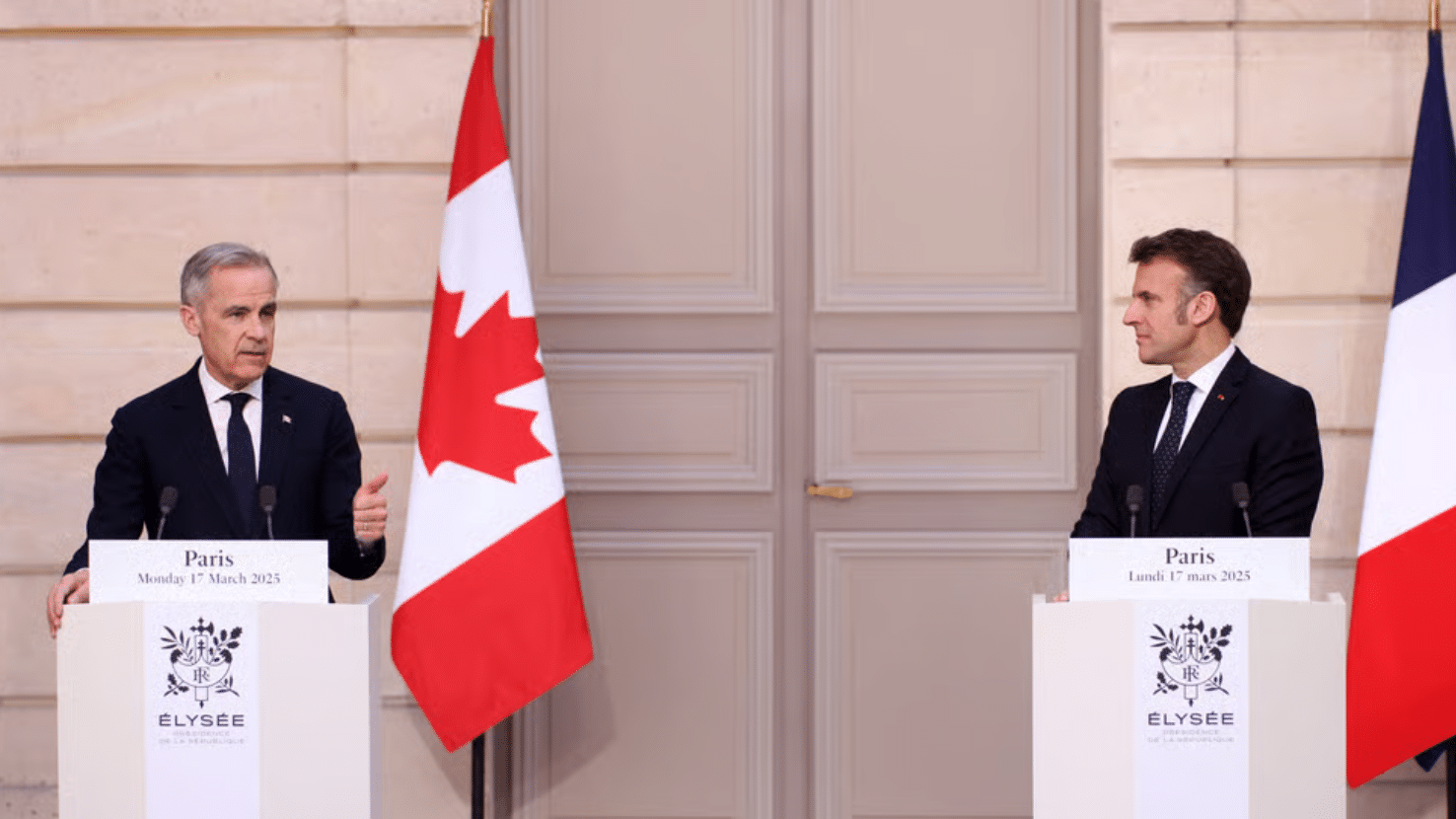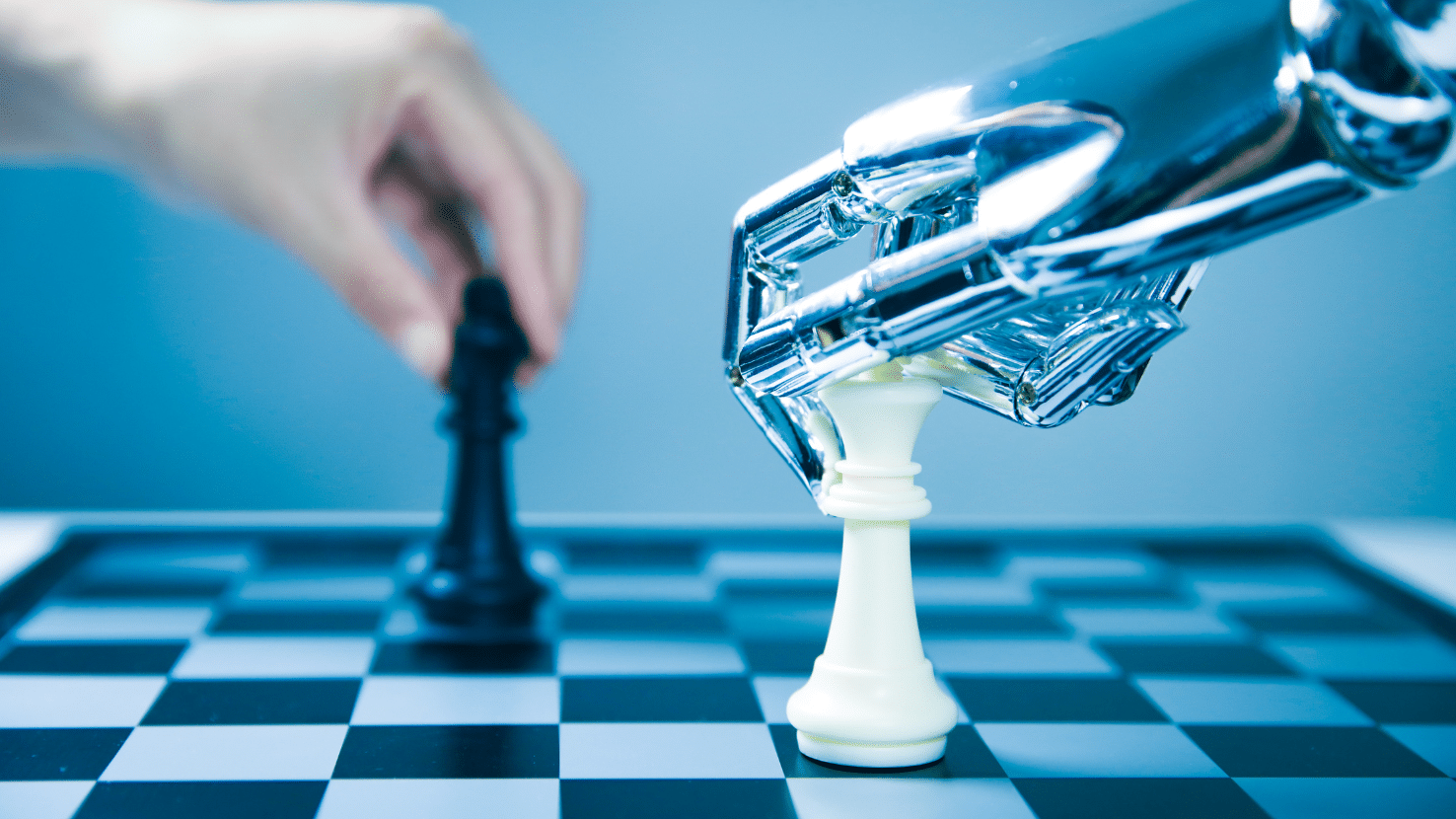L’ouverture, dimanche 17 novembre 2019, de la souscription en vue de l’entrée en Bourse du géant pétrolier saoudien Aramco intervient après un feuilleton de près de quatre ans et de nombreux reports. Pour Patrice Geoffron, l’opération se présente bien mais reste fortement liée à la conjoncture pétrolière, à court comme à long terme. D’où un possible rendement très relatif du placement.
En ce mois de novembre 2019, l’introduction en bourse d’Aramco est à plus d’un titre historique : pour le Royaume, vendre une part du capital de l’opérateur public permet de marquer, symboliquement, les progrès vers une économie ouverte et diversifiée, telle qu’énoncé dans la « Vision 2030 » ; au-delà de cet enjeu, la valorisation de l’entreprise pétrolière iconique fournira des indications précieuses sur la « foi collective » dans l’avenir de l‘or noir, à l’abord d’une décennie décisive dans la lutte climatique.
De prime abord, l’affaire se présente bien : Saudi Aramco a 260 milliards de barils en réserve, soit dix fois plus qu’Exxon Mobil, première compagnie internationale ; son bénéfice net de 110 milliards de dollars en 2018 est supérieur à celui, cumulé, des cinq Majors pétrolières (Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron et Total). De surcroît, le processus d’introduction est très contrôlé : à ce stade, 1,5% seulement des actions sont à vendre et cela sur le marché boursier de Riyad (le Tadawul). Les Saoudiens seront particulièrement incités à acheter et conserver leurs actions (avec une prime de fidélité). Et, pour rassurer les acheteurs, Aramco versera au moins 75 milliards de dollars en dividendes l’an prochain.
Ce faisant, l’opérateur saoudien cherche à être évalué au niveau des compagnies pétrolières occidentales et non dans la catégorie, moins attractive, des compagnies nationales des pays producteurs. En fonction de la réussite de l’opération, une autre part du capital (3%) sera cotée en 2020, sur une place financière internationale cette fois (éventuellement Hong-Kong ou Tokyo).
De telles précautions s’imposent car cette opération est « nimbée » d’incertitudes, dès lors que l’OPEP (même aidée de la Russie) n’est pas parvenue à raccrocher le baril dans la fourchette 80-100 dollars, après sa chute brutale en 2014. Face à une Amérique encouragée à forer par son président (et leader avec 13 millions de barils par jour), rien ne laisse envisager une augmentation durable des cours (l’inverse restant possible) ou de la part de marché de l’OPEP. L’Agence Internationale de l’Energie (AIE), dans son rapport annuel de mi-novembre, considère même que la part des Etats-Unis croîtra pendant toute la décennie 2020. Et, comme la lutte climatique laisse entrevoir un « plateau » dans la consommation (potentiellement à partir de 2025 selon l’AIE), l’espoir n’est pas à rechercher du côté de la demande. S’exerçant à la transparence, Aramco évoque d’ailleurs de tels risques dans son prospectus à l’attention des investisseurs.
Le court terme n’est pas moins incertain : le penchant américain pour les guerres commerciales pèse sur la demande (notamment chinoise), tandis que les attaques du groupe yéménite Houthi contre des installations d’Aramco ont démontré que la production saoudienne n’est plus sanctuarisée.
Certes, en décembre 2019, le Royaume revendiquera une valorisation au premier rang mondial, devant tous les GAFAM. Mais il est acquis que cette valeur sera en deçà des 2 000 milliards « revendiqués » par Mohamed Ben Salmane en 2016, en divulguant le projet. Car, si Aramco dispose d’au moins cinquante années de réserve, la fraction qui sera réellement exploitée est indéterminée, tout comme son prix. Et comme le court terme n’est pas moins confus que le très long, le titre de Saudi Aramco n’est pas nécessairement à ranger parmi les actions de « bon père de famille ».