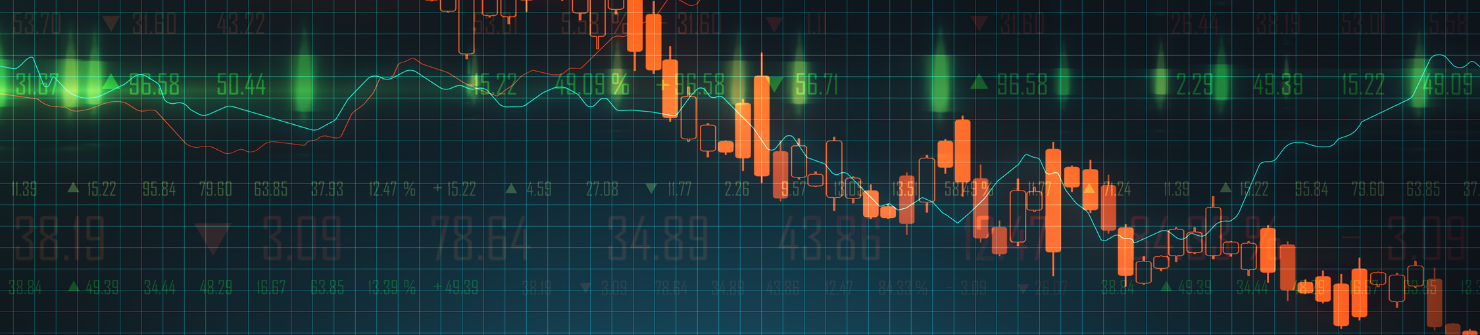Eviter une prochaine crise financière, et notamment la possibilité d’un risque imminent d’une crise boursière. Question d’autant plus légitime à l’heure de la guerre en Ukraine et des interrogations autour de son impact sur l’activité économique mondiale.
Après un rappel historique très éclairant sur les crises des dernières décennies, Bertrand Jacquillat recentre le débat sur les outils qui permettent, sinon de répondre à l’interrogation sur une possibilité de crise financière, du moins de mieux l’appréhender. Outils fondés sur la valorisation des marchés d’actions.
Signaux annonciateurs, rôle des institutions financières internationales, risques potentiels, analyses et commentaires médiatiques… selon l’auteur qui fustige les prophètes de malheur, si les prévisions boursières annonçant un désastre imminent sont une activité très répandue, les scenarios plus optimistes sont, à tort, ignorés.
Pour éviter une prochaine crise financière, encore faut-il en connaître sa nature et ses aspects, car il en existe plusieurs sortes comme le soulignent Jacquillat et Levy-Garboua (2013). Il y a les crises bancaires qui se manifestent par la faillite d’institutions financières comme cela s’est produit à la fin des années 2000. Il y a les crises immobilières, assez fréquentes et universelles car elles concernent l’ensemble des populations dont l’urbanisation ne cesse de s’étendre. Il y a les crises de change. Il y a surtout les crises de dette souveraine, qui surviennent lorsqu’un État se trouve dans l’incapacité de faire face à ses obligations contractuelles quant à son endettement externe et interne. Il y a enfin, last but not least, les crises boursières. Celles-ci peuvent être circonscrites au seul marché financier, mais le plus souvent accompagnent d’autres crises financières comme celles que nous venons d’évoquer. La crise boursière étant en général la mère de toutes les crises, c’est sur celle-ci, mais pas uniquement, que se concentre cette note. La crainte que survienne une prochaine crise boursière est de plus en plus souvent évoquée. Ces craintes ne nous semblent pas justifiées.
Un bref retour en arrière
1929, 1998, 2001,2009 sont quelque unes des dates de crise financière qui ont jalonné l’histoire économique et financière contemporaine. La dernière, de 2009, dont le point d’orgue fut la faillite retentissante et d’une ampleur exceptionnelle de la banque américaine Lehman Brothers, n’a pas tourné à la crise de 1929. Mais celle-ci fut pleine d’enseignements sur ce qu’il convient de faire, et surtout de ne pas faire, en de telles circonstances. De ce point de vue, on peut être reconnaissant à Friedman et Schwartz (1956) d’avoir révélé dans leur monumentale Histoire monétaire des Etats-Unis les méfaits sur l’économie de la politique monétaire très restrictive de la banque centrale américaine, la FED (Federal Reserve Board) au moment de la crise de 1929. En 2009, c’était Ben Bernanke qui était aux manettes en tant que président de la FED. Comme universitaire, Bernanke (2000) avait consacré l’essentiel de ses recherches précisément à l’analyse de la crise de 1929, à Stanford puis à Princeton. Aussi, sous sa conduite et face aux crises auxquelles il a dû faire face, la politique monétaire des États-Unis, comme celle des autres grandes banques centrales, n’a pas été restrictive comme en 1929. Au contraire, elle a été expansionniste dès août 2007 lorsque la Banque centrale européenne (BCE), la première à injecter des liquidités dans le système bancaire européen, suivie de près par la FED. La politique budgétaire elle aussi a été très largement expansionniste. Et grâce à l’organisation mondiale du commerce (OMC), les gouvernements n’ont pas répété les erreurs commises en imposant des tarifs douaniers, conduisant à des dévaluations compétitives, à la généralisation des mesures protectionnistes, et à la dépression économique.
Lors de la crise précédente, entre décembre 1999 et septembre 2002, avec l’éclatement de la bulle internet, ce sont plus de 15000 Mds $ de capitalisation boursière qui sont partis en fumée. Comment se fait-il qu’un krach boursier d’une telle ampleur n’ait eu qu’une très faible incidence sur le système financier en 2001, alors que les quelques 3000 Mds $ de perte de valeur de l’immobilier américain aient eu sur le système financier des effets dévastateurs en 2008-2009 ? Ce sont les investisseurs individuels et institutionnels, acheteurs sans effet de levier de leurs actions, qui ont encaissé eux-mêmes le choc de l’éclatement de la bulle internet, évitant ainsi qu’il ne se propage par contagion dans le système financier et au reste de l’économie. A l’inverse, le surendettement des propriétaires immobiliers américains incapables de rembourser leurs emprunts s’est répercuté sur l’ensemble du système financier américain, et sur la bourse, réceptacle de la valorisation des actifs réels et financiers. Le surendettement peut donc être le facteur déclenchant d’une crise financière et boursière du fait de la contagion qui gangrène le système financier.
Le niveau d’endettement mondial est-il inquiétant ?
Dans un article récent paru dans Commentaire sur la santé de l’économie française, Jean-Claude Trichet (2021), maniant avec brio la métaphore médicale, mettait au tout premier rang de son diagnostic l’une des maladies chroniques de la France, le niveau de son taux d’endettement : de l’ordre de 115% du PIB. Il a presque doublé en à peine quinze ans, depuis que le rapport Pébereau (2005) en fixait la limite soutenable à 60%. Même si elle y est particulièrement marquée, la France n’est pas le seul pays confronté à une telle situation. Par deux fois, la secrétaire d’état américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en garde le Congrès américain sur la situation dans laquelle se trouverait le gouvernement fédéral, à court de liquidités dès le 18 octobre, et donc dans l’incapacité de payer ses factures, si celui-ci refusait de relever avant la fin de l’année le plafond d’endettement public autorisé, ce qu’il avait déjà accepté naguère de faire sous la présidence Obama. Boris Johnson de son côté propose un agenda ambitieux et coûteux de « mise à niveau » de la Grande-Bretagne post-Brexit dans les domaines des services publics détériorés des suites de la pandémie, de la transformation manufacturière vers le net zéro climatique, et de l’amélioration des compétences de la population active. Quant à la Chine, elle est devenue le principal contributeur à la hausse de l’endettement mondial. Certes, le sujet de l’impact potentiellement dangereux de la dynamique de l’endettement sur l’économie est évoqué régulièrement, mais il est largement occulté, en tous cas il n’est pas adressé. C’est comme si le fameux théorème de Modigliani-Miller quant à la neutralité du niveau d’endettement des entreprises sur leur valorisation avait diffusé auprès des investisseurs qui l’appliqueraient à la sphère publique. Ceci expliquerait leur relative indifférence au niveau atteint par l’endettement mondial. Pour l’instant en effet aucune panique ne s’est produite sur les marchés financiers, même si quelques coups de grisou à l’origine très localisée se manifestent de temps en temps, comme dernièrement autour du secteur immobilier chinois.
Le très sérieux IFF (Institute of International Finance) de Washington vient de publier un certain nombre de statistiques susceptibles de donner le tournis. Selon l’IFF, l’endettement global mondial (public et privé) aurait atteint un niveau record de 296000 Mds $ à fin mars 2022, comparé à 270900 Mds $ un an plus tôt, avec une répartition par quart à peu près égalitaire entre la dette des États, des entreprises non financières, du secteur financier, et des ménages. Ce montant représente 353% du PIB mondial, en hausse de près de 10% par rapport à la période pré- pandémie où il était de 333%.
Comme le rappellent Reinhart et Sbrancia (2015), historiquement, quatre méthodes ont été utilisées pour réduire l’endettement des États. Les situations des quatre pays évoqués plus haut, qui ne semblent pas près de prendre cette direction, illustrent le fait que mener de telles politiques n’est pas facile, et peut être même dangereux sur le plan politique pour ceux qui s’y essayent. Encore plus violent, et souvent un mal nécessaire préalable aux politiques d’austérité, est le défaut de paiement, illustré par le sauvetage de la Grèce et sa restructuration financière à la suite de la crise de l’euro en 2011. Une autre raison pour laquelle les investisseurs gardent une certaine sérénité est, curieusement, qu’ils ont de la mémoire, en l’occurrence intéressée. L’histoire financière du 20e siècle montre que l’évolution de l’endettement des nations peut aller dans les deux sens : augmenter comme on l’observe à partir des années 1980, mais aussi diminuer, comme ce fut le cas à la suite de la seconde guerre mondiale. Du niveau de plus de 90 % qu’il avait atteint, le ratio d’endettement au PIB mondial baissa régulièrement après la guerre pour revenir à 30% à la fin des années 1970. La croissance économique est pour beaucoup dans cette évolution ; mais la répression financière y a aussi contribué. Très en vogue dans les pays émergents, elle a été aussi pratiquée au sein des pays développés, aux États-Unis comme en France, au sortir de la Seconde guerre mondiale et jusqu’au début des années 1980. La répression financière requiert principalement deux ingrédients, une dose significative d’inflation et une limite supérieure des taux d’intérêt servis aux épargnants, de sorte que ceux-ci soient inférieurs au taux d’inflation. Elle correspond à une taxe implicite sur les créanciers et un transfert de richesse des créanciers vers les débiteurs, ce transfert étant d’autant plus élevé que la différence entre les deux est importante. C’est la stratégie implicite que les banques centrales ont poursuivi jusqu’au début de cette année, mais sous une forme très atténuée, avec des taux d’intérêt les plus bas possible et proches de zéro, voisins du taux d’inflation. C’est peut-être aussi le souhait des États, même si leurs possibilités en la matière se trouvent réduites depuis que les banques centrales ont acquis leur indépendance. Il y a enfin celle principalement employée après la Seconde Guerre mondiale, la croissance économique tout simplement, qui a donné lieu aux fameuses Trente Glorieuses en France. C’est d’ores et déjà le processus implicitement à l’œuvre depuis le début de l’année 2021, puisque le ratio d’endettement mondial actuel de 353% évoqué plus haut est inférieur à son plus haut de 362% atteint en mars 2021, grâce au fort rebond économique constaté depuis, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Au-delà des vicissitudes actuelles, c’est l’analyse et la solution que d’aucuns privilégient, mettant en avant les progrès de productivité provoqués par les innovations technologiques accompagnés des politiques de concurrence. Comme le rappellent Aghion et al (2021), celles-ci impactent directement ou indirectement tous les domaines d’activité, et dopent durablement la croissance. Dans de telles circonstances, le niveau d’endettement mondial est certes préoccupant, car des accidents, par nature imprévisibles, peuvent venir contrarier ce scénario. Mais il n’est pas rédhibitoire et susceptible d’embraser la sphère économique.
Is this time different ?
Chaque grande crise a ses ouvrages-cultes. La Grande Dépression avait trouvé dans La théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) de Keynes une grande percée théorique. Le livre de référence qui a émergé de la grande crise financière de 2008 est le fruit d’un travail empirique monumental effectué par deux économistes américains, Reinhart et Rogoff (2009), tous deux à la fois professeurs à Harvard et exerçant ou ayant exercé la fonction de chief economist au FMI et à la Banque mondiale: « This time is different, eight centuries of financial folly ». Cet ouvrage propose une histoire « quantitative » des crises, à partir de données rassemblées sur 66 pays de 1800 à 2000. De cette analyse exhaustive, deux conclusions se dégagent : les crises sont toujours des crises de la dette, et d’abord des dettes publiques, bien plus rarement des dettes privées. Enfin morale de l’histoire, quand on justifie les excès des acteurs économiques par l’argument que, les circonstances ne sont plus les mêmes que par le passé, et que cette fois c’est différent, il ne faut pas le croire, comme l’indique le mot de la fin de cette somme : « ça ne l’est presque jamais ».
Reinhart et Rogoff annoncent d’emblée la couleur, dès la deuxième ligne de leur préface : « Le message de notre ouvrage est simple. On a connu de nombreuses crises financières au cours de l’histoire et on en connaitra d’autres, même si chaque nouvelle crise a été précédée d’un déni sous prétexte que les temps avaient changé ». C’est le syndrome du « This time is différent ». Selon leur analyse, la dette accumulée par les États et leurs gouvernements, les banques, les sociétés industrielles, et les particuliers représente un risque systémique bien supérieur à celui imaginé en période d’expansion dans le cycle économique, parce qu’il rend l’économie vulnérable à une crise de confiance. La théorie économique est unanime, à savoir qu’un pays suffisamment frugal est guère vulnérable à une crise de confiance. Un gouvernement n’aura pas à se préoccuper d’avoir à faire face une crise financière d’endettement s’il dégage constamment des surplus budgétaires, qu’il a un taux d’endettement raisonnable, voire faible, qu’il emprunte à long terme, et qu’il n’a pas d’engagements caché.
Il est peut-être un domaine où « This time is different ». Il s’était instauré une certaine complaisance entre les banques centrales et les investisseurs au travers de ce qu’il est convenu d’appeler le « Greenspan put », du nom du président du Reserve Federal Board de 1980 à 2007, fondé sur la croyance que la banque centrale ne monterait pas ses taux d’intervention à la suite d’une hausse significative des prix des actifs financiers, mais qu’il n’hésiterait pas à les baisser au cas d’une chute des marchés. Autrement dit, les marchés financiers étaient persuadés que la FED viendrait au secours des investisseurs, leur permettant ainsi de prendre un pari unidirectionnel. De fait cette croyance a été validée empiriquement, à savoir que la FED a effectivement recouru à des mesures exceptionnelles afin d’enrayer une chute des cours boursiers. Avec le recul, cette position n’est pas tenable : l’objectif d’une banque centrale de lutter contre l’inflation des prix des seuls biens et services ne peut se justifier que dans un environnement où d’autres régulateurs surveillent que l’endettement des agents économiques ne devient pas excessif.
Une nouvelle crise de l’euro?
Que l’on applique à la zone euro la théorie de l’arrêt brutal (sudden stop), conçue et développée pour rendre compte de la fragilité des pays émergents face aux mouvements de capitaux est révélateur d’une certaine fragilité du nouvel ordre économique mondial. Et c’est bien ce qui s’est passé à partir de l’été 2011, comme le rappellent Jacquillat et Levy-Garboua (2014) pour tous les pays de la zone euro, lorsque les investisseurs américains encouragés par la FED, ont décidé de retirer leurs fonds de la zone euro.
Près de 60 ans d’efforts consacrés à la construction européenne ont failli être anéantis par la crise sans précédent qu’a connu l’euro en 2009, cette monnaie de l’Union économique et monétaire (UEM).
Cette crise a fait ressortir les dysfonctionnements institutionnels et des dérives des États européens. Les traités, sorte de règlement de copropriété de l’Europe, qui fixent ses règles de fonctionnement, notamment au niveau financier et budgétaire, c’est bien, à condition de s’y conformer. Cette crise de l’euro a renforcé l’obligation des États de les respecter en mettant les décideurs politiques devant leurs responsabilités : davantage de solidarité ex ante, mais aussi davantage de sérieux en contrepartie, plus de coordination et d’intégration dans les secteurs apparus comme les plus dangereux dans la crise de l’euro, avec davantage de fédéralisme réglementaire pour faire de celle-ci un ensemble cohérent dans le domaine monétaire et financier et créer une réelle union bancaire. Mais il y a des zones où l’Europe n’a pas vraiment pénétré. C’est là que le bât blesse : comment imaginer une convergence structurelle et éviter que se produisent de nouveaux déséquilibres à l’avenir, c’est-à-dire de nouvelles cures d’austérité, si tout ce qui a trait au marché du travail, aux prix et aux salaires, à la fiscalité, bref aux facteurs de compétitivité, est encore susceptible aujourd’hui de divergences significatives d’un pays à l’autre. Cette crise de l’euro n’a pas permis à l’Europe de vivre son moment hamiltonien, du nom d’un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique qui a ouvert la voie du fédéralisme. Mais il semble qu’on s’en rapproche.
Une crise boursière imminente ?
On le sait depuis aussi longtemps que l’information existe, les médias parlent rarement des trains qui arrivent à l’heure, mais sont friands d’informer sur les dangers qui menacent. Il en va ainsi du regard que portent les experts des marchés financiers sur les actions. Faire des prévisions boursières annonçant un désastre imminent est une activité très répandue, alors que ceux dont les scénarios sont plus optimistes sont ignorés. Et depuis des années les commentateurs spécialisés ne cessent d’annoncer la fin du cycle haussier des actions, il est vrai le plus long de l’histoire si l’on met entre parenthèses la cassure provoquée par la pandémie du Covid-19. Ces prophètes de malheur dressent un inventaire à la Prévert de tous les risques qui nous entourent : les prix des actions et des autres actifs financiers sont beaucoup trop élevés. La hausse des prix énergétiques et des denrées alimentaires va casser la reprise économique mondiale, et provoquer une nouvelle crise économique. L’inflation qui a pointé le bout de son nez en milieu d’année 2021, s’est accentuée en début d’année 2022, contrairement aux allégations des banquiers centraux, pour qui les hausses de prix constatées de ci delà n’étaient que des saillies temporaires, les avatars du fort rebond économique qui a suivi la pandémie. Le spectre de la stagflation, comme celui qui a suivi les Trente Glorieuses en France, est même brandi !
La valorisation actuelle des actions
Mais il existe des outils qui permettent, sinon de répondre à l’interrogation sur une possibilité de crise boursière, du moins de mieux l’appréhender. Ils sont fondés sur la valorisation des marchés d’actions. Pour ce faire, il convient de se référer à l’équation fondamentale de valorisation des actions. Leur niveau est déterminé par la valeur actuelle (les taux d’intérêt) des cash flows (et la croissance future de ceux-ci) dégagés par les sociétés. Pour rendre opérationnels ces concepts, il convient de mettre en rapport le taux de rentabilité escompté sur les actions qui résulte de cette modélisation avec le taux du placement alternatif naturel, celui des obligations à long terme. On donne souvent l’appellation de prime de risque de marché à l’écart entre ces deux taux. Historiquement, celui-ci a été de l’ordre 5%, et s’est accru progressivement pour atteindre une moyenne de l’ordre de 7% depuis le début de la présente décennie. Cet écart donne des indications particulièrement éclairantes lorsqu’il s’éloigne par trop de sa moyenne historique dans un sens ou dans un autre. Faible, il incite à se détourner du marché des actions. En effet, à quoi bon prendre des risques pour un surcroît de rémunération des actions très réduit par rapport à un placement sans risque. C’était notoirement le cas à l’été 2007 à la veille de la crise des subprimes. A moins de 3%, cet écart incitait fortement à délaisser le marché des actions. Et à juste titre. A l’inverse, fin mars 2020, au début du déclenchement de la pandémie aux effets potentiellement redoutables, la prime de risque avait dépassé 11%. Aujourd’hui, et malgré les craintes et les risques que nous venons d’évoquer, de récession, de hausse de l’inflation et de remontée des taux d’intérêt, la prime de risque de marché se situe aujourd’hui à sa moyenne historique récente de l’ordre de 7%, au-dessus de sa moyenne longue, ne donnant assurément pas d’indication péremptoire d’imminence d’une crise boursière.
La valorisation des actions dans le temps long
Au-delà de ces considérations conjoncturelles, la prise en compte du temps long est pleine d’enseignements, comme le suggèrent les travaux de deux universitaires européens, Kuvshinov et Zimmermann (2022). Ceux-ci rappellent les principales caractéristiques de l’évolution des marchés financiers de 1870 à aujourd’hui, dans 17 économies développées.
La hausse des capitalisations boursières depuis la fin des années 1980 est essentiellement le fait de la hausse des cours des actions des sociétés cotées. De telle sorte que le ratio des capitalisations boursières de ces pays à leur PIB respectif est passé de 0,2 au début des années 1980 à environ 1 aujourd’hui. Malgré les corrections boursières des années 2000 et 2008-2010, ce ratio est devenu trois fois supérieur à ce qu’il était pendant la plus grande partie du 20e siècle. Cette observation ne concerne pas que le marché américain. Ainsi, pour la France, le ratio moyen de la capitalisation boursière au PIB avait une moyenne de 0.6 entre 1880 et 1914, redescendue à 0,2 entre 1960 et 1990, et de plus de 0 ,7 depuis. De même en va-t-il des 17 plus grandes économies, pour lesquelles le niveau qu’a atteint ce ratio à la suite de sa hausse spectaculaire depuis la fin des années 1980 est particulièrement persistant. Aucune période de hausse des marchés dans l’histoire financière n’a duré aussi longtemps que cette chevauchée fantastique des trente dernières années. Sans doute celle-ci est-elle la traduction patrimoniale d’un certain nombre de phénomènes disruptifs qui font travailler la poutre boursière, dont la destruction créatrice provoquée par les innovations technologiques, comme évoqué plus haut. Par ailleurs les perspectives démographiques et de répartition des revenus tirent les taux d’intérêt et les taux d’inflation vers le bas, comme le rappellent Milan, Straub et Sufi (2022). La démographie vieillissante que nous connaissons contribue à la baisse des taux d’intérêt réels et sa poursuite devrait contribuer à une baisse progressive supplémentaire de l’ordre de 100 points de base. L’impact sur les marchés d’actions serait direct. En effet les prix des actions représentant la valeur actuelle de leurs flux futurs, celle-ci est d’autant plus élevée que les taux sont durablement faibles. Un autre facteur selon eux impacte les taux d’intérêt dans le sens de la baisse, celui des inégalités, du fait de l’augmentation de la part des revenus des ménages riches dans le PIB, et de l’augmentation de leur épargne, et donc du taux d’épargne global. Même si les inégalités devaient se résorber, cela ne pourra se réaliser que progressivement.
Quelques propositions
La croissance économique
A plusieurs reprises, et notamment en évoquant le niveau d’endettement mondial et la valorisation des marchés d’actions, nous avons mentionné qu’une croissance économique soutenue contribuait à l’échelle mondiale comme à celle de la France, à diminuer le risque une crise financière. Si l’on examine le poids des dépenses publiques dans les pays de la zone euro par rapport à leur PIB, le taux le plus faible est celui de l’Irlande de 25%, le plus élevé est celui de la France, de 61%. Un poids élevé des dépenses publiques rapporté aux PIB est associé à une croissance faible, avec des gains de productivité et un taux d’emploi faibles. Il est aussi associé à des inégalités de revenus (après redistribution) et une proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté faibles. L’un des moyens à privilégier pour réduire l’endettement des États et notamment celui de la France est de dégager des surplus budgétaires, et donc de favoriser la croissance économique.
Les signaux annonciateurs
Qu’il serait confortable de disposer pour chaque type de crise financière, dette souveraine, autres dettes, immobilier, changes, marché financier, etc. d’une batterie d’indicateurs qui signaleraient à l’avance la possibilité d’une prochaine crise. La littérature académique s’est penchée sur cette question à l’occasion de certaines crises passées. Il apparaît que les prix de l’immobilier représentent un facteur critique dans le déclenchement et l’origine de beaucoup de crises financières, et de situations de surendettement. Mais là encore les bases de données sont notoirement insuffisantes et de qualité médiocre. Cette méthode des signaux précurseurs n’est pas la panacée. Elle ne permet pas à l’évidence de donner la date exacte de l’éclatement d’une bulle, ni même la sévérité de la probable crise à venir. Mais la principale barrière à la constitution de telles bases de données est de nature cognitive. Les décideurs n’y croient pas, et ce pour plusieurs raisons. La première c’est que ce genre de proposition est examinée lorsque le soufflé est retombé, que le calme est revenu, voire que la phase suivante du cycle, c’est-à-dire la reprise, s’est enclenchée. La seconde a trait à la fiabilité de ces systèmes d’alerte. Alan Greenspan à qui avait été proposé un système d’alerte concernant le marché des actions fondé sur la comparaison d’une prime de risque de marché avec sa moyenne historique. Bien que ce système ait donné par le passé des résultats très encourageants, Alan Greenspan écarta d’un revers de la main l’adoption de cet instrument destiné à contrer les bulles qui se développeraient sur les actions. Selon ces propres termes, il préférait réparer une économie en crise économique et financière que risquer de la casser alors qu’elle était en plein boom. On se souvient de la boutade de McChesney Martin, le lointain prédécesseur de Jay Powell à la tête e la FED : le job le plus difficile d’un banquier central c’est d’avoir à retirer la bouteille de rhum au moment où la party bat son plein.
Le rôle des institutions financières internationales
Les institutions financières internationales peuvent jouer un rôle éminent dans l’écosystème de la prévention des crises financières, d’abord en favorisant la transparence dans la publication des données, et aussi en renforçant les réglementations en matière d’endettement. Comme on l’a déjà évoqué, le cœur du problème se situe au niveau des É tats qui devrait s’astreindre à fournir davantage d’informations concernant l’endettement public entendu au sens large. Là encore, prôner la transparence est plus facile à dire qu’à faire, car les incitations des responsables politiques à rendre opaques les comptes sont plus fortes que celles de pratiquer la transparence.
Conclusion
On l’aura compris, « Éviter la prochaine crise financière » s’apparente à la quête du graal, une tâche presque impossible tant la mémoire se dissipe avec le temps, celle des créanciers et des débiteurs, des décideurs politiques, comme celle des universitaires et du public en général. La nature humaine étant ce qu’elle est, des crises financières, il y en aura d’autres.
Toutefois, il ressort que dans l’environnement actuel, une prochaine crise financière ne devrait pas trouver sa source dans des difficultés particulières au sein de la zone euro ou le marché de l’immobilier même si certaines tensions y sont apparues. L’endettement des États sera soutenable si la croissance économique mondiale reste élevée et la gestion budgétaire des États raisonnable, permettant de dégager des surplus budgétaires. Une crise boursière circonscrite aux actions ne devrait pas franchir l’agora des médias. Nulle part entend-on dans les médias que la valorisation des actifs financiers est parfaitement justifiée, ou des experts financiers affirmer que celles-ci a toutes les raisons de continuer à augmenter. Au contraire. Alors, « Is this time different ? » Cela ne l’est jamais, mais aussi pour d’autres raisons que celles mises en avant dans leur ouvrage par Reinhart et Rogoff. Il y aura toujours des prophètes de malheur. Et plus ils crient fort, comme c’est le cas depuis une certain temps, plus il convient de conserver son sang-froid !
Bibliographie
- Aghion Philippe, Antonin et Bunel, (2021), Le pouvoir de la destruction créatrice, Odile Jacob.
- Bernanke Ben, 2000, Essays on the general depression, Princeton University Press.
- Reinhart Carmen M. et Kenneth S. Rogoff, 2009, This time is different, Eight centuries of financial folly, Princeton University Press et Oxford.
- Trichet Jean-Claude, 2021, « La santé de l’économie française », Revue Commentaire, 175.
- Pébereau Michel, 2005, Rapport sur la dette publique, La documentation Française.
- Kuvshinov Dimitry et Kaspar Zimmermann, 2021, “The Big Bang :Stockmarket Capitalization in the long run”, Journal of Financial Economics.
- Friedman et Anna Schwartz, 1963, A monetary History of the United States, Princeton University Press.
- Reinhart Carmen et Belen Sbrancia, 2018, The liquidation of government debt, International Monetary Fund, working paper.
- Keynes John M., 1936, The general theory of employment, interest and money, McMillan.
- Jacquillat Bertrand et Vivien Levy-Garboua, 2014, Les 100 mots de la crise de l’euro, PUF
- Jacquillat Bertrand et Vivien Levy-Garboua (2013, 5ieme ed.), Les 100 mots de la crise financière, PUF.
- Milan Atif, Ludwig Straub et Amir Sufi, 2022, The saving glut of the rich, Harvard University, working paper.