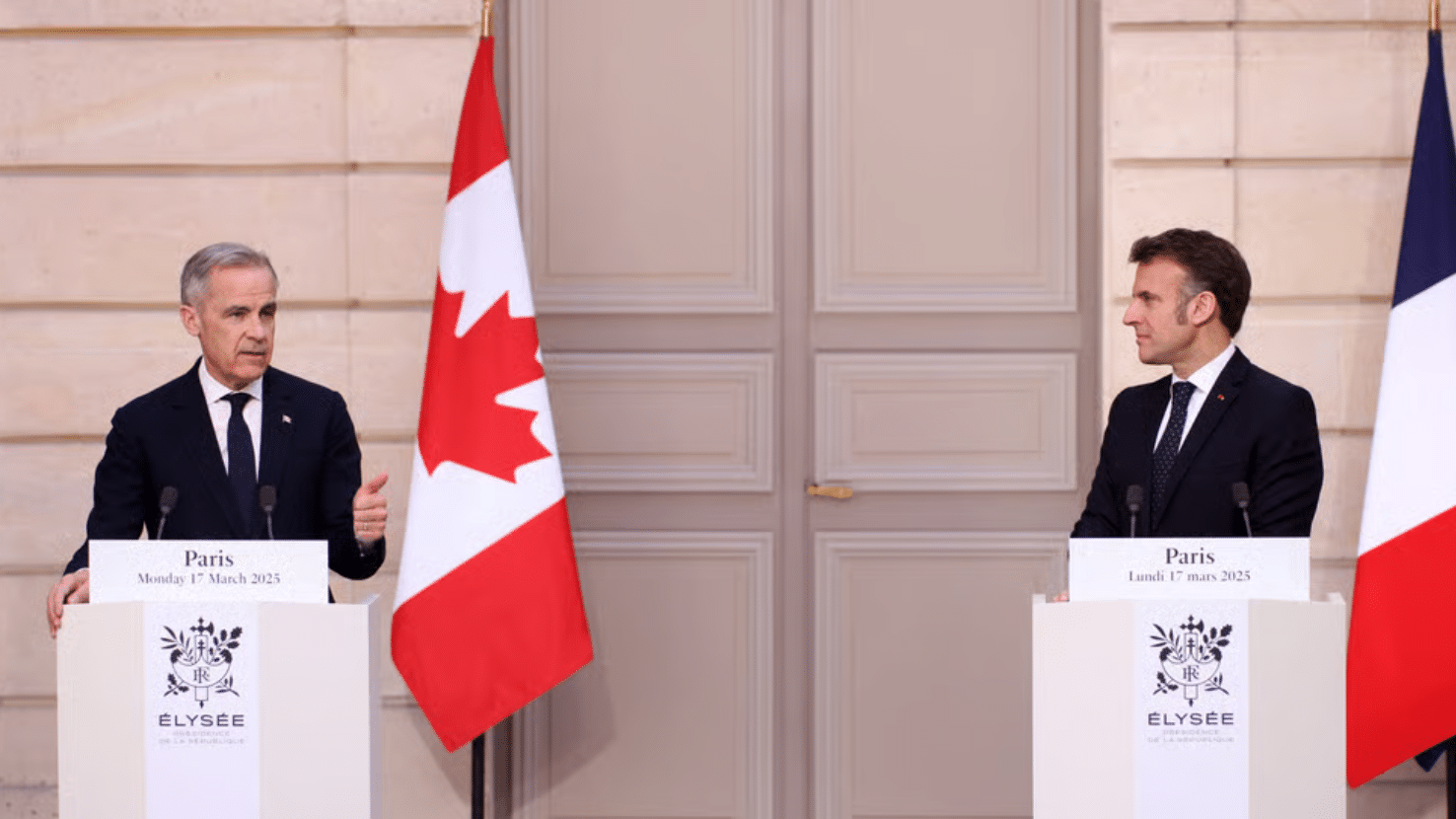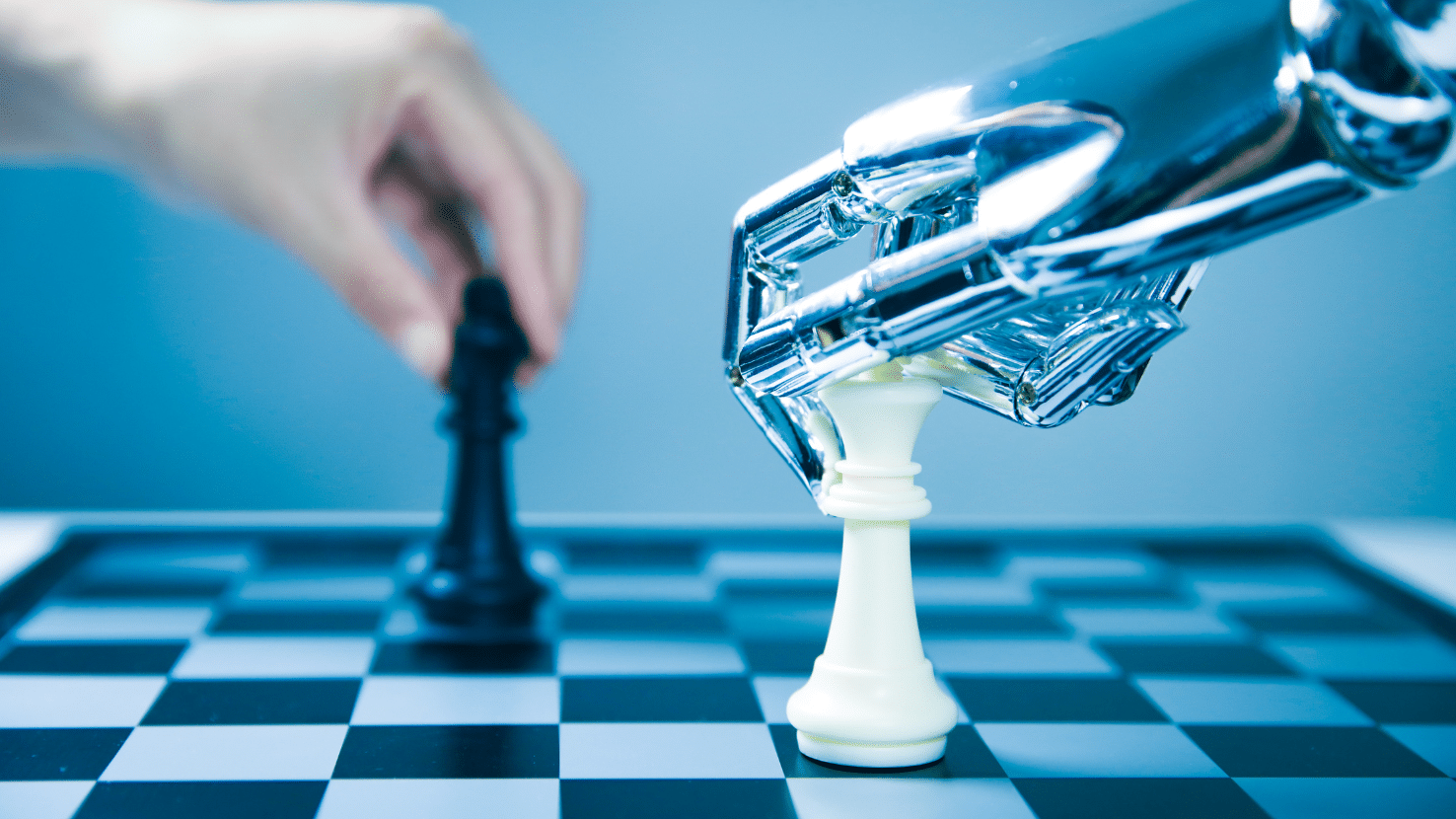Les cours du brut américain dévissaient, lundi 20 avril, sur le marché asiatique. Le baril chutait de 20% à 15 dollars l’unité, son plus bas niveau depuis plus de 20 ans. Selon Patrice Geoffron, un nouveau choc pétrolier n’est pas exclu et il convient de prendre la menace au sérieux dès aujourd’hui.
Nous sommes une semaine après la conclusion de l’accord de l’OPEP+ – encouragé par les États-Unis dans la coulisse – ouvrant sur une réduction de la production de 10 millions de barils par jour (mb/j), soit 10 % de l’approvisionnement mondial. Au-delà de cette coalition – structurée autour de l’Arabie Saoudite et de la Russie – les producteurs dont les coûts sont les plus élevés (États-Unis, Canada, Norvège, Brésil, etc.) verront aussi leurs volumes reculer, l’ensemble contribuant à une baisse globale voisine de 20 mb/j.
Bien que cette amputation de l’offre présente un caractère historique – à l’image d’une crise sans précédent – son annonce n’a pas suffi à interrompre la chute des cours : le baril de WTI (la référence de brut nord-américaine) a encore reculé de plus de 20% en une semaine, sous les 20 dollars. Comme le Brent (la référence du brut de Mer du Nord) est 10 dollars plus cher, cet écart traduit la violence du choc pour l’industrie américaine du pétrole de schiste.
L’impossible endiguement de la chute se lit dans les statistiques de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) qui anticipe, pour Avril, une baisse de la demande de 29 mb/j – comparativement à 2019 – retour à la consommation de 1995. Comme l’AIE envisage un recul voisin en Mai (26 mb/j), aucun accord réaliste de réduction pourrait raviver les prix : l’extraction interdit les arrêts brutaux, de sorte que les capacités de stockage sont engorgées, y compris dans des tankers loués pour stocker à l’arrêt des volumes de pétrole.
Les cours du pétrole sont ainsi revenus au niveau du début du siècle, avec un effondrement plus marqué encore qu’après la faillite de Lehman Brothers en 2008. Vu de l’Union Européenne, qui importait environ 1 milliard d’euros de produits pétroliers ou gaziers par jour, la pente naturelle pourrait être d’anticiper des prix durablement bas, favorables à une relance de l’économie. Pour juger de l’enjeu observons que, durant la décennie 2010, la facture d’importation de la France aura varié de 40 milliards d’euros (soit 1,5% du PIB) au gré des oscillations du baril.
Or, rien ne garantit qu’un tel effet d’aubaine soit durable, et l’Europe doit se soumettre au « stress test » d’un prochain choc pétrolier. Tout d’abord, une éventuelle reprise économique tirera mécaniquement les prix vers le haut : entre 2009 et 2011, le baril est repassé de 40 à 120 dollars environ. Ensuite, et surtout, l’industrie pétrolière aura été bien plus durement frappée que lors de la crise des subprimes : une partie de l’industrie américaine aura été acculée à la faillite, tandis que des pays producteurs fragiles auront été déstabilisés par une baisse de leurs revenus comprise entre 50 et 85 %. D’ores et déjà, les compagnies pétrolières ont réduit leurs investissements dans l’exploration-production, dans une proportion de 20 à 35% (AIE). Notons aussi que Shell a récemment dévoilé son objectif de neutralité carbone en 2050, comme BP il y a quelques mois.
Ces facteurs obligent à anticiper que, à plus ou moins brève échéance dans le cours de la décennie, des barils manqueront, un risque de choc pétrolier étant réel. Risque qui doit être intégré dans le débat sur la relance en Europe (« business as usual » versus « green deal »). Et, spécifiquement pour la France, retenons que la crise de gilets jaunes, dans le monde « d’avant », avait été déclenchée par un choc pétrolier. Au total, la menace d’un tel choc doit être prise en compte dans le débat sur la résilience de notre société.