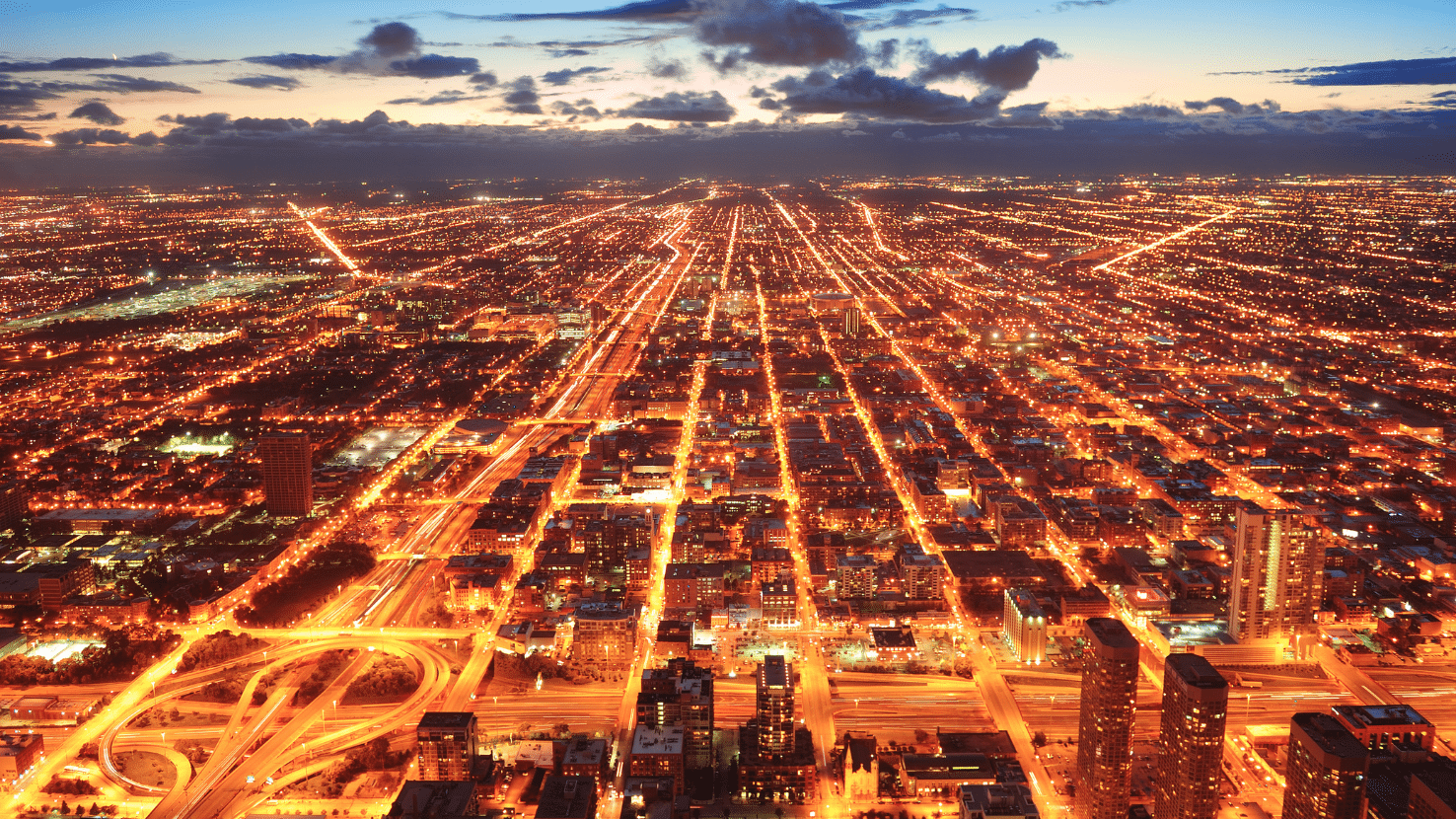Pour être juste, le prix d’un médicament doit être suffisamment bas pour les patients qui en ont besoin ou pour leurs assureurs, selon Pierre-Yves Geoffard. Mais il doit aussi être assez élevé pour que l’anticipation des profits incite les labos à s’engager dans la R & D. Le mieux, pour résoudre ce conflit, est de se fonder sur l’utilité sociale d’un médicament pour fixer son prix.
En mai dernier, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé, s’est tenu à Johannesburg le Fair Pricing Forum. Ce forum fut l’occasion pour de nombreux intervenants, associatifs, gouvernementaux, professionnels, d’échanger autour de la question du médicament, et notamment de son prix. Le principal mode de financement de l’innovation repose sur la propriété intellectuelle : une entreprise qui a démontré, grâce à des essais cliniques, qu’elle était en mesure de produire un médicament utile peut se voir accorder un brevet. Ce brevet lui permet alors de négocier avec les financeurs des soins à un prix supérieur au coût de production, et ces profits viennent récompenser l’innovation socialement utile. En amont de cette récompense, c’est la perspective de profits qui incite les labos pharmaceutiques à entreprendre des recherches souvent longues, coûteuses, et incertaines.
De fait, les entreprises pharmaceutiques produisent non seulement des médicaments, qui sont un bien privé, mais aussi de la connaissance sur l’efficacité de tel ou tel produit ; or cette connaissance, comme toute information, est un bien public. Le financement de l’innovation repose donc sur la privatisation temporaire, jusqu’à la fin du brevet, d’un bien public. Après l’expiration du brevet, la concurrence est souvent vive, et la faiblesse des marges rend parfois fragile les producteurs, comme l’attestent les ruptures d’approvisionnement de nombreux médicaments dont le brevet est expiré.
Toutefois, pendant la durée de protection du brevet, le producteur jouit d’un pouvoir de monopole. Le prix alors pratiqué est-il « juste » ? Pour être juste, le prix doit être suffisamment bas pour être abordable par les patients qui en ont besoin, ou par leurs assureurs, publics ou privés ; mais il doit également être assez élevé pour que l’anticipation des profits incite les labos à s’engager dans la recherche et le développement.
Brouillard autour des prix
La meilleure manière de résoudre ce conflit est de définir un prix qui repose sur l’utilité sociale du médicament, et sur un partage équitable de cette valeur entre le producteur et les usagers. Un tel mode de fixation du prix, assis sur la valeur, ne nécessite pas d’estimer les coûts de production ni de s’interroger sur la légitimité des profits dégagés : en effet, on ne voit pas bien pourquoi un médicament qui coûterait cher à produire mais n’apporterait qu’un bénéfice thérapeutique modéré devrait obtenir un prix élevé. La demande de transparence qui s’est manifestée au forum de Johannesburg au sujet des coûts de production ou de recherche et développement paraît à ce titre déplacée.
En revanche, à juste titre, le forum a rappelé le brouillard qui entoure souvent les prix pratiqués. C’est notamment le cas en France : certes, les médicaments délivrés en pharmacie le sont à un prix facial, négocié avec les organismes d’assurance, en apparence clair et transparent. Mais, en même temps que le prix public, la négociation porte sur des remises auxquelles consent le laboratoire, en particulier en cas de volume important de ventes. Le prix réellement payé par l’assurance, déduction faite de ces remises, est totalement opaque. Or le montant annuel des remises, tous médicaments confondus, est de plus en plus élevé : moins de 300 millions en 2009, contre plus de 2 milliards d’euros en 2018. D’après une étude récente de la DREES, les remises, et donc l’opacité, seraient encore plus élevées en Allemagne. Si ce manque de transparence sur le prix du médicament n’est pas propre à la France, il reste profondément délétère.