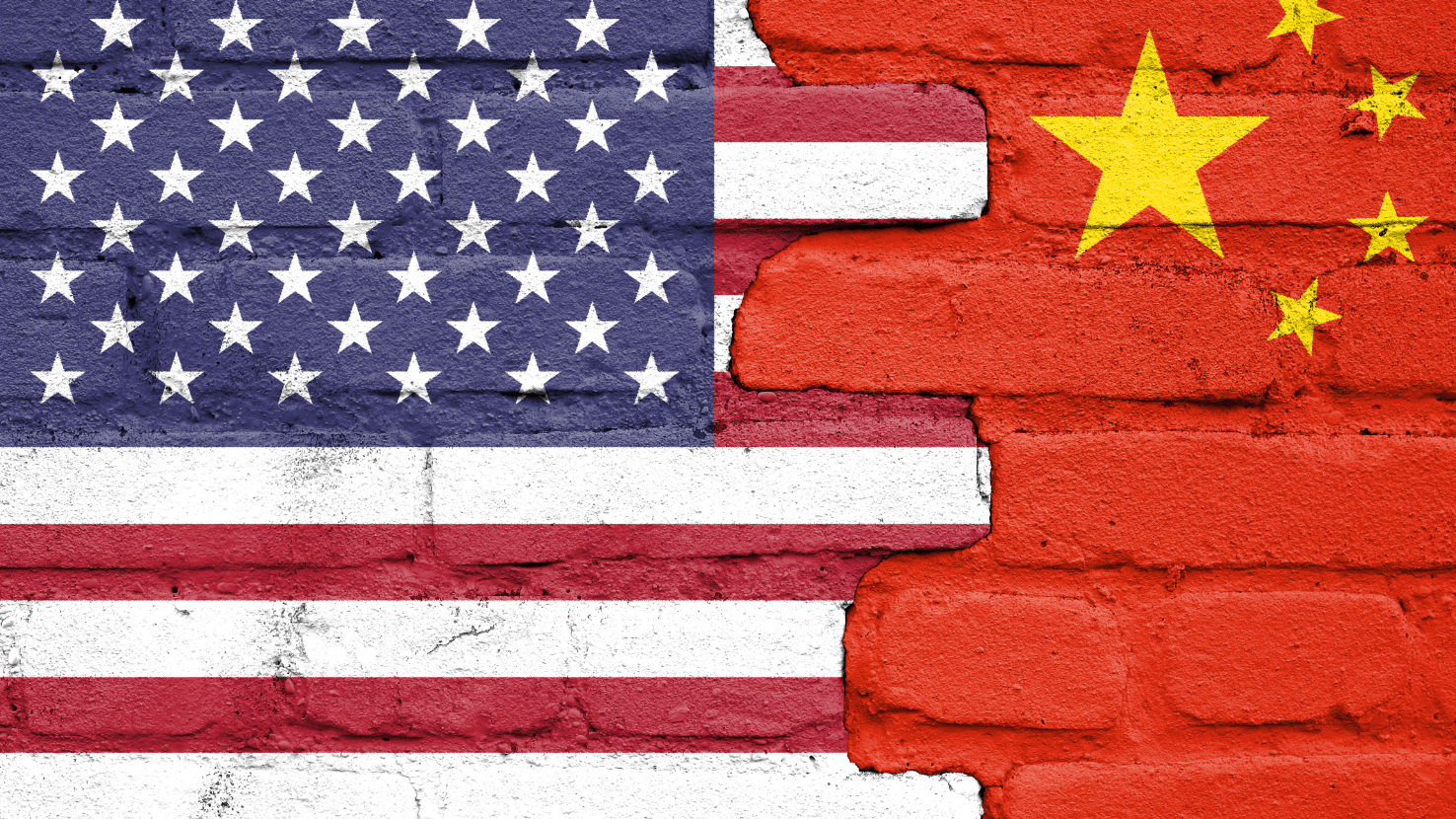Coincés entre les perspectives moroses de la demande en raison de la pandémie et une offre en hausse, les cours du pétrole sont actuellement chahutés. Patrice Geoffron explique pourquoi la crise sanitaire pourrait être le choc de trop pour cette industrie fragilisée.
Situé aux alentours de 40 dollars, le prix du baril est sorti des abîmes où l’avait plongé le confinement généralisé en mars. Ce n’était pas seulement le choc macro-économique qui avait conduit à cet effondrement (jusqu’en « territoire négatif » -40 dollars sur le débouclage de certains contrats aux États-Unis), mais l’éclatement de la coalition russo-saoudienne jusqu’alors alliée pour piloter les volumes de production. La guerre des prix entre russes et saoudiens révélait alors que la pression trumpienne à extraire sans retenue du pétrole (et du gaz) avait laminé les mécanismes de régulation des prix.
Si un armistice a rapidement dû être signé au printemps dernier, la capacité à contenir durablement l’offre est fragile : à la mi-septembre, lors du 60ème anniversaire de l’OPEP, le ministre saoudien de l’Energie a dû tancer le Nigeria et l’Irak accusés de ne pas respecter leurs quotas. Avec d’autant plus de vigueur que, l’éventuelle progression de la production en Lybie constitue également une menace. Surtout, la Russie reste en « embuscade » et a déjà annoncé sa résolution d’accroître sa production en 2022, façon d’annoncer qu’elle n’est pas en charge durable de la gestion du marché, et de mettre la pression sur les saoudiens et les américains (qui forment avec elle le trio de tête de la production mondiale).
La crise sanitaire constituera peut-être le choc de trop pour un secteur déjà fragilisé par des prix erratiques depuis le milieu des années 2010. Ces années d’instabilité ont traumatisé l’industrie dans son ensemble, producteurs américains compris. Au sortir de la crise sanitaire, une partie significative de l’industrie américaine pourrait être acculée à la faillite, tandis que des pays exportateurs fragiles auront subi une baisse de leurs revenus comprise entre 50 et 85% (selon l’Agence Internationale de l’Energie).
Ces bouleversements surviennent dans un marché déjà perturbé par des incertitudes géopolitiques perceptibles, à une insécurité latente dans le détroit d’Ormuz. D’ores et déjà, les compagnies pétrolières ont réduit leurs investissements dans l’exploration-production, dans une proportion comprise entre 20 et 35%. Shell et Total ont même annoncé un objectif de neutralité carbone pour 2050, comme BP quelques mois auparavant ; certes, la crédibilité de ces engagements (jugés insuffisants par l’ONG Oil Change) devra être scrutée, mais il est évident que les majors européennes réduiront leur exposition aux risques de fluctuations du prix du brut (minorant leur appétit pour l’exploitation de gisements à coûts élevés).
Et ce n’est à l’évidence pas du côté de la demande que l’industrie pétrolière trouvera matière à éclairer son avenir : une seconde vague dans la crise sanitaire ouvrirait sur une terra incognita au plan macroéconomique, avec un stress durable sur les consommations de produits pétroliers, et sans doute de nouvelles organisations socio-économiques (télétravail, télé-enseignement, …), une pression sur les chaînes logistiques longues.
Sans compter que, selon le résultat de leurs élections, les Américains pourraient revenir dans le périmètre de l’Accord de Paris sur le climat, aux côtés des Européens et des Chinois. L’industrie pétrolière se préparait (avec plus ou moins d’allant) à des transformations drastiques au cours de prochaines décennies dans le cadre de la lutte climatique : il est possible que la Covid-19 ait singulièrement rapproché l’horizon du changement.