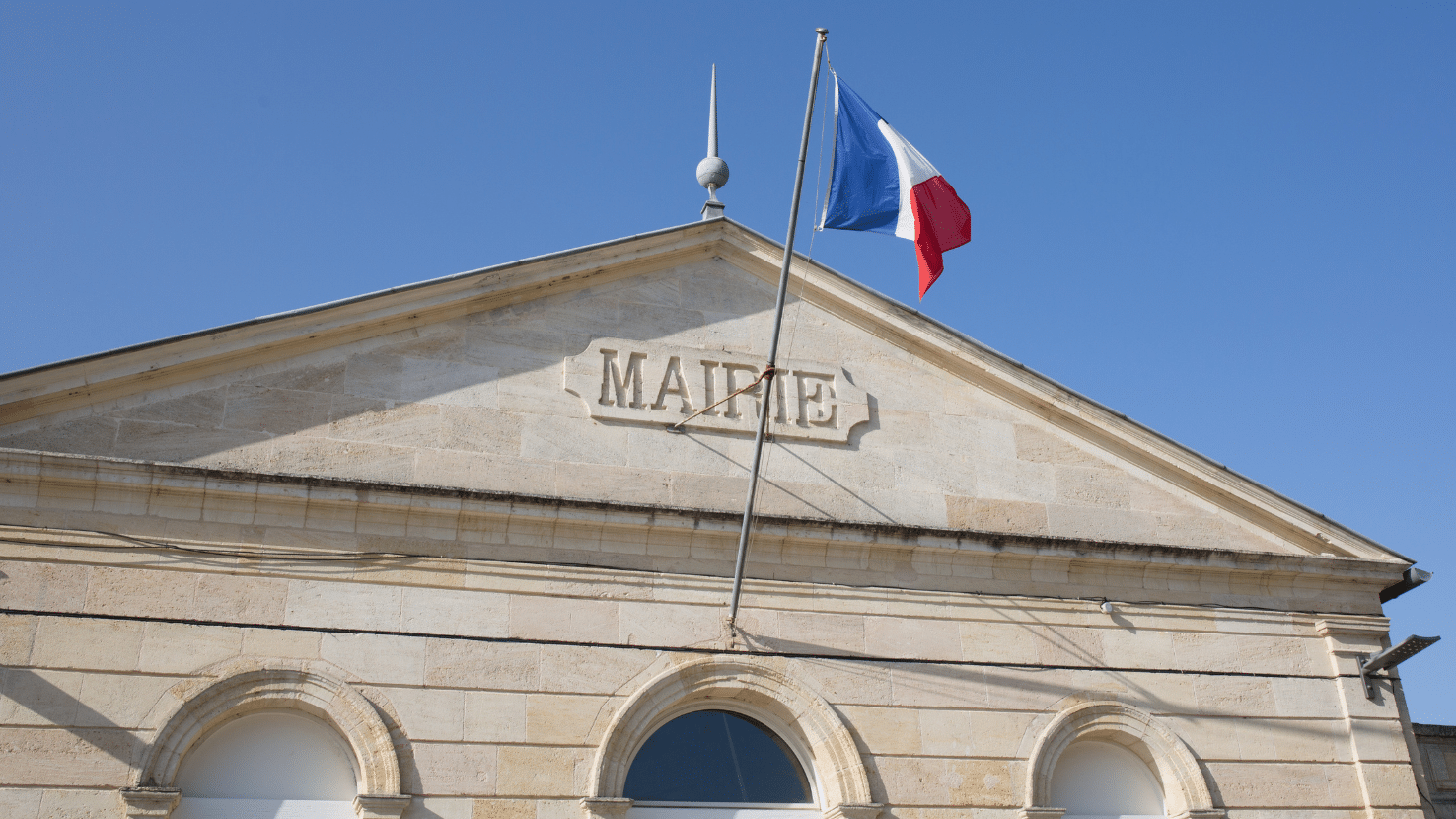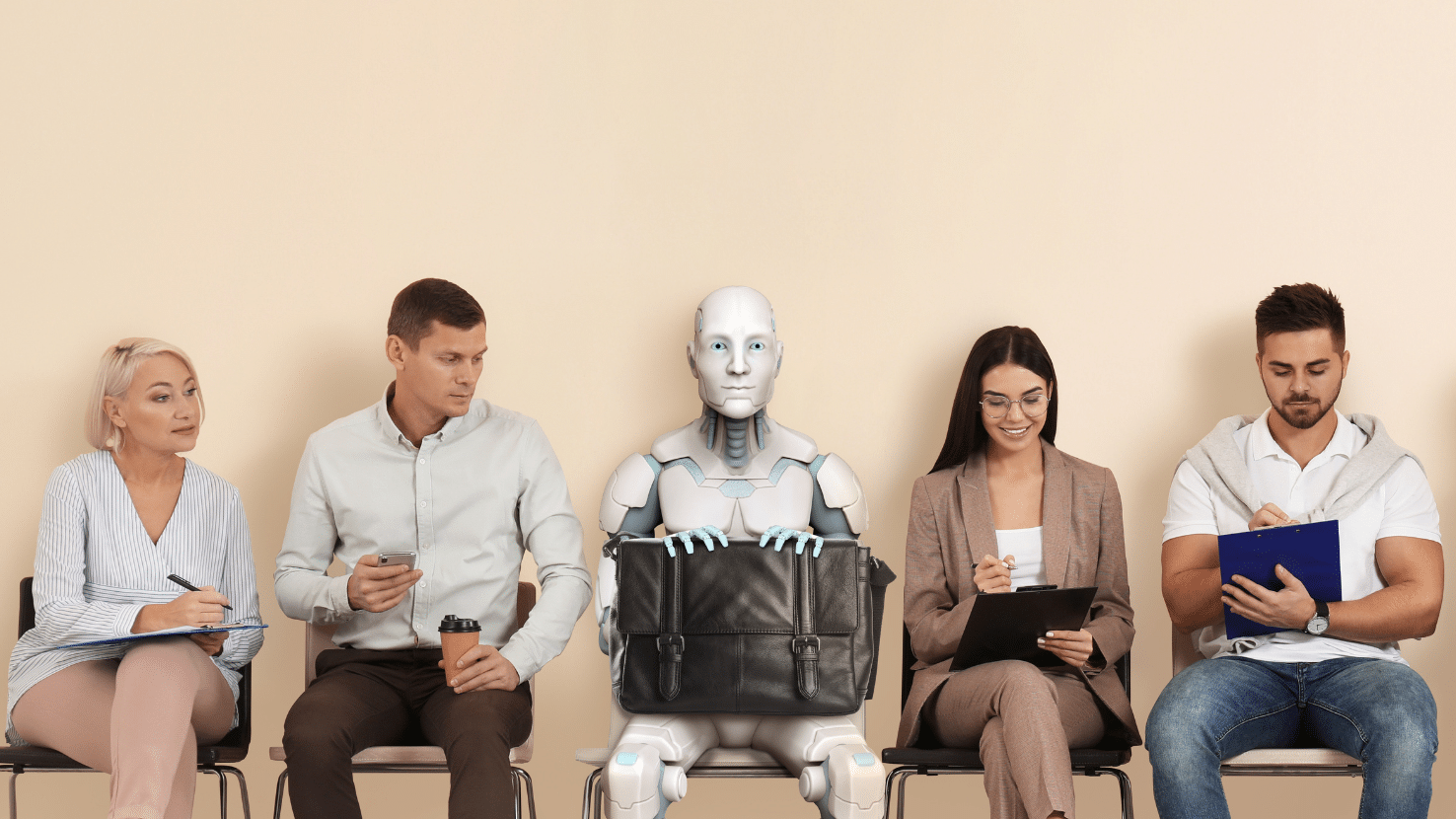Les plans de soutien et de relance de l’économie frappée par la pandémie posent la question du remboursement de la dette qui s’accumule. Pour Philippe Trainar, une fois le moment venu, il faudra répartir le poids de la couverture des déficits sur l’ensemble des français, mais en prenant les précautions d’usage.
Les experts indépendants de l’OCDE prévoient une explosion historique du poids des déficits publics dans le PIB, de 3% en 2019 à 9,5% en 2020 et 7,4% en 2021 en France ; de 0,6% en 2019 à 8,6% en 2020 et 6,5% en 2021 au sein de la zone euro et de 3,0% en 2019 à 11,5% en 2020 et 8,4% en 2021 en moyenne dans l’OCDE.
Le poids de la dette publique dans le PIB atteindrait près de 117%, voire 122%, en France en 2021 et 105% au sein de la zone euro. Dans les économies avancées, le poids de la dette publique dépasserait le niveau qu’elle a atteint à l’issue de la seconde guerre mondiale (124%). Sans compter que les entreprises vont-elles-mêmes sortir de la crise beaucoup plus endettées. Cette accumulation impressionnante de déficits publics posent naturellement la question de leur soutenabilité.
Certains proposent de rétablir la situation en annulant tout simplement une large fraction de la dette publique, notamment celle détenue par les banques centrales… si ce n’est que cela laisserait les banques centrales totalement désarmées en cas de dérapage de l’inflation. D’autres proposent de mener une politique monétaire délibérément inflationniste qui permettrait de dévaloriser la dette. Dans les deux cas on laisse au marché le soin de déterminer, par le biais de l’inflation incontrôlée, qui devra payer. Les optimistes suggèrent une politique du « benign neglect », qui n’est soutenable que par les pays dont le poids de la dette est comparativement moins élevé.
L’on entend sinon la clameur de ceux qui réclament que l’on fasse payer les riches. Malheureusement, cette solution qui a fait la fortune de l’état providence semble avoir atteint aujourd’hui ses limites : les taux d’intérêt sont négatifs en Europe et les dividendes devraient y avoir chuté de 40%. Accroître les prélèvements sur le capital ne ferait que déstabiliser encore plus l’investissement et handicaper le redressement de l’économie. Plus subtils, certains suggèrent que l’on se contente de ponctionner les revenus accumulés dans les paradis fiscaux. Le problème est que cette solution n’est pas aisée à mettre en œuvre rapidement et que sa rentabilité est limitée au-delà du très court terme.
Certes, on aimerait appeler à contribution ceux qui ont bénéficié de la crise sanitaire mais il restera difficile avant quelques années de déterminer avec certitude les gagnants de la crise. En outre, l’industrie pharmaceutique peut en faire partie, mais il ne saurait être question de la fragiliser au moment où nous avons le plus besoin d’elle. Faut-il alors se tourner vers la classe moyenne, dont les salaires ont continué à augmenter, ou vers les ménages les moins fortunés, dont les prestations sociales ont été comparativement mieux revalorisées ? Politiquement impossible, cette solution n’a en outre guère de sens économique au moment où ces catégories sociales risquent d’être frappées par le chômage.
Alors que faire ? En fait, il va falloir, pour une fois, se résoudre à répartir le poids de la couverture de ces déficits sur l’ensemble des français, en jouant à la fois sur les recettes et les dépenses, notamment sociales, de façon à s’assurer que le partage de la charge entre les différentes parties prenantes soit suffisamment équitable sans être excessivement inefficace, ce qui exclut tout à la fois une hausse significative des prélèvements obligatoires, surtout si son assiette est concentrée, et une baisse substantielle des prestations sociales.