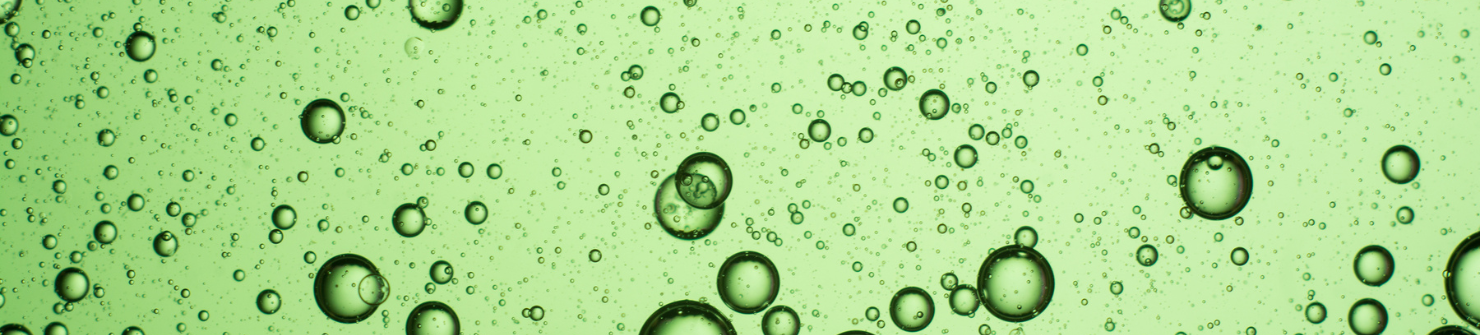L’impôt dit beaucoup du rapport à l’État et à la société. Selon Victor Fouquet et Jean-Baptiste Noé, si les Français souhaitent la baisse des impôts, ils justifient toujours leur existence au nom de la « justice sociale » et d’une égalité dévoyée, se réjouissant de « faire payer les riches et les entreprises », tout en développant pour leur compte propre des stratégies affinées d’évitement de l’impôt.
Cet article est extrait du quatrième numéro de la revue Mermoz, « Aux impôts, citoyens ! ».
Au cours de l’histoire, trois fonctions de l’impôt se sont déployées, qui aujourd’hui se cumulent. Un impôt proportionnel « financeur », destiné à financer les dépenses de l’État jusqu’à la sphère sociale ; un impôt progressif « égalisateur », conçu comme un instrument de redistribution des richesses et de correction des positions sociales, indépendamment des besoins et des missions légitimes de l’État ; un impôt « comportemental », employé pour rééduquer les individus et façonner leurs modes de vie, à travers par exemple la taxation du tabac et des boissons sucrées, ou les malus écologiques. Étudier la philosophie de l’impôt, c’est donc entrer dans le rapport compliqué des Français à l’égard de la dépense publique, du rôle de l’État et des relations avec leurs voisins. Si chacun est d’accord pour demander une fiscalité « juste », tous veulent que celle-ci frappe autrui tout en épargnant leur propre personne. L’impôt devient souvent un instrument de spoliation légale au service de la jalousie et de l’envie.
L’impôt : le grand inconnu
Le premier malentendu concernant les impositions vient du fait que leur nature et leur fonctionnement sont largement inconnus des Français. Qui peut distinguer aisément la différence entre un impôt, une taxe, une contribution ? Le deuxième malentendu provient de l’absence de compréhension des mécanismes de l’impôt et du système de prélèvements obligatoires. Pour beaucoup de Français, payer des impôts, c’est payer l’impôt sur le revenu. C’est alors une gageure que d’expliquer que l’« IR » n’est pas le seul impôt, ni même le premier par son rendement budgétaire. La distinction entre impôt direct ou indirect, dont dépendent en large part les phénomènes d’incidence et de répercussion fiscales, est tout aussi malaisée. Sans parler des cotisations « employeurs » dont l’écrasante majorité des salariés demeure persuadée qu’elles sont payées par leur patron, sans comprendre que c’est sur leur salaire brut que les sommes sont prélevées.
Le brouillard de guerre autour de l’impôt empêche toute conversation, toute réflexion, toute discussion. Témoin la Sécurité sociale : quel électeur sait combien il paye chaque mois en CSG et cotisations diverses pour financer cette structure ? Le même problème s’est posé au moment de la réforme des retraites, avec une totale confusion entre répartition et capitalisation. Là encore, quel contribuable sait exactement, y compris après avoir jeté un coup d’œil à son bulletin de salaire, combien il paie pour la caisse retraites ? Les prélèvements obligatoires sont donc omniprésents, dans le débat politique comme dans les discussions privées, mais demeurent totalement inconnus. Cela empêche tout débat démocratique, tout choix juste. De quoi penser que ce brouillard de l’impôt et des cotisations est entretenu à dessein pour dissimuler la réalité et ainsi empêcher une prise de conscience populaire.
La gratuité : le grand mensonge
À ce grand inconnu de l’impôt s’ajoute le grand mensonge du contrat social, celui de la gratuité. L’école est bien évidemment gratuite, comme la santé, comme les transports dans plusieurs villes de France. Mais alors, si c’est gratuit, pourquoi payons-nous des impôts ? Et pourquoi ceux-ci augmentent-ils ? La persistance du mythe de la gratuité demeure une interrogation politique à part entière. Comment peut-on croire que l’éducation est gratuite alors qu’elle est le premier poste budgétaire de l’État (certes bientôt devancé par la charge de la dette) ? Comment peut-on croire que les salaires des professeurs tombent du ciel et que la construction des bâtiments scolaires est tirée d’argent magique ? Comme l’exprimait Frédéric Bastiat – à propos justement de l’éducation : « Gratuite ! cela veut dire : aux dépens des contribuables. » Et pourtant, le mythe de la gratuité perdure, chacun se persuadant que des « riches » paieront, autrement qu’il pourra profiter du fait que d’autres paieront pour lui.
Aucune réforme fiscale, c’est-à-dire aucune amélioration de la structure du système d’imposition, ne pourra se faire sans d’abord une simplification des prélèvements fiscaux et une clarification du débat s’y rapportant, de sorte que les mécanismes de l’impôt deviennent compréhensibles du plus grand nombre. C’est là une exigence préalable pour un bon fonctionnement de la démocratie et un choix éclairé des électeurs. Le deuxième prérequis est d’en finir avec le mythe de la gratuité : il est impératif de réviser et d’expliquer les circuits de financement, notamment en matière de fiscalité et de finances publiques locales, où l’empilement des strates administratives et l’enchevêtrement des compétences rendent difficilement identifiable et dissociable ce qui relève tantôt des communes ou des intercommunalités, tantôt des départements, tantôt encore des régions. La fiscalité est aujourd’hui un immense maquis, impénétrable à qui n’est pas avocat fiscaliste ou spécialisé en finances publiques. De quoi éloigner durablement les citoyens de la chose publique, finalement de renforcer la défiance politique et le décrochage de la vie civique.Aucune réforme fiscale, c’est-à-dire aucune amélioration de la structure du système d’imposition, ne pourra se faire sans d’abord une simplification des prélèvements fiscaux et une clarification du débat s’y rapportant, de sorte que les mécanismes de l’impôt deviennent compréhensibles du plus grand nombre. C’est là une exigence préalable pour un bon fonctionnement de la démocratie et un choix éclairé des électeurs. Le deuxième prérequis est d’en finir avec le mythe de la gratuité : il est impératif de réviser et d’expliquer les circuits de financement, notamment en matière de fiscalité et de finances publiques locales, où l’empilement des strates administratives et l’enchevêtrement des compétences rendent difficilement identifiable et dissociable ce qui relève tantôt des communes ou des intercommunalités, tantôt des départements, tantôt encore des régions. La fiscalité est aujourd’hui un immense maquis, impénétrable à qui n’est pas avocat fiscaliste ou spécialisé en finances publiques. De quoi éloigner durablement les citoyens de la chose publique, finalement de renforcer la défiance politique et le décrochage de la vie civique.
La jalousie : le grand moteur
Mais n’y a-t-il pas aussi, dans l’impôt, des passions inavouables qui sont du ressort de la jalousie et de l’envie ? Revenons une fois de plus à Frédéric Bastiat, et ici à son célèbre aphorisme : « L’État, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. » « Baisse des impôts pour soi, augmentation des impôts pour les autres » semble être trop souvent le mantra du rapport à l’impôt. C’est entendu : les « riches » doivent payer. Sans que le concept même soit défini et précisé. Le salaire médian étant de l’ordre de 2 100 euros nets dans le privé, faut-il considérer comme « riche » toute personne dont les gains se situent au-dessus de cette ligne de flottaison ? De facto¸ la réponse sera « oui » pour au moins 50 % de la population. « Riche » est un terme polémique, non un concept scientifique. C’est aussi un terme qui exacerbe les tensions sociales et qui nuit au contrat civique en créant un climat de guerre civile latente, lequel concourt à la dissolution du corps social. Quand il s’agit de faire toujours payer les autres, c’est la jalousie qui l’emporte, non le contrat social. Et c’est la fin de tout rêve et de tout espoir de vie commune.
Fiscalité : la grande révolte
Finalement, ce qui unit les Français, de l’ouvrier au grand patron, c’est le même sport partagé de la révolte fiscale, chacun à son niveau et avec ses moyens. Si l’art de l’impôt consiste à plumer l’oie sans qu’elle crie trop, force est de constater que l’oie essaie de plus en plus de rentrer ses ailes et de cacher ses plumes. Chacun a ses astuces et ses combines pour payer le moins d’impôts possibles. Déjà Richelieu expliquait, dans son Testament politique, que moins il y a d’impôts prélevés, plus ils rapportent et plus le travail est encouragé. Il y a de multiples façons de participer à la révolte fiscale, de l’exil sous des cieux plus cléments au refus de travailler ou d’épargner en passant par les « oublis » de déclarations. Dans tous les cas, cela témoigne d’une défiance à l’égard de la chose publique et d’une sécession vis-à-vis des structures institutionnelles qui ne sont plus perçues comme des alliés et des soutiens, mais comme des spoliateurs dont il faut se cacher et se prémunir. L’impôt, en étant un moyen de mutualisation des dépenses communes, peut-être, dans sa nature même, un outil de création du contrat social. Quand il devient injuste et omniprésent, il agit surtout comme un facteur de dissolution dudit contrat.