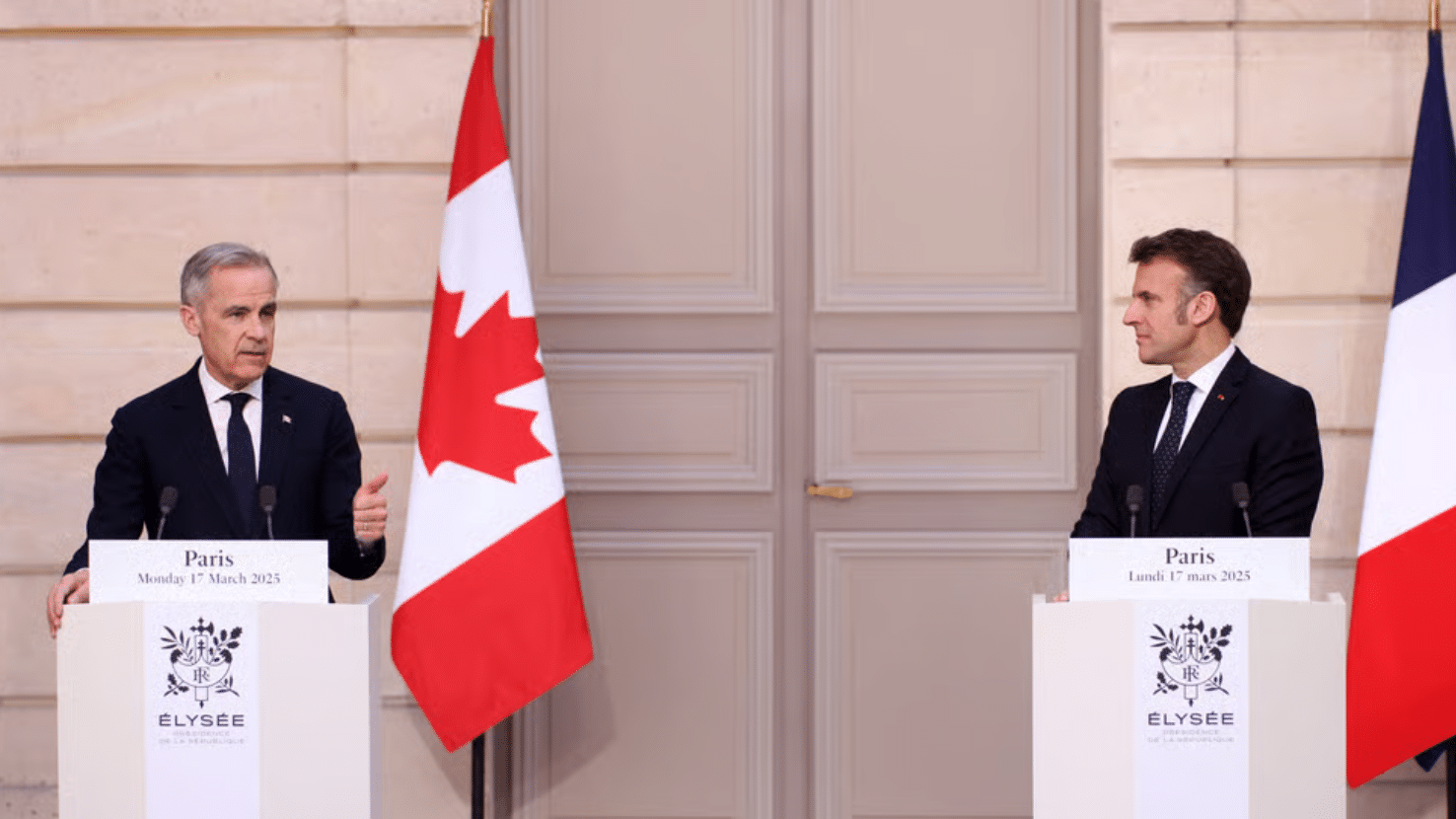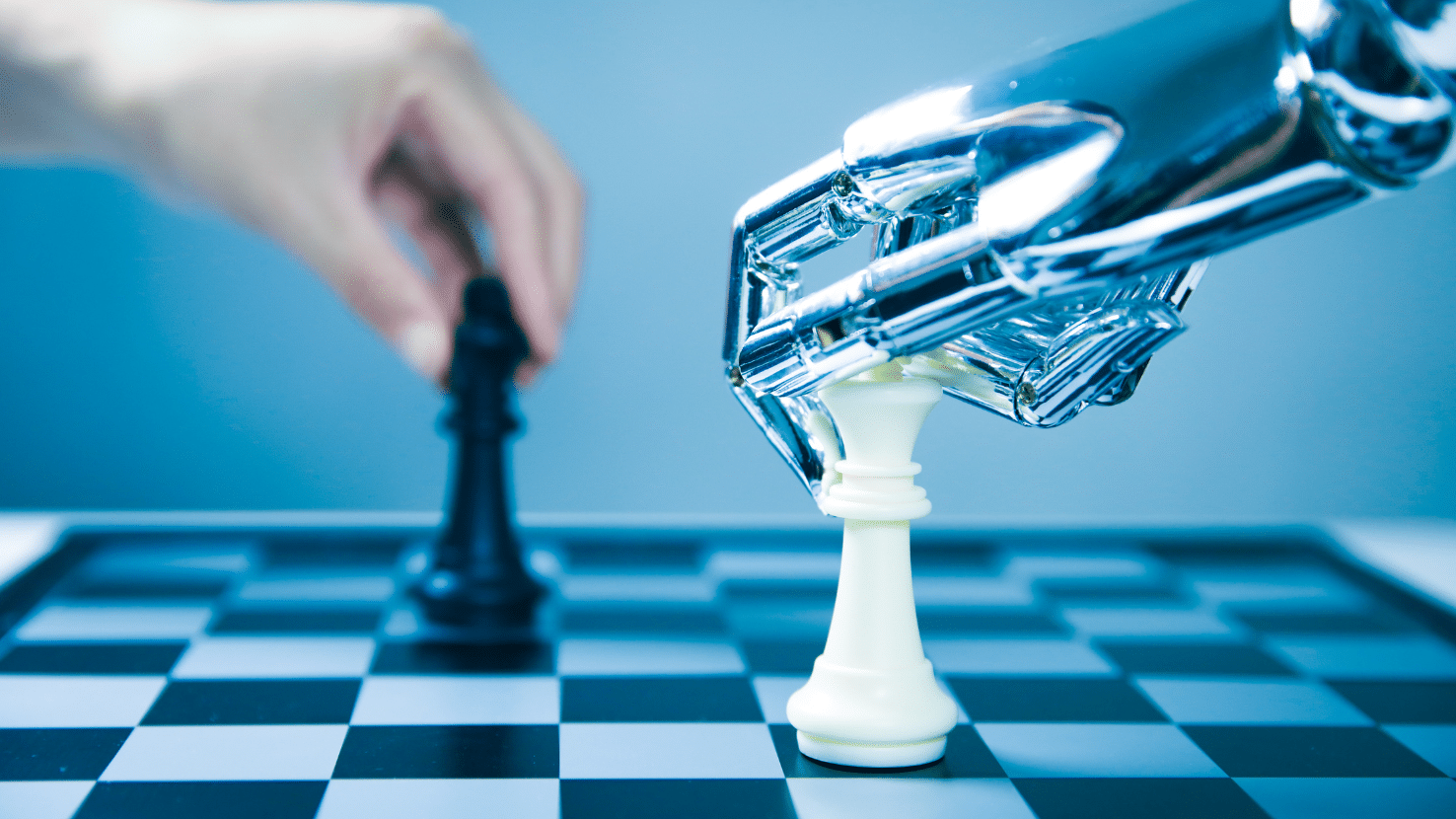La dépopulation est depuis longtemps vue comme l’une des causes du déclin des civilisations. Pourtant, l’analyse de la démographie en des temps éloignés est un défi pour les chercheurs. En l’absence d’archives fiables, l’évolution des populations repose sur des hypothèses et des modèles constamment remis en question. En étudiant spécifiquement le cas de l’Empire romain, Claire Sotinel nous montre que si la question de la population était déjà une préoccupation politique de l’empire, rien ne montre qu’elle ait été un facteur clé de son effondrement.
Cet article est extrait du cinquième numéro de la revue Mermoz, « Démographie, la transition silencieuse ».
La dépopulation de l’espace méditerranéen a souvent été considérée comme un facteur majeur du déclin de l’Empire romain à la fin de l’Antiquité, sans qu’aucun élément de preuve puisse être apporté à cette théorie. Dans la mesure où nous ne connaissons la population de l’empire à aucune période de son histoire, nous serions bien en peine de parler d’évolution.
La question de la démographie se pose pour l’historien de l’Antiquité de manière bien particulière. Dépourvu d’archives et de statistiques, il doit s’appuyer sur des sources trop fragmentaires pour être représentatives ; il propose des modèles qui peuvent toujours être discutés et que de nouvelles découvertes peuvent bouleverser.
Il est pour ainsi dire impossible d’étudier la population à l’échelle de l’empire tout entier. Même les effectifs militaires ne sont pas connus avec certitude et précision (entre 600 et 650 000 hommes au Ve siècle), et ils ne nous permettraient pas de calculer la population totale de l’empire (entre 50 et 80 millions d’habitants à son apogée au IIe siècle, selon les historiens). Calculer une population globale aurait d’ailleurs peu de sens, étant donnée l’étendue de l’empire et l’inégale concentration des populations selon les provinces et, à l’intérieur de celles-ci, selon les régions.
Nous avons plus d’informations sur la population urbaine. Nous utilisons des sources littéraires, qui ne manient pas les données chiffrées de manière positive, mais plutôt expressionniste. À titre d’exemple, dans la seconde moitié du IVe siècle, la population d’Antioche est évaluée par le rhéteur Libanios à 150 000 et par Jean Chrysostome à 200 000 habitants. Deux siècles plus tard, les victimes du tremblement de terre d’Antioche de 526 se montent à 250 000 pour le chroniqueur Jean Malalas. Tout ceci donne un ordre de grandeur – on s’accorde à penser qu’Antioche est la quatrième cité de l’empire par sa taille – mais pas des informations démographiques. Nous avons plus d’informations sur la population urbaine. Nous utilisons des sources littéraires, qui ne manient pas les données chiffrées de manière positive, mais plutôt expressionniste. À titre d’exemple, dans la seconde moitié du IVe siècle, la population d’Antioche est évaluée par le rhéteur Libanios à 150 000 et par Jean Chrysostome à 200 000 habitants. Deux siècles plus tard, les victimes du tremblement de terre d’Antioche de 526 se montent à 250 000 pour le chroniqueur Jean Malalas. Tout ceci donne un ordre de grandeur – on s’accorde à penser qu’Antioche est la quatrième cité de l’empire par sa taille – mais pas des informations démographiques.
L’utilisation des documents fiscaux, conservés nombreux en Égypte, celle des inscriptions funéraires, les apports de l’archéologie enrichissent notre connaissance des populations (espérance de vie, répartition par sexe, nutrition, causes du décès) mais restent fragmentaires. Rien ne documente une baisse de l’espérance de vie à la naissance (entre 26 et 27 ans) ou une modification des structures démographiques.
Ce que nous pouvons savoir, c’est que la question de la population est une préoccupation politique de premier rang dans l’empire romain tardif, en particulier dans le monde rural. Le pouvoir impérial est préoccupé par les agri deserti (qu’on pourrait traduire par les terres abandonnées) qui lui paraissent se multiplier, et pour lesquelles ils prend des mesures tantôt incitatives (en exemptant de taxes ceux qui les mettent en valeur, ou en établissant des barbares vaincus pour les cultiver), tantôt coercitives (en interdisant aux propriétaires terriens d’autoriser les tenanciers attachés à la terre – les « colons » – de quitter leurs domaines. L’abondance des textes législatifs conservés par le Code Théodosien (compilé en 4 »9) et le Code Justinien (529) témoigne de la préoccupation des empereurs. De même, leur souci de maintenir les curiales – les élites municipales qui fournissent les magistrats responsables de la gestion des cités – dans leurs fonctions suggèrent la diminution de cette catégorie de population dans les villes. Toute la question est de savoir si cette préoccupation est démographique ou fiscale, si les terres sont désertées parce que les habitants manquent, ou parce que les colons préfèrent aller chercher ailleurs – en ville – une vie meilleure ; si les curiales manquent parce qu’il y a moins d’enfants, ou parce qu’ils préfèrent une carrière dans l’administration impériale plutôt que dans leur cité.
Depuis une vingtaine d’années, une approche environnementale de l’histoire du monde romain est venue poser la question démographique de manière nouvelle. D’une part, la civilisation méditerranéenne fondée sur des villes de taille énorme par rapport aux possibilités de leur arrière-pays aurait suscité un stress économique considérable, rendant nécessaire des circulations de marchandises sur de très grandes distance, une déforestation impitoyable des régions urbanisées, l’épuisement de mines de métaux précieux et de carrières de marbre. D’autre part, les fortes concentrations humaines dans les villes et l’importance de la circulation des hommes et des marchandises aurait mis à l’épreuve la résistance aux maladies épidémiques. Dès la fin du IIe siècle, ce qu’on appelle « la peste de Marc Aurèle » – peut-être une épidémie de variole – a causé d’immenses ravages dans les populations ; quelques générations plus tard, une série d’épidémies attestées en Afrique, en Italie et en Orient apparaît aux contemporains comme une catastrophe massive et quasi universelle. Tout indique que, après ces épidémies (on n’ose parler de pandémie, tant notre documentation est fragmentaire), la population s’accroît de nouveau, mais on ne sait si elle retrouve les niveaux antérieurs.
Parallèlement, la répartition des populations évolue. En Gaule, à partir du Ve siècle, on observe une nouvelle occupation du sol dans les régions rurales : les agglomérations ouvertes le long des axes routiers sont abandonnées au profit d’agglomérations de hauteur plus faciles à défendre dans les régions où le pouvoir impérial ne permet plus d’assurer la sécurité contre les prédateurs, barbares ou brigands. En Syrie Palestine, au contraire, les campagnes n’ont jamais été aussi prospère et densément peuplées. Si Rome souffre du déclin de ses fonctions politiques dès le IIIe siècle, puis au Ve siècle de la migration d’une grande partie des familles aristocratiques qui lui préfèrent l’Afrique ou l’Orient, Constantinople atteint entre 500 et 750 000 habitants au début du VIe siècle.
A partir de 542, la peste dite de Justinien ravage tous les territoires de l’ancien Empire romain et au-delà. Si l’on est sûr qu’elle frappe un monde plein en Orient, le simple fait qu’elle circule jusqu’en Irlande et en Bretagne (l’Angleterre actuelle) montre la connectivité des territoires et des Hommes jusqu’à cette période tardive. L’effondrement démographique qui accompagne la peste au VIe siècle marque une rupture importante. Jusque-là, la démographie est un élément de l’immense complexité qu’est l’histoire de la Méditerranée pendant l’Antiquité tardive, elle ne peut en rien être définie comme un facteur.
A lire
K. Harper, Comment l’Empire romain s’est effondré. Le climat, les maladies et la chute de Rome, Paris, La Découverte, 2019.
C. Sotinel, Rome, la fin d’un Empire. De Caracalla à la fin du Ve siècle, Paris, Belin, 2019.