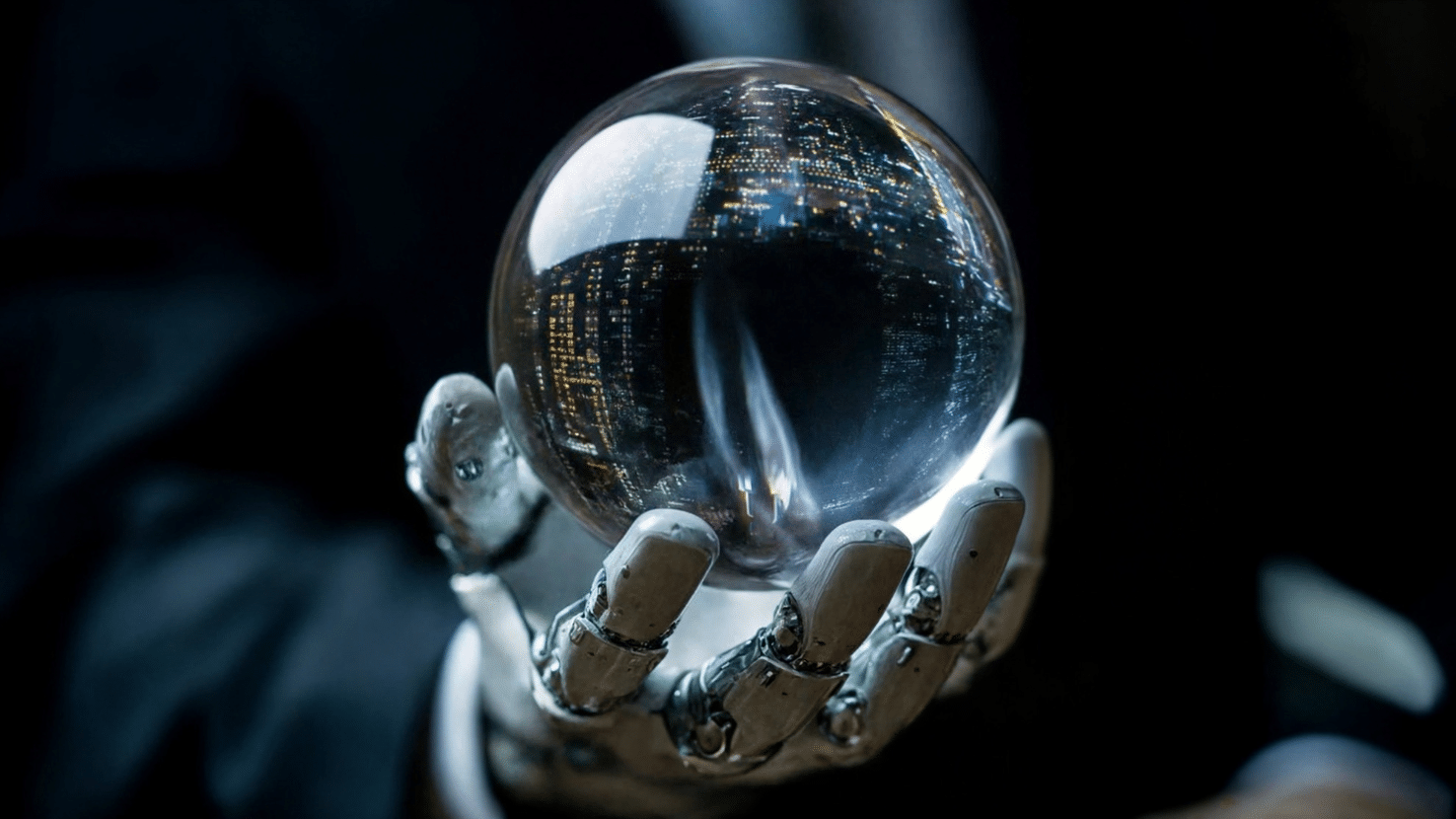Depuis la fin du baby-boom, la population française a connu une transformation démographique et sociale sans précédent. Entre augmentation spectaculaire des naissances après la Seconde Guerre mondiale, diversification des structures familiales et vieillissement progressif de la population, ces évolutions dessinent les contours d’une société en mutation. Alors que la fécondité s’érode lentement depuis 2014, et que les générations nombreuses du baby-boom atteignent les âges avancés, la France s’apprête à relever de nouveaux défis liés au vieillissement et à une stabilisation, voire une diminution, de sa population.
Cet article est extrait du cinquième numéro de la revue Mermoz, « Démographie, la transition silencieuse ».
Le cadrage démographique
Une population est le plus souvent définie comme l’ensemble des habitants d’un territoire, c’est-à-dire les femmes et hommes y résidant de manière permanente ou habituelle. Entre deux dates, la population se modifie par les naissances et les décès, dont la différence est appelée solde naturel. S’y ajoute le solde migratoire, différence entre les entrées et sorties du territoire, pour constituer le solde total. En pratique un ajustement statistique est parfois nécessaire pour maintenir la cohérence entre les évolutions et les estimations de population, notamment si la méthode d’estimation de la population se modifie.
La population est souvent décrite selon le sexe et l’âge, deux variables inscrites à l’état civil, faciles à observer et à analyser, et qui influent fortement sur la dynamique et les besoins d’une population. Au-delà des évolutions de la population, la démographie s’intéresse aux causes des comportements démographiques (fécondité, mortalité, migrations) et à leurs conséquences en termes de taille et de structure de la population.
Le baby-boom de 1946 à 1974
Pendant la première moitié du XXe siècle, la population de la France a stagné autour de 40 millions d’habitants. Si la Première Guerre mondiale a donné lieu à une hausse temporaire de la fécondité avant la poursuite de la baisse liée à la transition démographique, la Seconde Guerre mondiale est suivie d’un baby-boom massif et rapide, et aussi durable qu’imprévu : la France connaît entre 1945 et 1950 une hausse très importante de la fécondité, suivie de 20 années de stabilité et 10 années de baisse, de 1964 à 1974. Le nombre annuel des naissances en France métropolitaine augmente ainsi, de 612 000 en 1939 à 840 000 en 1946, et reste supérieur à 800 000 jusqu’en 1974. Simultanément, les décès se raréfient (autour de 535 000 par an, contre 650 000 dans les années 1930), grâce notamment à la diffusion des antibiotiques, et la population métropolitaine augmente fortement, de 40 millions en 1945 à 53 millions en 1975 (Figure 1).
Cette période de reconstruction correspond à une croissance économique forte, accompagnée par la mise en place de la Sécurité sociale et la transformation de la structure des professions ; la fécondité reste haute, les mises en couple nombreuses et précoces compensant la diminution des familles nombreuses, tandis que la mortalité baisse. Le solde migratoire augmente également fortement, tout en restant faible par rapport au solde naturel : 100 000 par an contre 300 000 (sauf pendant le rapatriement de 1962 à la fin de la guerre d’Algérie, où le solde migratoire de la métropole atteint 860 000 personnes).
Depuis 1975 : un équilibre démographique pendant 40 ans
En 1975, la fécondité se stabilise après dix années de baisse et la population connaît une phase de croissance ralentie : le solde naturel se stabilise autour de 230 000 par an (plus 20 000 si l’on inclut les DROM). Après la mise en place d’une politique de migration en 1974 affichant trois axes (contrôle des flux, amélioration des conditions de vie et organisation d’un éventuel retour au pays), le solde migratoire diminue également, oscillant autour de 60 000 par an. Ce nouveau régime moins dynamique (fécondité sous le seuil de remplacement des générations de 2,1 enfants par femme, ralentissement des progrès contre la mort, diminution du solde migratoire) conduit cependant à des perspectives de population continûment croissante : la migration se féminise et les limitations à l’entrée conduisent les immigrés à s’installer plus durablement et à contribuer à la natalité. Le niveau de la fécondité (1,85 enfant par femme), proche du niveau de remplacement, est suffisant pour garantir la stabilité de la population des enfants et des adultes ; le nombre de personnes âgées augmente progressivement grâce à la baisse de la mortalité, devenue très faible avant 60 ans et poursuivie aux âges élevés. Entre 1975 et 2015, la population française croît de 14 millions, passant de 54 à 68 millions d’habitants. Cette hausse se concentre aux âges actifs (de 27 à 55 millions aux âges 20-59) et, surtout, après 60 ans (de 10 à 16 millions).
À partir de 2015, la fécondité diminue fortement, tandis que les décès augmentent avec l’arrive aux âges élevés des premiers baby-boomers nés en 1946, et le solde naturel diminue fortement, de 205 000 en 2015 à 47 000 en 2023 (Papon, 2024). Dans le même temps, le solde migratoire augmente, notamment à cause de la baisse des sorties du territoire de personnes non immigrées (Tanneau, 2023).
Changements familiaux et inégalités entre femmes et hommes
Cette stabilité des mouvements de population de 1975 à 2014 s’observe alors que les comportements familiaux connaissent des changements majeurs, accompagnés par des évolutions législatives de premier plan. Le changement principal porte sur la libéralisation de l’accès à la contraception et à l’avortement : après la loi Neuwirth de 1967, les méthodes médicales de contraception se diffusent progressivement au cours des années 1970. La loi Veil de 1975 dépénalise le recours à l’interruption volontaire de grossesse ; elle est suivie de nombreuses lois confirmant puis élargissant les conditions de remboursement et d’accès pour établir finalement un droit à l’interruption volontaire de grossesse en 2014. Le second changement porte sur le mariage et le divorce : tandis que le divorce par consentement mutuel est introduit en 1975, les règles de filiation se dégagent du mariage des parents. Ces lois permettent une meilleure maîtrise de la fécondité par les couples et par les femmes ; les naissances sont retardées, les grossesses non prévues se raréfient et la part des naissances hors mariage augmente (jusqu’à atteindre 65% en 2023).
D’autres législations sont introduites, qui visent à diminuer les inégalités entre femmes et hommes et à protéger les femmes : loi de 1980 définissant le viol comme un crime, loi Roudy de 1983 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, loi de 1992 sur le harcèlement sexuel, loi de 2004 de protection des femmes victimes de violences conjugales, loi de 2011 élargissant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples non mariés (ou non cohabitants depuis 2 ans) puis en 2021 aux couples de femmes ou au femmes seules, loi de 2018 contre les violences sexuelles et sexistes. Ces efforts législatifs, mis en valeur par les autorités (Vie publique, 2024), traduisent une volonté affichée de tendre vers l’égalité. Ils ont cependant suivi ou accompagné, plus que provoqué, le mouvement général vers moins d’inégalités entre femmes et hommes et moins de violence familiales. Ce mouvement reste encore inabouti (Hamel et Rault, 2014) et la complexité croissante des histoires familiales (ruptures et secondes unions) conduit à une fragilisation de la situation économique de nombreuses femmes : en particulier, les familles monoparentales font face à des difficultés spécifiques, notamment en termes de conciliation entre activité professionnelle et vie familiale, et l’implication du parent non-gardien, le père le plus souvent, reste faible (Le Pape et Helfter, 2023). Cette complexité implique une diversification des situations familiales, y compris dans leur forme légale, avec la création du Pacs en 1999 (après une décennie de débats) et la loi de 2013 sur le mariage pour tous. Ces avancées, suivies de la loi sur la bioéthique de 2021, ont permis la reconnaissance des couples de même sexe.
Les conséquences : stabilité et vieillissement de la population
L’affaiblissement du mariage observé dans la plupart des pays développés s’est accompagné en France d’une diffusion de la cohabitation hors mariage et d’une diversification des formes de vie familiale. La politique familiale s’est adaptée à ces changements et multipliant les mesures spécifiques, rendant difficile l’évaluation de leur efficacité mais conduisant à la perception d’un soutien appuyé de l’État à toutes les formes de vie familiale, même si la pauvreté des familles avec enfants est élevée en France et a augmenté au cours de la dernière décennie (Unicef, 2023). Cette politique inclusive a probablement contribué au maintien de la fécondité à un niveau correspondant à la stabilité de long terme de la population, la baisse de la fécondité des jeunes étant compensée par une hausse aux âges après 30 ans, le modèle dominant restant celui de la famille à deux enfants. La question de la possibilité pour les mères comme pour les pères d’exercer une activité professionnelle sans discrimination est au centre de l’adaptation des familles à des rôles moins inégalitaires entre femmes et hommes.
Conclusion
Après la fin du baby-boom, la France a connu des bouleversements familiaux majeurs tandis que la fécondité s’est maintenue à un niveau correspondant à une stabilisation lente de la population. La diversification des situations familiales est porteuse de progrès mais également de nouvelles fragilités, surtout pour les femmes, et les politiques de lutte contre les inégalités entre femmes et femmes restent à améliorer et à implémenter plus efficacement.
La population de la France connaîtra dans les 15 prochaines années un vieillissement accéléré. La baisse actuelle de la fécondité laisse entrevoir la possibilité d’une stabilisation voire d’une diminution de la population, dont les conséquences, pas forcément négatives, doivent être scientifiquement analysées (Brzozowska et al, eds., 2024).