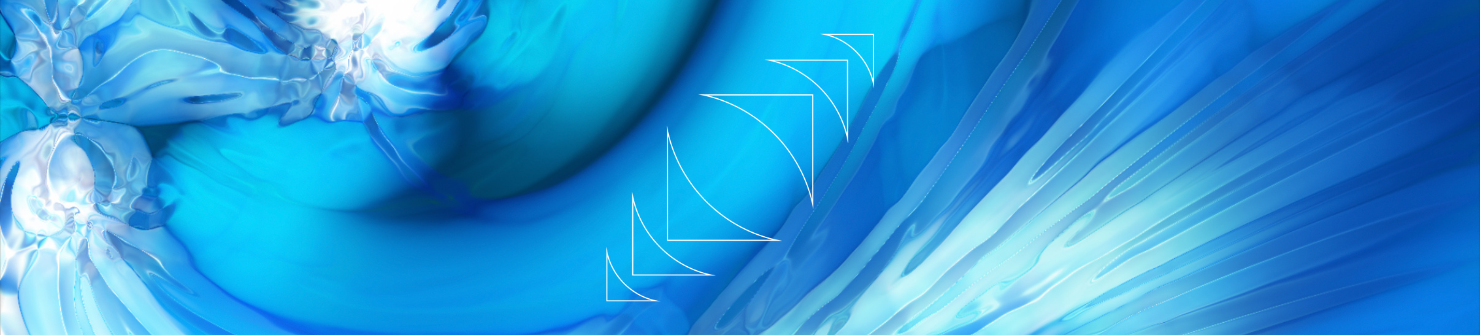La pandémie de Covid-19 a mis sous tension un système de santé déjà en crise. Si celui-ci a tenu le choc des vagues à répétition, les symptômes de ses dysfonctionnements se font de plus en plus vifs, au premier rang desquels l’épuisement du personnel médical et une réelle crise des vocations. Bien que cette crise ne soit pas spécifique à la France, notre pays s’illustre toutefois par certaines caractéristiques que Martin Hirsch, ancien directeur général de l’AP-HP, recense dans sa note. La première d’entre elles, la coupure entre hôpital et médecine de ville, perdure malgré les ambitions de rapprochement des gouvernements successifs et en dépit des besoins induits par le développement des pathologies chroniques. Autre spécificité, la centralisation des rémunérations et un statut presque fonctionnaire du personnel médical rendent notre système particulièrement rigide. Une prise en charge à deux étages, répartie entre la Sécurité sociale et les complémentaires, et un système centré sur le soin au détriment de la prévention finissent de compléter ce tableau.
Quelles évolutions mettre en place pour corriger ces dysfonctionnements ? Pour l’auteur de cette note, la priorité doit être accordée à une refonte des statuts hospitaliers, à une simplification du système de financement et à l’organisation d’un grand débat sur la place de la prévention dans notre système de santé.
Introduction
Quand certaines crises couvent à petit feu, celle du système de santé a des symptômes bien visibles. Les services d’urgence qui ferment, les délais d’attente, les « lits brancards », les déserts médicaux, les pénuries de médicaments essentiels donnent lieu à des reportages quotidiens et sont connus par une grande partie de la population qui en a fait l’expérience, pour elle ou pour ses proches. Ce qui est encore plus frappant, c’est le malaise de l’ensemble des professionnels : qu’ils travaillent à l’hôpital, en ville, ou dans les EHPAD, toutes les blouses blanches expriment leur souffrance, leur ras le bol. Et il ne s’agit pas seulement d’une expression, mais elles joignent le geste à la parole : il existe une réelle désaffection pour les métiers de soins. On s’arrête ou on change de métier. En 2022, l’AP-HP, le plus grand centre hospitalier d’Europe, a battu un double record : celui du nombre de nouvelles infirmières recrutées dans l’année (2200) et celui du nombre de lits fermés par manque d’infirmières (15 %) : le nombre de départs a été supérieur de 400 à ce nombre record de recrutements ! En Ile-de-France, les établissements privés, comme les cliniques, connaissent les mêmes difficultés que les hôpitaux publics tandis que les EHPAD n’ont jamais connu un turn over aussi rapide de leurs personnels.
Au cours des quatre dernières décennies, la problématique du système de santé était dominée par la question de la dynamique des dépenses. Il fallait maîtriser les dépenses d’assurance maladie pour que le système soit soutenable. Les unes des journaux portaient sur ces plans qui déremboursaient certains médicaments, contenaient le prix des actes, limitaient la notion d’« affection à longue durée » ouvrant la prise en charge à 100 %, pour « sauvegarder » le système de santé. Désormais, la question la plus aigüe n’est plus de savoir s’il y aura suffisamment d’argent pour maintenir le même niveau de prise en charge, mais s’il y aura suffisamment de personnels pour soigner tout le monde.
Certains professionnels pensent qu’il y a un lien entre les deux : qu’à force de plan de maîtrise des dépenses efficaces et surtout d’avoir mis en place un système « fermé » où les dépenses prévisionnelles sont décidées par le Parlement assorties de mécanismes correcteurs pour ajuster les prix quand les volumes croissent plus vite que ce qui a été anticipé, les contraintes trop fortes ont découragé les professionnels. A force d’avoir serré la vis, on aurait abimé le système de santé. Du côté des pouvoirs publics, existe l’amertume d’avoir injecté des sommes importantes avec les accords de Ségur de juillet 2021, avec une augmentation supérieure à 8 milliards d’euros de fonctionnement, sans avoir empêché les crises et donc le sentiment que des moyens nouveaux sans réforme structurelle n’ont pas d’effet favorable.
Notons que la France ne se singularise pas par le niveau de ses dépenses de santé, par rapport aux pays de l’OCDE. Il n’y a en réalité que deux pays qui se distinguent : les États-Unis, avec un niveau de dépenses particulièrement élevé, et le Royaume-Uni, qui consacre à la santé près de 3 points de moins de son PIB. Les deux pays, pour des raisons différentes, connaissent des difficultés encore plus marquées que les autres. Dans les autres pays de l’OCDE, les dépenses de santé sont comprises entre 9 et 11 % du PIB, qu’il s’agisse de la France, des pays du Sud de l’Europe comme l’Italie ou l’Espagne, de l’Allemagne et des pays scandinaves ou du Japon.
Cette crise n’est pas propre à la France. Même s’il y existe des facteurs particuliers, la crise des systèmes de santé est mondiale. En janvier 2022, au moment où se diffusait le variant Omicron a grande vitesse, quand les hôpitaux parisiens avaient 15 % de leurs lits fermés faute de personnels, les hôpitaux de Berlin avaient près d’un lit sur deux fermés ! Au printemps 2022, les grands hôpitaux de New York nous expliquaient qu’ils avaient renoncé à trouver des psychiatres pour exercer la nuit dans leur services d’urgences, et qu’ils avaient organisé une garde de téléconsultation pour les 17 services d’urgence de Manhattan, faute de pouvoir trouver des professionnels. Dans les pays émergents ou en voie de développement, l’absence de professionnels de santé en nombre suffisant est restée une problématique majeure du système de soins.
Au total, l’Organisation mondiale de la santé estime le besoin, simplement en infirmières, à 13 millions à horizon 2030 alors qu’une étude dans Lancet chiffrait ce besoin à 30 millions au même horizon !
Il est difficile de démêler, dans la crise actuelle, ce qui résulte d’une crise mondiale et ce qui relève des spécificités françaises. Il est possible d’analyser les causes spécifiques du problème français. Elles sont certaines et elles rajoutent aux difficultés. Mais il est impossible de prétendre que si ces anomalies françaises étaient corrigées, ce qui est pourtant nécessaire, nous en aurions fini avec la crise. C’est la limite de l’exercice auquel nous nous livrons. Nous analyserons les problématiques spécifiques à la France ; nous évoquerons les hypothèses que l’on peut faire sur les racines de la crise mondiale et nous conclurons avec prudence.
Le système de santé français souffre de quatre faiblesses
La première est la coupure entre l’hôpital et la médecine de ville. S’il y a bien une évolution frappante au cours des deux dernières décennies dans la plupart des autres pays du monde, c’est qu’on raisonne désormais moins en distinguant les deux secteurs. Dans de nombreux pays, les hôpitaux sont déjà des mini systèmes de santé intégrés. La plupart des grands établissements aux États-Unis gèrent des centres de santé primaires ou comptent, dans leurs effectifs, des médecins qui exercent en ville. En Espagne, l’articulation entre médecine de ville et médecine hospitalière n’est pas assurée par une intégration, mais par une responsabilité conférée au médecin traitant d’orienter vers des hôpitaux, selon des filières organisées par les autorités sanitaires.
En France le renforcement du lien Ville Hôpital figure dans tous les plans gouvernementaux mais les évolutions restent particulièrement lentes et limitées. Ceci résulte de la divergence entre deux statuts, deux modes de financement, deux modes de régulation, qui rendent particulièrement difficile la convergence des systèmes. Les personnels hospitaliers sont salariés, avec un statut particulièrement normé, les professionnels libéraux sont payés à l’acte, même si les dernières années ont vu l’introduction d’une part de paiement par forfait. Il existe une enveloppe pour les dépenses hospitalières et une autre pour les dépenses de ville. Il peut y avoir des projets communs liés à des initiatives individuelles mais qui ne constituent pas un parcours lisible entre la médecine de ville et la médecine hospitalière pour l’ensemble de la population.
Cette coupure a toujours existé. Ses conséquences étaient moins néfastes, au regard de l’épidémiologie. A la médecine de ville, la responsabilité des soins primaires ; à l’hôpital, la prise en charge des soins lourds. Or, avec la conjugaison des évolutions démographiques et des progrès médicaux, le défi qui se pose au système de santé est la prise en charge de malades chroniques, souvent atteints de polypathologies et âgés. Ces patients ont besoin d’un suivi régulier et de temps en temps de soins lourds et/ou spécialisés, mais en tout état de cause d’une continuité de leur prise en charge pour de mêmes pathologies. Des séjours à l’hôpital de plus en plus courts, des traitements médicamenteux de plus en plus longs et le besoin d’une surveillance régulière permettant l’adaptation des traitements à la réalité de leur état. Et, bien évidemment, des conditions de suivi permettant le maintien à domicile le plus longtemps possible, plutôt que le recours à l’hôpital, non plus pour des motifs liés au besoin d’un plateau technique très spécialisé mais à un environnement « soignant » qu’ils ne pourraient pas trouver à domicile.
Il est donc indispensable de pouvoir en finir avec cette dualité de l’offre qui ne correspond plus aux besoins des patients d’aujourd’hui et de demain. Dans ce mouvement de rapprochement, beaucoup plus lent que dans de nombreux pays, il y a une évolution qui peut s’avérer favorable, avec la constitution de « communautés professionnelles de territoires de santé », forme d’associations principalement de professionnels libéraux qui peuvent constituer des interlocuteurs plus structurés des hôpitaux avec lesquels ils sont invités à contractualisés. Cela évite le choc entre un hôpital fonctionnant souvent en circuit fermé et des professionnels libéraux atomisés qui forment une myriade d’acteurs isolés et hétérogènes, avec lesquels il est difficile de construire une relation permettant des parcours de soins pour des grandes populations de malades.
A noter que dans les paradoxes de la situation française, on observe une double désaffection : le statut hospitalier, tant pour les médecins que pour les paramédicaux, avec ses rigidités, est de moins en moins attractif tandis que l’exercice isolé en cabinet est de moins en moins recherché. Cette double désaffection est une opportunité pour envisager de nouveaux modes d’exercice permettant enfin de rapprocher l’exercice en hôpital de celui en ville.
Cette rigidité des statuts hospitaliers est la deuxième faiblesse, propre à la France. La France est probablement le seul grand pays où les rémunérations des médecins et des paramédicaux sont fixées au niveau national avec une grande uniformité ; le seul grand pays où leurs statuts sont plus proches de ceux de fonctionnaires régaliens que de professionnels qui produisent des soins, avec le besoin d’une grande technicité, d’une adaptation permanente. Prenons-en quelques exemples.
Alors que le coût de la vie n’a rien à voir entre une grande métropole (à commencer par Paris) et des territoires moins tendus, la rémunération des professionnels hospitaliers est la même. Dans la plupart des pays, la rémunération tient compte du coût de la vie.
Le statut des médecins hospitaliers prévoit strictement la même rémunération quelle que soit la discipline, alors que les contraintes sont très différentes et que l’écart avec le privé est très variable selon les spécialités. La nomination d’un médecin, à l’issue de la réussite à un concours, se fait dans un établissement et même dans un service, ce qui fait que la mobilité est faible et considérée comme un échec. Cette quasi-inamovibilité nuit au travail en équipe et est à l’origine de la plupart des situations délétères qui peuvent rendre un service dysfonctionnel.
Les paramédicaux ont de très faibles perspectives de carrière. Plus que la problématique du niveau de rémunération en début de carrière, c’est la faible évolutivité qui est décourageante et démotivante.
Le cadre rigide des statuts a le même effet qu’un couvercle sur une casserole qui bout : la vapeur s’échappe par les côtés. Dans notre système hospitalier, il y a deux modes d’échappement. Le départ et l’intérim. Quand le statut prévoit 300 euros pour la garde d’un senior et qu’un intérimaire peut demander 2000 euros pour 24 heures, il n’y a pas à s’étonner que la tentation de l’intérim soit si forte chez les médecins. Quand une infirmière peut, en intérim, gagner l’équivalent d’un salaire plein temps en choisissant les deux ou trois jours par semaine où elle va à travailler, on comprend que l’exercice en intérim est devenu le choix d’« installation » à la sortie de la formation !
La troisième spécificité française est l’architecture du système de prise en charge, avec cette construction à deux étages entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires. Pour un même acte ou séjour hospitalier, deux remboursements interviennent : la part principale relève de l’assurance maladie obligatoire, la part subsidiaire de la complémentaire. Cela veut dire que les mêmes feuilles de soin sont processées deux fois, générant des coûts administratifs considérables à deux endroits de la chaîne. Dans les assurances complémentaires, les coûts de gestion pour rembourser 20 % des soins sont les mêmes que les coûts de gestion de l’assurance maladie pour rembourser 70 % de la dépense : 6 milliards d’euros de part et d’autre. Mais cela génère aussi des coûts administratifs dans les hôpitaux (l’équivalent de 1500 emplois uniquement pour l’AP-HP) pour recouvrer la part complémentaire auprès des centaines d’organismes concernés, qui n’ont pas exactement les mêmes règles de prise en charge. En outre, avec des incohérences dans le reste à charge : alors qu’une partie des soins hospitaliers est prise en charge à 100 %, d’autres soins, comme les séjours en réanimation, ne font l’objet que d’une prise en charge partielle. Un enfant sans mutuelle nécessitant un séjour en soins intensifs pour une bronchiolite sévère se verra facturer deux ou trois mille euros de la part de l’hôpital. On est loin de la distinction entre petit ou gros risque ou de l’effet dissuasif du ticket modérateur ! Dans la plupart des pays, l’hôpital ne connaît qu’un seul payeur et les formalités administratives en sont beaucoup allégées.
Enfin, il est bien connu que notre système de santé est plus centré sur le soin que sur la prévention, avec une difficulté à prendre en compte les principaux déterminants de la santé que sont l’alcool, le tabac, l’alimentation et, depuis peu, l’environnement, mais aussi l’observance des traitements et les rendez-vous réguliers de prévention.
Au niveau mondial, la crise des systèmes de santé se traduit également par une crise des vocations. Une enquête conduite en 2022 auprès des 100 responsables des plus grands hôpitaux mondiaux classait la question des ressources humaines au premier rang de leurs préoccupations. Il s’agit bien d’une crise structurelle, liée à la profondeur de la transformation de systèmes de soins soumis à de fortes tensions. L’impact de l’informatisation, l’irruption de technologies sophistiquées, le comportement des patients, le poids des grandes organisations, l’exigence des procédures modifient les conditions d’exercice des professionnels de santé. Ce qui reste invariant ce sont les contraintes d’un système qui doit fonctionner 24h sur 24 et 7 jours sur 7. La certitude, c’est que l’architecture du système ne peut pas supporter une demande croissante liée au vieillissement de la population et de la mise à disposition de traitements coûteux : les fameux CART-Cells sont des traitements qui coutent plusieurs centaines de milliers d’euros par patient !
Trois évolutions nécessaires pour notre système de santé
Cette analyse nous conduit à proposer plusieurs pistes d’évolution.
Repenser les statuts hospitaliers, pour les médecins comme pour les paramédicaux
La première idée, pour sortir de l’uniformité mortifère, est de construire une rémunération comportant trois étages : un premier étage socle, défini au niveau national, un deuxième étage, variable en fonction du coût de la vie dans le lieu d’exercice, un troisième, différencié selon la discipline, les contraintes et l’expertise, qui serait à la main de l’établissement employeur, pour redonner des vrais enjeux aux négociations sociales à l’hôpital.
La deuxième idée consiste à ne plus nommer un médecin, à l’issue du concours, dans un service d’un hôpital, mais de le nommer dans une région, en l’affectant par période de cinq ans renouvelable dans un hôpital pour favoriser les mobilités et permettre moins douloureusement et plus souplement les réorganisations nécessaires des activités ; cette affectation pourrait se faire également dans un centre de santé ou une communauté professionnelle de territoire, pour permettre des allers-retours en médecine hospitalière et médecine de ville, ou être partagée entre ces deux types de structure.
La troisième idée est d’offrir aux paramédicaux de vraies évolutions de carrière, pour ne pas rester toute une vie « infirmière de base », mais pouvoir, à l’instar de ce que font remarquablement les Suédois, pouvoir progresser vers des métiers plus qualifiés, plus experts dans le soin, dans la recherche, dans l’enseignement ou dans les responsabilités managériales.
La quatrième idée serait d’organiser les formations des professions de santé sous une vraie forme d’apprentissage, avec une rémunération pendant les études (au moins à partir de la deuxième année) pour résoudre ce paradoxe qui fait qu’alors que le monde de la santé a été précurseur pour l’alternance (les externes sont à l’hôpital le matin), ils n’ont pas droit au statut d’apprenti (plus avantageux) qui aujourd’hui s’étend à de nombreuses formations.
Simplifier le système de financement
La fusion des deux étages de l’assurance maladie permettrait des économies de gestion très importantes (environ 6 milliards par an) qui pourraient être réinjectées pour améliorer les rémunérations et un allègement des formalités administratives à l’hôpital. Dans une phase intermédiaire, l’assurance maladie pourrait exercer, pour le compte de l’hôpital, la récupération de la part complémentaire, pour éviter au producteur de soins d’être également producteur de factures et agent de recouvrement. Il s’agit de tenir compte de ce que le deuxième étage de l’assurance maladie est désormais quasi généralisé et qu’il ne joue plus le même rôle que dans les années 1970. La principale difficulté réside dans le traitement des dépassements d’honoraires : c’est pourquoi une revalorisation différenciée des honoraires, permise par les économies sur les coûts de gestion, permettrait de mieux rémunérer certains professionnels sans remettre en cause l’égalité d’accès aux soins. Ceci serait l’opportunité pour les organismes mutualistes de jouer un autre rôle, en s’impliquant dans l’organisation des nouvelles formes d’exercice en ville, la structuration et le développement des maisons de santé nécessitant l’implication d’acteurs économiques à leurs côtés.
La fusion des deux étages de l’assurance maladie pourrait s’accompagner de la mise en place d’un bouclier sanitaire, transformant les différents co-paiements dans lesquels personne ne se repère, en une participation plafonnée en fonction des revenus, manière juste de montrer que la médecine n’est pas gratuite.
Organiser un débat sur la place de la prévention dans notre système de santé
La question de la place de la prévention dans notre système mérite un débat, qui ne manquera pas de surgir brutalement s’il n’est pas préparé, provoqué par la part grandissante des traitements particulièrement coûteux. Il n’est pas sûr que l’annonce récente de consultations régulières de prévention modifie réellement les comportements, ni des médecins, ni des patients. Est-il tabou de se demander si un lien doit être fait entre les actions de prévention et le niveau de prise en charge ? Quand des examens et des dosages réguliers permettent de mettre en place des mesures préventives, est-il tenable de maintenir la même prise en charge pour les personnes qui s’y astreignent et celles qui les négligent ? Le débat est délicat, comme nous l’avons vu avec les réactions explosives posées par la simple interrogation sur le remboursement intégral des soins des patients qui, en refusant la vaccination contre le Covid-19, mobilisaient des ressources rares, avec des effets d’éviction pour d’autres malades et d’autres pathologies. Il est également rendu délicat par la confusion avec l’idée qu’on pourrait pénaliser certains comportements à risque comme l’addiction au tabac. Il s’agit là, en ouvrant ce débat, non pas de pénaliser des modes de vie, dont on sait qu’ils répondent à des déterminants complexes, mais de tenir compte d’un rapport responsable au système de santé et aux données fondées sur des évidences médicales, pour viser à améliorer à la fois les indicateurs de santé publique et l’utilisation des ressources.
Quand on parle de ressources, il ne s’agit pas de ressources financières, qui épuisaient les termes du débat à la fin du siècle dernier, mais de ressources humaines, dont on se rend compte qu’elles aussi ne sont ni infinies, ni inépuisables. Cela permet de terminer sur une dernière question clé : est-ce que la « e-santé », avec tout ce qu’elle permet, conduira à mieux utiliser les ressources humaines et à des modifications majeures dans l’organisation de notre système de santé ? Cela ne dépend pas uniquement des évolutions technologiques, qui sont plutôt rapides, mais de la capacité des professionnels et des patients à accepter ces changements et la prise en compte du temps comme une ressource rare, sans que cela ne se traduise par une baisse de la qualité.