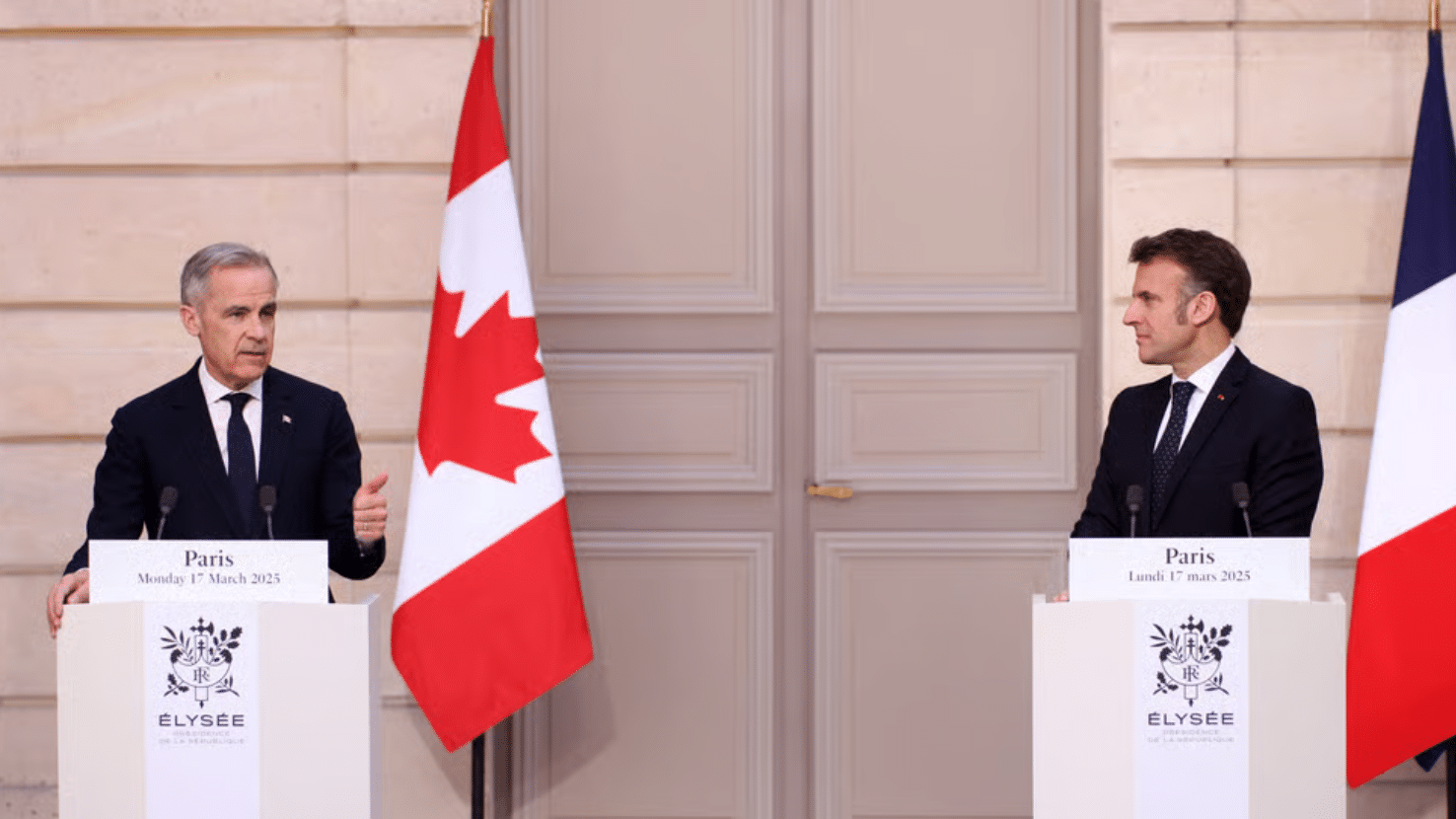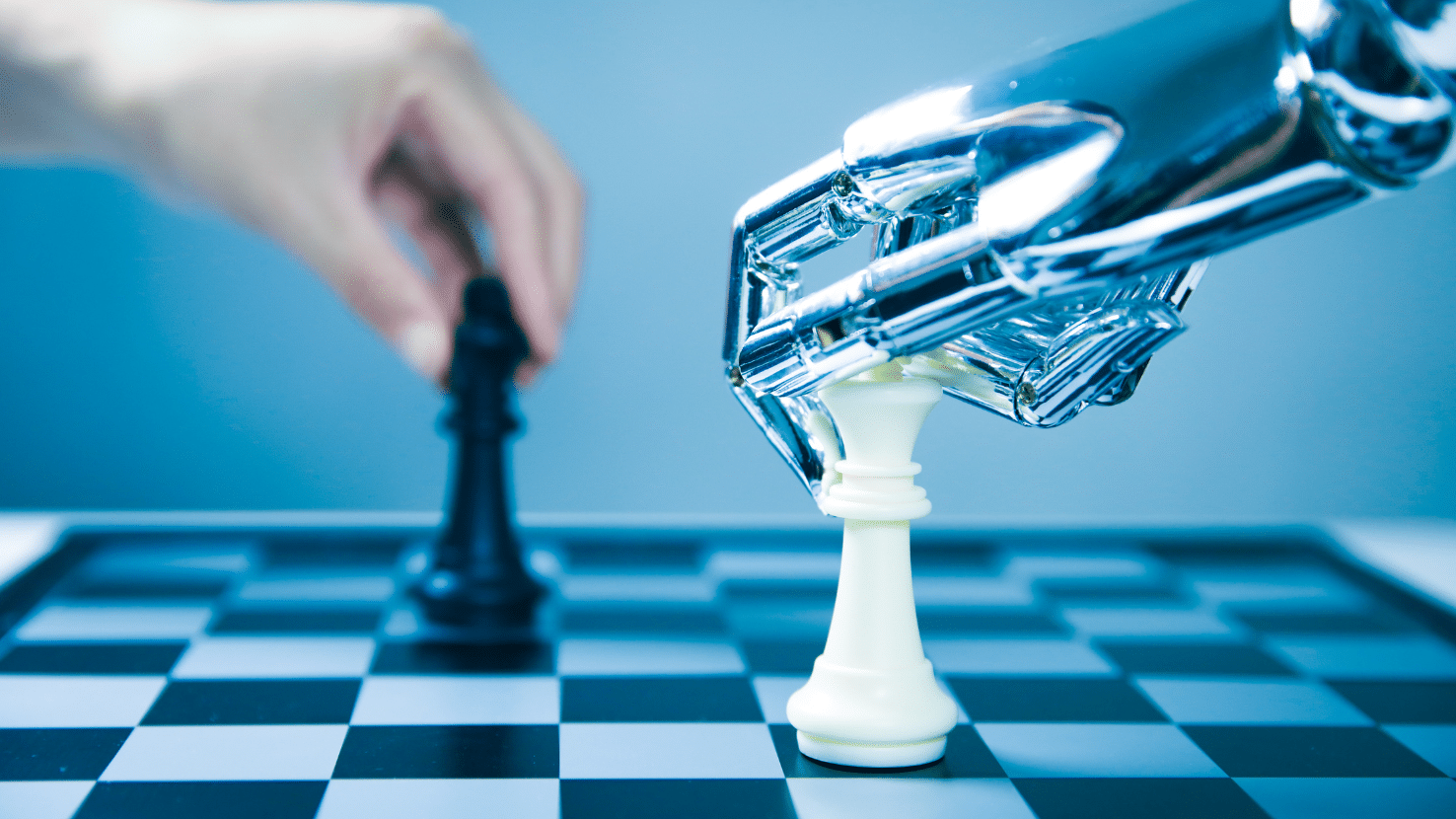L’envolée persistante des prix interroge sur le positionnement des banques centrales. Jean-Paul Pollin explique pourquoi ces dernières seraient bien avisées de relever le niveau acceptable d’inflation.
Il est assez étonnant que nombre de banques centrales aient décidé d’adopter la même définition de leur objectif de stabilité des prix : un taux d’inflation tournant autour de 2%, selon des modalités plus ou moins strictes. Car ce taux jugé « optimal » est en principe fonction de propriétés spécifiques aux différentes économies. Il résulte théoriquement d’un arbitrage entre les nuisances de l’inflation (qui brouille les signaux de prix, rend incertain le respect des contrats, provoque et entretient des conflits de répartition…) et ses avantages (elle rend moins couteux les ajustements de prix relatifs en présence de rigidités nominales, facilite la réallocation des ressources). Or, ces effets dépendent de facteurs institutionnels propres aux pays concernés, notamment à leurs cadres juridiques et réglementaires de fonctionnement des marchés.
Existe-t-il une inflation optimale ?
Les nombreuses études empiriques qui ont cherché à déterminer ce ou ces niveaux d’inflation optimale sont parvenus à des résultats peu convaincants et très variables selon les pays ou les zones considérés. De sorte que le choix de la cible de 2% a été le résultat de compromis et de mimétismes plutôt que d’analyses approfondies. Au demeurant lorsque la BCE s’y est ralliée, des observateurs ont fait valoir que ce taux était trop faible parce qu’il laissait une marge d’action insuffisante à la politique monétaire.
Quelques années plus tard, la crise financière de 2007 a démontré la pertinence de cette critique : la contrainte de positivité des taux nominaux, associée à des taux d’inflation trop bas, a limité la baisse des taux réels, réduisant ainsi la capacité de relance monétaire de l’économie. A l’époque, un certain nombre d’économistes ont suggéré qu’il serait opportun de relever le niveau de la cible de 2 à 4%. Mais cette proposition a été écartée parce qu’elle aurait pu porter atteinte à la crédibilité des banques centrales.
« Revenir à une cible d’inflation de 2% apparaît irresponsable »
Pourtant, cette même question se repose aujourd’hui, mais pour des raisons différentes. D’abord parce que l’inflation que l’on n’a pas su prévoir, et que l’on a laissé s’ancrer, risque d’être coûteuse à enrayer, en termes d’activité et d’emploi ; se contenter d’un retour incomplet à la cible (disons à 3 ou 4%) serait plus raisonnable. D’autant que la transition écologique ainsi que les relocalisations d’une partie des chaines de production vont constituer une nouvelle source d’inflation dans les années qui viennent. Parce que ces restructurations vont engendrer des investissements massifs, des accroissements des coûts de production et des taxes écologiques.
Dans ces conditions revenir à une cible d’inflation de 2% apparait audacieux si ce n’est irresponsable. Car il faudrait alors que les augmentations de prix dans les secteurs touchés par les transformations soient compensées par des baisses de prix dans les autres activités. Ce qui ne pourra se faire sans dommages pour la croissance.
Relever la cible… sans le dire
Il est vrai que la BCE, comme d’autres banques centrales, a convenu que sa cible serait définie à l’avenir de façon plus flexible, c’est-à-dire en moyenne sur un horizon plus long. Mais qui peut imaginer qu’après avoir subi ou accepté une inflation bien supérieure à 2% pendant 2 à 3 ans, elle s’efforcera de maintenir la hausse des prix en dessous de sa cible durant le temps nécessaire au respect de la nouvelle formulation de son objectif ? Vouloir le faire croire ne serait-il pas fatal à sa crédibilité ?
Afficher que les circonstances nécessitent un relèvement du niveau de la cible (à 3 ou 4%) serait donc la solution la plus claire et sincère. Mais le faire sans le dire, pour profiter de la rationalité limitée dans la formation des anticipations, est peut-être la manière la plus pratique de procéder. C’est donc bien celle qui risque de l’emporter, quitte à remiser l’argument de la crédibilité.