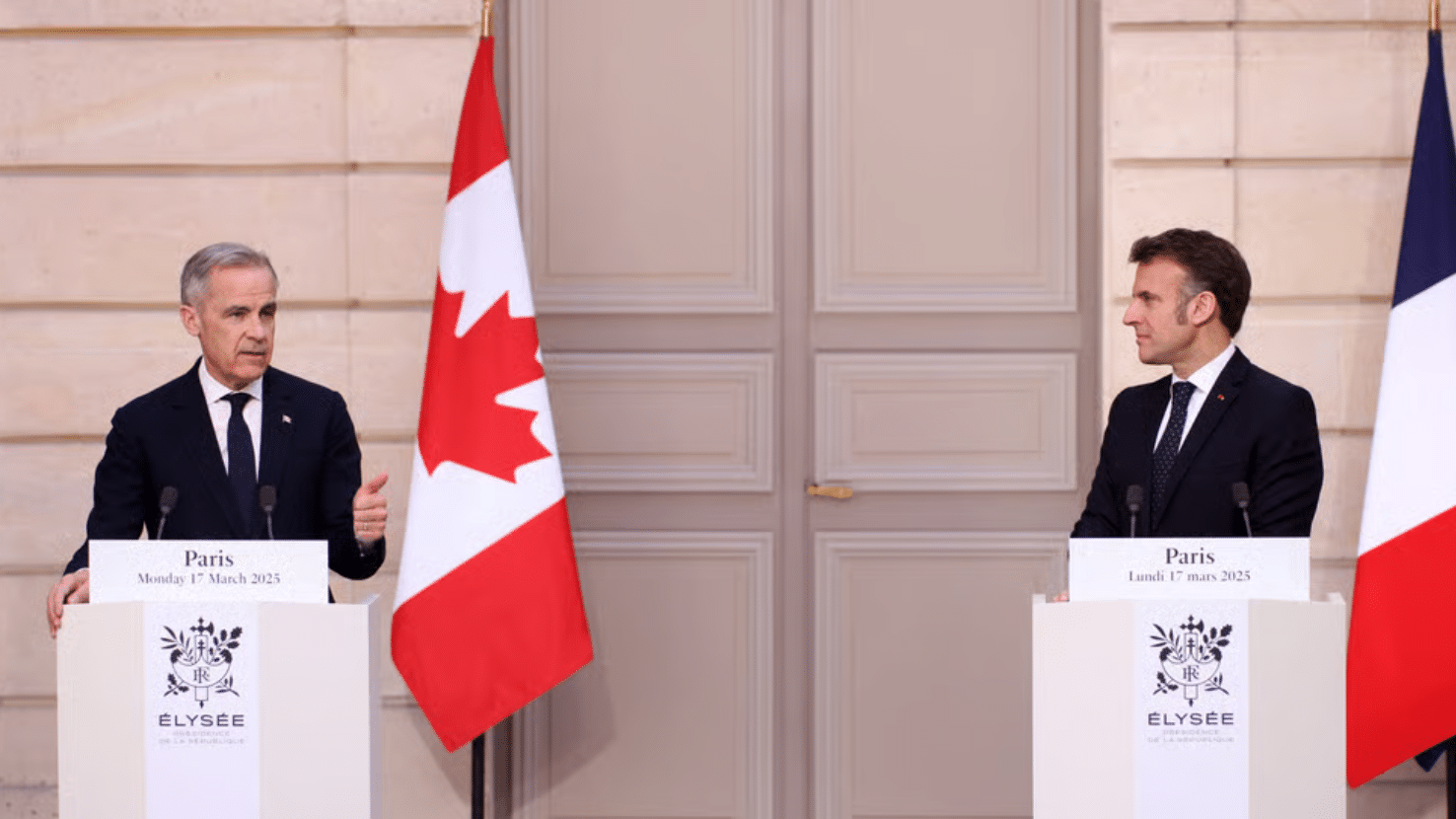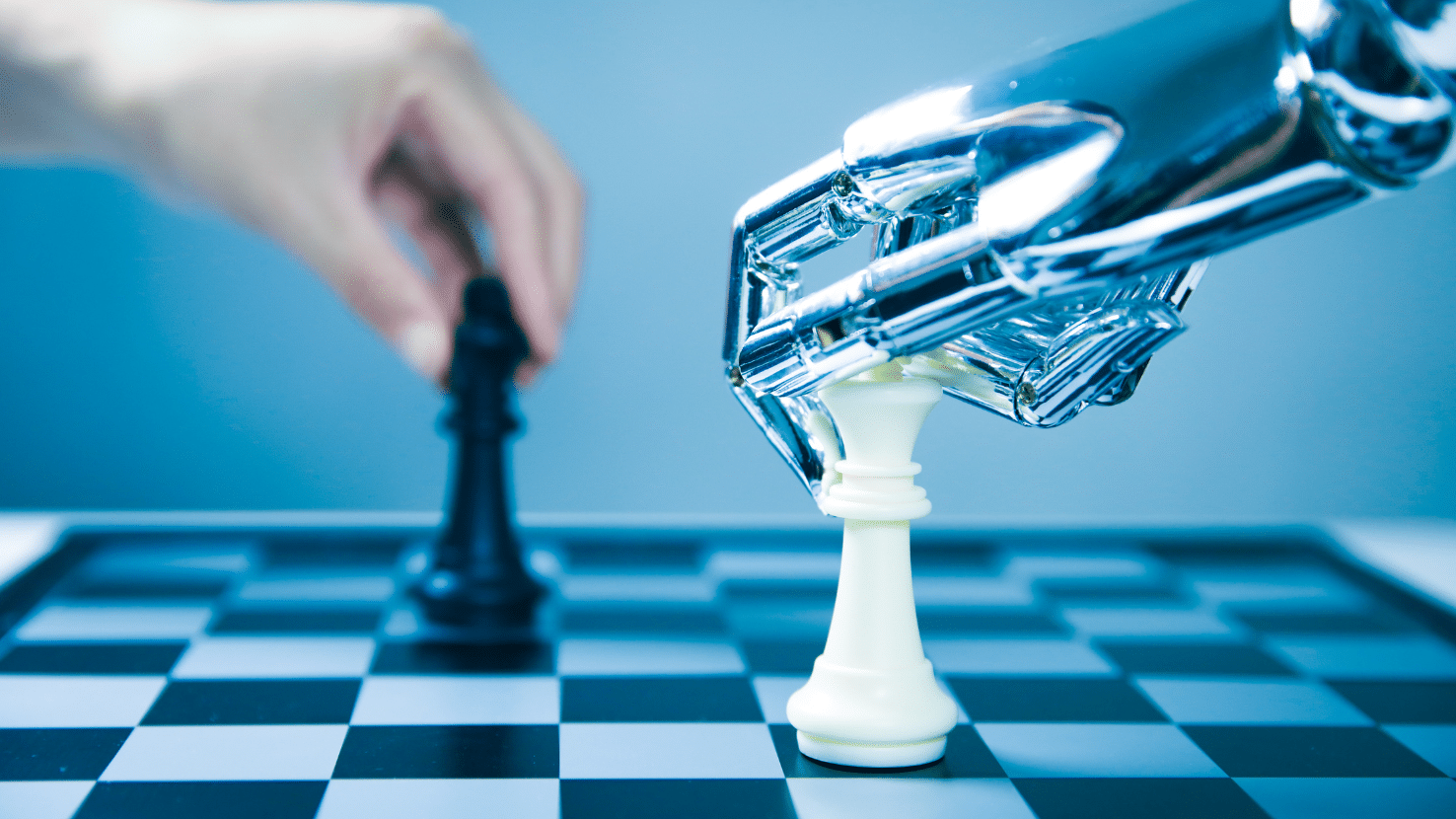Alors qu’un incroyable événement bouleverse nos vies et que la soif d’information est immense, la presse quotidienne va mal. Tout converge pour sonner le glas du papier et pointer le péril qui menace les journaux jusque dans leur format numérique. Il y a la cascade des disparitions, restructurations, rachats plus ou moins heureux. La fuite du lecteur vers les réseaux sociaux et autres plateformes.
La dégradation de la distribution par la poste durant le confinement, au moment où des habitudes auraient pu se réinstaller. La fermeture de kiosques ou leur maintien mais avec une offre réduite, alors que la préférence du consommateur pour la diversité est un ingrédient de sa propension à l’achat, même si, in fine, son choix se fait sur un petit nombre de titres.
La fin du papier est-elle si grave ? Après tout, le numérique est un bon substitut au papier. Et l’on en finirait avec le feuilleton de la crise de Presstalis. Mais on peut craindre qu’elle emporte avec elle la fin d’un journal complet fort de l’ordonnancement des thèmes, à même de former l’homme moderne que désigne Hegel, celui pour lequel « la lecture du journal est la prière du matin ».
Alors qu’on a toujours argué de la complémentarité entre médias, le journal papier serait le premier média à disparaître, entrainant dans son sillage le morcellement et la spécialisation de l’information, cannibalisée par les réseaux sociaux. Est-ce faire là excès de pessimisme ? Certes, la fréquentation des supports numériques va de record en record. Le revenu numérique du New York Times (5,7 millions d’abonnés à sa version numérique et 0,8 million au papier) vient de dépasser le chiffre d’affaires « papier ». Mais tous les journaux ne sont pas logés à la même enseigne, et la saignée est sévère en de nombreux coins du globe. L’abonnement numérique est moins cher que le papier, et sa monétisation par la publicité est décevante, d’autant plus que le marché publicitaire s’est vu plomber par la pandémie.
C’est là une double peine sur des marchés bifaces, vivant avant tout de ces deux sources de revenus. Quant aux revenus des petites annonces, programmes télé, information boursière, ils se sont définitivement évaporés. Et la recette événementielle s’est effondrée avec la pandémie. On en appelle à l’intervention de fondations ou de quasi mécènes, mais elle ouvre la voie à d’autres sortes de dépendances.
Que faire ? Même si les plateformes américaines acceptent de payer des droits voisins au titre des articles qu’elles référencent, la crise ne sera pas surmontée. D’un côté, les journaux doivent travailler à la diversification de leurs revenus et à la montée en qualité. Confrontés comme ailleurs à la tentation du télétravail, au risque de la perte de la culture commune, ils doivent se réinventer. D’un autre côté, il n’est pas vrai que les aides à la presse sont excessives. Elles le semblent parce qu’on y inclut la compensation (partielle) des tarifs postaux et le coût induit d’un taux de TVA très réduit. Il faut revenir à des abonnements massifs pour les écoles, lycées et universités. Il faut que la presse soit plus visible dans l’espace public, plus présente dans les programmes scolaires. Il faut « quoi qu’il en coûte » soutenir et sauver la presse sans laquelle la mise en péril de nos démocraties franchira un pas de plus. Quand Yuval Noah Harari déclare au Financial Times « qu’il n’est pas trop tard pour refonder la confiance des gens dans la science, les autorités publiques et les médias », il a raison. Les trois sujets sont indissociables.