— Derniers articles
-

Pourquoi l’Europe a besoin d’argent ?
La perspective des élections européennes du 9 juin replace sur le devant de la scène les lourds enjeux financiers auxquels est confrontée l’Europe. Pour Jean-Paul Betbeze, ces enjeux…
-

Information : une demande croissante pour une pluralité de canaux
Télévision, radio, presse papier ou numérique, la majorité de la population consulte l’actualité sur plusieurs canaux, observe Françoise Benhamou. Les états généraux de l’information mis en place par le…
-
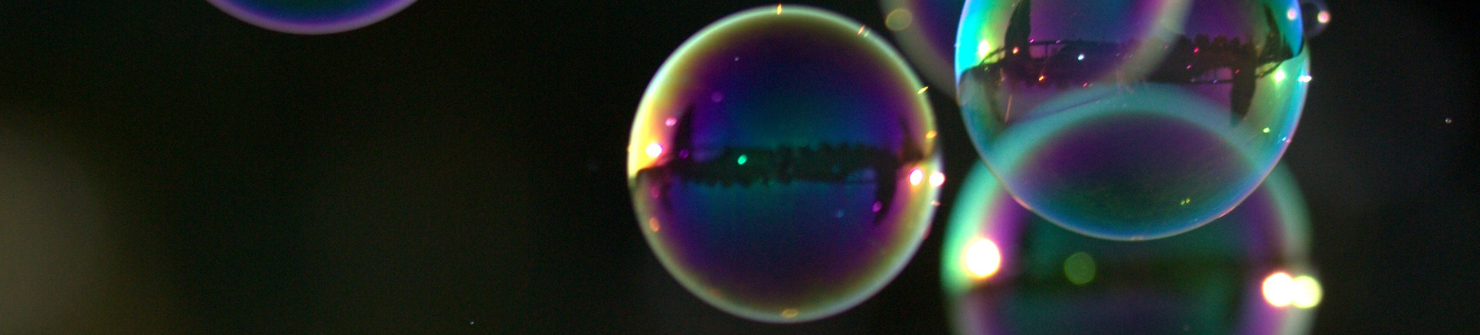
Marchés financiers : va-t-on vers une bulle ?
Les marchés financiers volent de record en record. Jusqu’où, et est-ce au risque de créer une bulle explosive ? Jean-Paul Betbeze explique pourquoi les grandes Bourses mondiales vont continuer…
-

La France des 60 000 jeunes
Plus d’un million de jeunes sont aujourd’hui livrés à eux-mêmes, sans emploi, sans formation, l’immense majorité d’entre eux n’aspirent qu’à une seule chose, donner à leur existence une…
-

Le débat | Faut-il taxer superprofits et superdividendes ?
Pour combler une partie du déficit public, le gouvernement s’apprête à ouvrir la chasse aux rentes. Les contours de ces « rentes » ne sont pas encore définis précisément mais…
— Evénements
-
Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2024
7000 participants, 380 intervenants, 67 sessions et controverses… les 23èmes Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence ont recréé l’espoir. Chefs d’entreprise, universitaires, chefs d’État et de gouvernement, représentants syndicaux, étudiants, acteurs…
5-6-7
juillet 2024
-
25-26
Janvier 2024
Les Rencontres Économiques de Singapour
-
27-28
novembre 2023
Les Rencontres Économiques de Kigali
-
4 – 8
Octobre 2023
26e édition des Rendez-vous de l’Histoire



